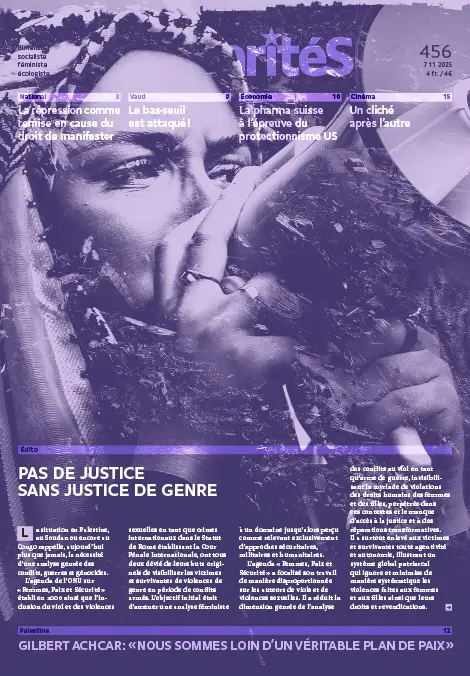La répression comme remise en cause du droit de manifester
Ce début d’automne 2025 a vu s’abattre, sur les manifestations suisses en solidarité avec la Palestine, un niveau de répression qui n’avait plus été expérimenté depuis des années par les foules. De nouvelles techniques policières sont notamment venues s’ajouter aux usuels coups de matraque.

En mai dernier, à Berne, une manifestation non-autorisée en soutien avec le peuple palestinien faisait l’objet d’une intense répression, avec le déploiement de « mesures de contraintes » qui ne sont pas d’usage courant sur le territoire romand. Ces dernières ont été utilisées de manière extensive sur plusieurs manifestations pour la Palestine : le 18 septembre à Lausanne, le 2 octobre à Genève et à nouveau à Berne le 12 octobre.
Nouvelles techniques répressives
La réponse policière à la manifestation pro-palestinienne genevoise du 2 octobre illustre parfaitement le tournant répressif à l’œuvre et les « nouveaux » outils sur lesquels il repose. L’utilisation de gaz lacrymogène sur le pont du Mont-Blanc et l’impossibilité, pour la foule, de se disperser a entraîné le gazage d’une immense partie du cortège, même très éloignée de la tête de ce dernier.
Lors de la suite de la manifestation, les lacrymogènes ont plu sur les Pâquis, les Grottes et dans la gare Cornavin, qui n’avaient pas été évacués. Puisque les balles en caoutchouc et les grenades ne visant que les « black blocks » n’ont pas encore été inventées, toutes les personnes présentes dans ces lieux ont été exposées aux violences – qu’elles soient passant·es, usager·es de quai 9, client·es des bars en terrasse ou manifestant·es.
Cette indistinction dans l’intensité de la répression s’est retrouvée lors des autres manifestations de ce début d’automne. Le 12 octobre, à Berne, la police a pratiqué une nasse sur un groupe d’environ 500 manifestant·es. Pendant de longues heures, majoritairement nocturnes, celleux-ci furent encerclé·es et retenu·es, sans avoir accès à de l’eau, à de la nourriture ou aux toilettes. Selon un décompte militant, plus de 300 personnes ont été blessées ce jour-là. Ces éléments contredisent radicalement le discours des autorités qui prétend que le « maintien de l’ordre » n’a pas fait de blessé·es et se serait déroulé sans problèmes.
Une répression « disproportionnée » ?
Au sein d’une partie de la gauche, la tentation est grande de pointer le caractère « disproportionné » de cet accroissement répressif. Une telle lecture sous-entend qu’il existerait, dans certains cas, une répression proportionnée, c’est-à-dire justifiée (par une soi-disant menace) et mesurée (dans les moyens déployés pour la mettre en œuvre). En acceptant de discuter de la proportionnalité de la répression, le narratif policier est complètement accrédité : le recours à la violence par les forces de l’ordre ne serait qu’une réponse aux actes d’une partie de celles et ceux qui manifestent.
Telle est effectivement la rhétorique bien rodée de la police : diviser les manifestant·es entre des « black blocks » radicalisés, qui chercheraient uniquement à en découdre, et le reste des participant·es, supposément pris·es en otage par le cortège de tête qui imposerait sa violence. Si ce discours fonctionne généralement bien sur l’opinion publique, l’accroissement répressif le met à mal dès lors que l’entrave policière au droit de manifester s’applique sur une population jusqu’ici peu habituée à la violence répressive.
En questionnant la « proportionnalité » de la répression plutôt que de la rejeter dans son fondement, le principe même de franchissement d’un certain seuil de dégradation et/ou de violence par les manifestant·es comme justification répressive n’est même plus contesté : seul l’abaissement du niveau de ce seuil fait l’objet de critiques.
Fonction politique de la répression
Construire une position politique sans sortir du narratif policier présente le risque de passer complètement à côté de la fonction proprement politique de la répression. Quand le discours répressif distingue pacifistes et « casseur·ses », c’est toujours pour justifier une action répressive contre les second·es, en prétendant protéger les premier·ères et leurs droits. Pourtant, celles et ceux qui manifestent savent que la pratique est toute autre : la répression s’applique toujours de manière indifférenciée sur tou·tes les manifestant·es, car l’objectif n’a jamais été de protéger le droit de manifester mais bien de « maintenir l’ordre » dans l’espace public. La fonction politique de toute forme de répression réside effectivement dans la désactivation de toute dynamique de contestation.
Ce tournant répressif, loin d’être une exception helvétique, s’inscrit dans un contexte européen de durcissement étatique face aux mouvements de solidarité internationale, en particulier avec la Palestine. Face à celui-ci, les plus déterminé·es n’abandonneront certainement pas la lutte, mais d’autres pourraient craindre de se prendre à nouveau des coups, de se faire gazer, voire de se faire arrêter. Le discours policier prétend viser seulement les franges prétendument agitatrices, mais l’action policière a bien pour fonction de réduire la conflictualité sociale dans son ensemble, en visant la démobilisation de toutes celles et tous ceux qui luttent, quels que soient leurs moyens.
Clément Bindschaedler Antoine Dubiau