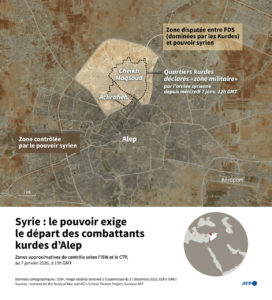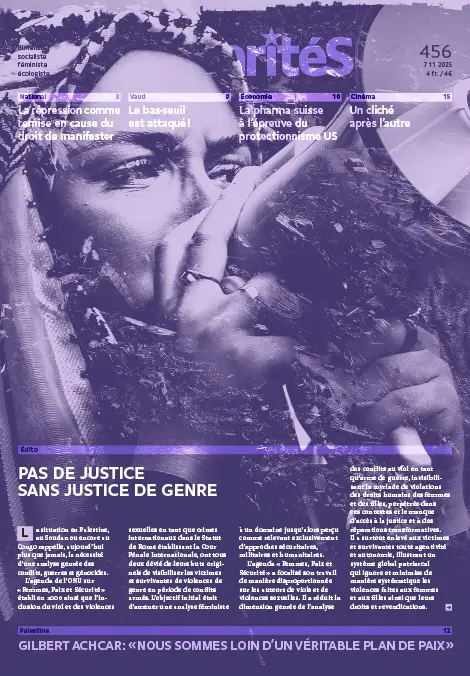L’écriture est un métier !
En Suisse, il est quasiment impossible pour les auteur·ices de vivre de leur métier. Des pistes existent pour sortir d’une précarité renforcée par un statut hybride.

La vision mythique de l’artiste qui nourrirait sa créativité dans la misère et se satisferait pleinement de son art sans rechercher de rémunération particulière a pour conséquence de freiner la reconnaissance d’un droit à des revenus décents. En Suisse, les auteur·ices en sont également victimes.
En effet, seul un cinquième des membres de l’AdS (Association Autrices et Auteurs de Suisse) vit de sa plume, en partie à cause de la répartition disproportionnée des recettes du livre. Selon Olivier Babel, ex-secrétaire général de LivreSuisse, seuls 10 % du prix de vente reviennent en général à l’auteur tandis que 30 % sont alloués à l’éditeur, 20 % aux diffuseurs et distributeurs, et 35 à 40 % aux libraires.
Des revenus insuffisants
La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a révélé dans une étude de 2021 que 60 % des travailleur·ses professionnel·les de la culture vivant en Suisse gagnaient moins de 40 000 francs par an. L’auteur suisse de best-sellers Nicolas Feuz indiquait par exemple gagner environ 34 000 francs brut par an…
Cette précarité est renforcée par les déficiences dans le système de sécurité sociale, que ce soit pour la prévoyance vieillesse ou l’assurance chômage. La mise en place de caisses de pension accessibles aux artistes n’a pas non plus permis de changer drastiquement leur situation car, en tant qu’indépendant·es, leur affiliation à une institution de prévoyance professionnelle reste facultative.
Le manque de reconnaissance dans la profession contribue aussi à retarder la mise en place d’un réel statut pour l’auteur·ice qui, en signant des contrats d’édition, ne conclut pas une relation de travail mais une simple cession de droits sur l’œuvre. Pourtant, on retrouve dans ces mêmes contrats des contraintes professionnelles, impliquant souvent une date de rendu du texte, un rétroplanning jusqu’à la publication et de plus en plus fréquemment des obligations de présence pour la promotion de l’œuvre ainsi qu’un engagement sur les réseaux sociaux.
Cette ambiguïté de statut permet aux maisons d’édition, bien qu’elles engagent une charge financière, d’alléger souvent leur risque financier en ajoutant des clauses contractuelles qui surchargent davantage les auteur·rices.
L’exemple français
La ligue des auteurs professionnels alerte justement sur la question du statut d’auteur·ice en France, qui ne bénéficie pas d’une juridiction claire mais résulte d’un assemblage de dispositions issues du Code du travail, du régime des indépendant·es et d’un régime spécial comparable à celui des intermittent·es du spectacle (mais sans droit au chômage).
La proposition de loi française « pour une continuité de revenus des artistes auteur·ices » doit inspirer nos propositions. Lancée par un ensemble d’organisations professionnelles de travailleur·ses de l’art et la commission culture du Parti communiste français, la proposition, non adoptée, permettrait aux auteur·rices de percevoir un salaire y compris lors des phases de non-activité.
Cette nouvelle règlementation aurait donc pour effet de définir une structure claire pour les auteur·ices, en versant un revenu régulier et compensatoire entre deux publications, sur le modèle du statut d’intermittent du spectacle, mais en prévoyant également une continuité au niveau de leurs droits sociaux. Notons que la Belgique a déjà adopté un système permettant aux auteur·ices justifiant d’un revenu suffisant d’accéder à une sécurité sociale continue.
Des efforts insuffisants
En Suisse, l’un des exemples les plus proches de la continuité des revenus a été mis en place dans le contexte de la pandémie du covid, où des formes d’indemnités et d’aides d’urgences ont été libérées par l’Association Suisseculture. Mais aujourd’hui, celle-ci ne se destine plus qu’aux situations de détresse économique ou sociale après des accidents ou lors d’une maladie grave. Nous sommes donc encore loin d’un principe de rémunération régulière octroyée à tous les créateur·rices capables de justifier d’une activité artistique sérieuse.
Actuellement, les sociétés de gestion constituent le principal organe permettant d’assurer aux auteur·ices une meilleure rémunération. Grâce à la négociation périodique de nouveaux tarifs effectuée avec les associations d’utilisateur·ices et approuvées par la Commission arbitrale fédérale (CAF), ces structures à but non lucratif reversent une compensation aux créateur·ices, en parallèle de leurs droits d’auteur. Cependant, les artistes n’ont souvent pas connaissance de leurs droits à ces rémunérations supplémentaires.
Dans son Message culture 2025–2028, la Confédération a annoncé qu’elle s’attachera à « garantir une rémunération équitable des acteurs culturels professionnels et améliorer les conditions de l’exercice de la profession et l’égalité des chances. » Mobilisons-nous pour que cela ne reste pas un vœu pieux, particulièrement face à l’offensive austéritaire !
Iuna Allioux