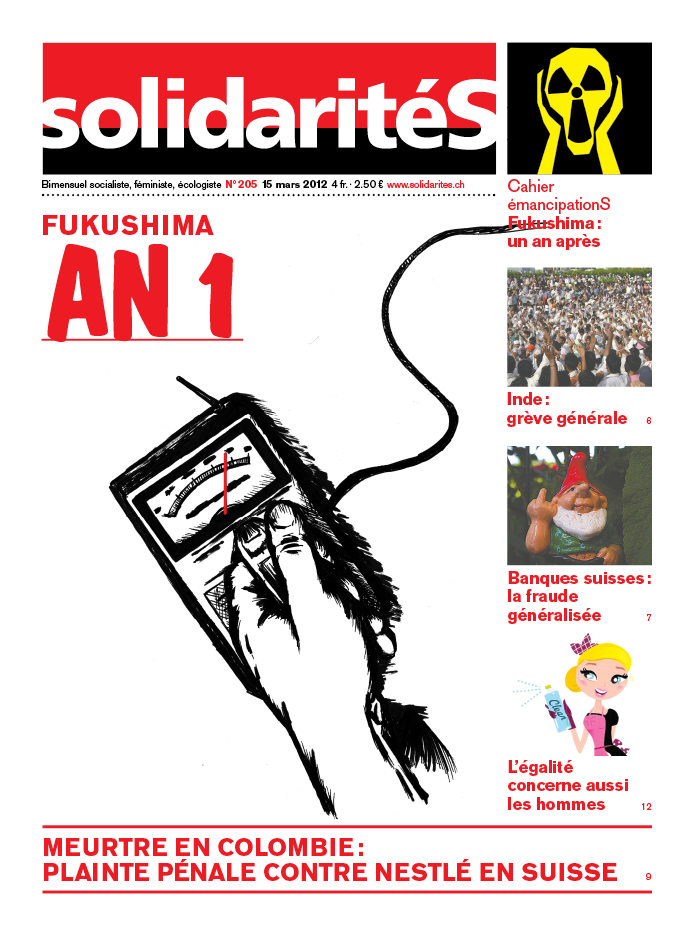Garzon victime de l'instrumentalisation politique de la justice
Le 23 février dernier, le magistrat Baltasar Garzón a été destitué à l’unanimité par les juges de l’Audience nationale espagnole, pour avoir ordonné la mise sur écoute de personnes inculpées pour leur participation à un réseau de corruption dans lequel sont impliqués de nombreux membres du Parti Populaire (PP).
Cette affaire connue comme le cas Gürtel, concerne des délits de détournement de fonds publics, de financement illégal du parti, de fausses factures et de blanchiment. Garzón a été exclu pour une durée de 11 ans. Le jour de la destitution du juge, deux députés du PP de Valence mis en examen dans ce même cas Gürtel (Francisco Camps et Ricardo Cuesta) ont été absous. Camps a refait son entrée au Parlement valencien. Comme l’a précisé le député d’Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, cette « politisation corporative du pouvoir judiciaire » est un affront à l’éthique civile et à la justice suprême.
La décision unilatérale qui touche Garzón ressemble à une remise à l’ordre d’un magistrat qui dérange les représentants du pouvoir politique depuis son entrée en fonction en 1988. Il s’est fait connaître par des procès retentissants contre de hauts responsables de part et d’autre de l’échiquier politique. Garzón a mené une enquête sur le financement par le ministère de l’intérieur de Felipe González du groupe para-policier G.A.L. (Grupo Antiterrorista de Liberación), responsable de l’assassinat de 23 partisans de l’E.T.A. Suite à ce procès, Gonzalez n’a pas été réélu en 1996. Le magistrat s’est fait connaître sur la scène internationale pour son inculpation de l’ex-dictateur chilien Augusto Pinochet. Au cours des années 2000, le juge a mené de front plusieurs enquêtes contre un réseau de corruption et depuis 2008, il s’est attelé aux crimes commis durant la guerre civile et la dictature franquiste.
Réparation des crimes franquistes ?
Si la société civile et les médias, fortement mobilisés depuis 2009, perçoivent Garzón comme un justicier contre l’impunité des puissants, les juges de l’Audience nationale, y compris certains progressistes, en ont décidé autrement, protégeant les élites économiques et politiques qu’il a osé placer sur le banc des accusés.
Cette instrumentalisation politique de la justice risque aussi de mettre à mal la procédure entreprise par Garzón en faveur de la réparation des crimes de la guerre civile et du franquisme, alors que les dernières victimes décèdent. Si Franco a pris soin d’honorer ses morts et de rendre une justice unilatérale et expéditive durant quarante ans, aucune réparation officielle n’a été engagée en Espagne depuis la transition. La loi d’amnistie, présentée comme le meilleur remède pour mener à bien une transition non-violente, a permis aux anciens membres du régime d’occuper des postes de choix dans la nouvelle configuration politique. Aucune « Commission de vérité » n’a fait d’enquête sur les disparus, encore moins sur les responsabilités. L’ancien ministre franquiste de l’information et du tourisme, Manuel Fraga, a ainsi fondé l’Alliance populaire, devenue Parti Populaire en 1989. Face à ce silence politique plusieurs acteurs de la société civile, entre autres, ont tenté de rechercher les disparus et de lutter pour la reconnaissance des crimes commis durant la guerre et la dictature, pour faire connaître leurs témoignages.
Confrontations mémorielles
Si les historiens ont également investi le sujet et ont apporté des avancées sur la violence durant le conflit et la dictature permettant d’affiner les connaissances sur cette période, les autorités n’ont pas brisé le consensus hérité de la transition. C’est la résurgence des confrontations mémorielles entre gardiens de la vision franquiste et défenseurs des victimes au cours du mandat de José María Aznar (1996–2004), dans un contexte de polarisation politique, qui a été décisive. La médiatisation, au cours des années 2000, de la découverte par Emilio Silva, de la fosse où gisait son grand-père a marqué un tournant. L’opération a donné naissance à un autre mythe, celui des « petits-fils de Républicains » investis de la responsabilité de demander justice. Dans son discours d’investiture en 2004, José Luis Rodríguez Zapatero a invoqué le souvenir de son grand-père, fusillé au cours de la guerre, et a lancé le projet de loi dite de « récupération de la mémoire historique », ratifiée en décembre 2007. Mais la loi a vite révélé ses limites et s’est placée sous le sceau de la « réconciliation » prônée par la transition. La démarche de judiciarisation de Garzón s’inscrit dans la volonté de familles de victimes qui n’ont pas accepté ce renoncement. En 2008, le juge armé de plus de 100 000 noms de disparus, a demandé l’ouverture d’une enquête. Son action a provoqué un recours de la Phalange espagnole et du groupe d’extrême droite Mains Propres qui a été reçu par les juges de l’Audience nationale, provoquant une mobilisation internationale pour protester contre l’impunité, mais le juge n’a finalement pas été récusé sur cette affaire.
Si Garzón n’est pas le héros dépeint par les médias et s’il s’est livré lui aussi à des instrumentalisations politiques, sa destitution dans le cadre du procès Gürtel risque néanmoins d’annuler pour longtemps l’espoir des familles de victimes en quête de réparation.
Mari Carmen Rodriguez