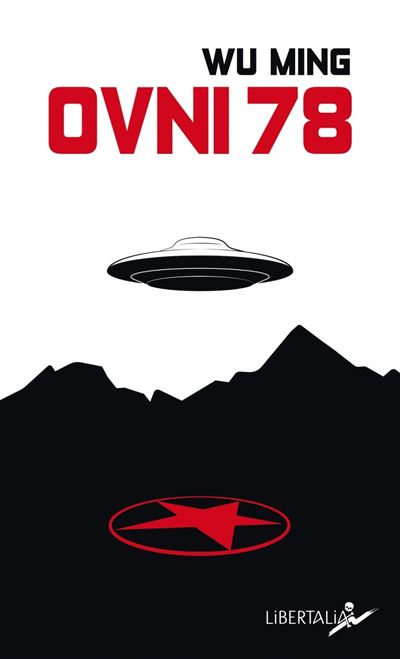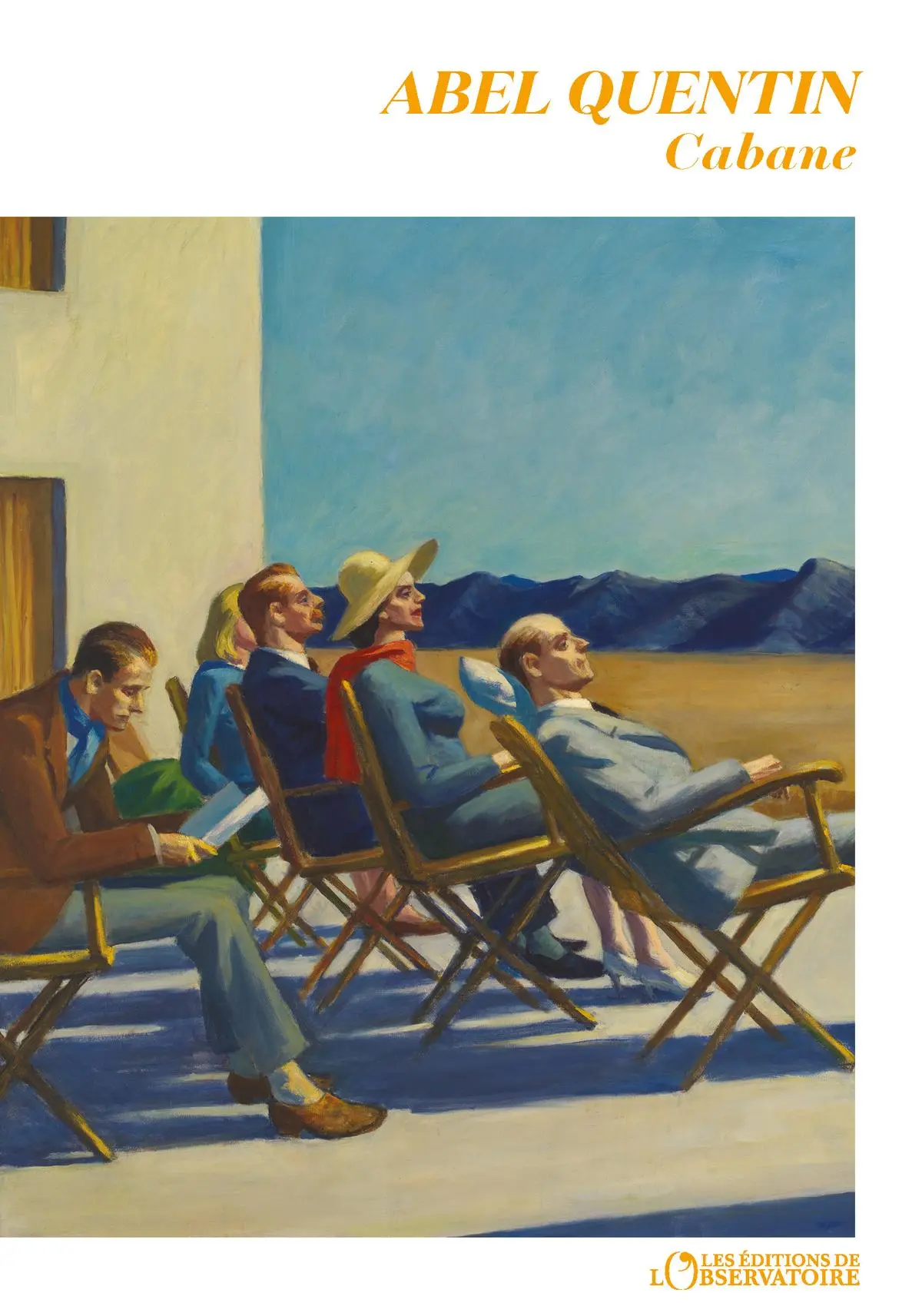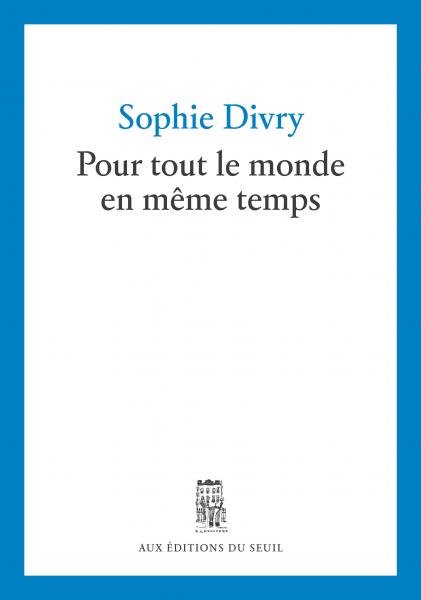Culture en lutte pour l'été
Nos recommandations: cinq romans, deux essais, deux films et un podcast pour occuper vos vacances – si vous en avez!

Romans
Complot ufologique
Dans une Italie en quête d’un «compromis historique», à la veille de l’enlèvement d’Aldo Moro par les Brigades rouges, un écrivain de science-fiction à succès peine à rendre son prochain roman. Une doctorante en anthropologie entame une recherche sur la communauté des ufologues et autres ufophiles. Des scouts disparaissent sur une montagne, à deux pas d’une communauté hippie installée dans l’ancienne demeure d’une marquise collabo.
Le collectif d’auteurs italiens Wu Ming n’est pas à son premier essai sur le complotisme. On lui doit notamment Q comme qomplot (2022) . Mais la focale sur les ovnis peut surprendre: qu’ont à nous dire ces apparitions de soucoupes volantes? Pendant une longue partie du roman, on ne sait pas bien. Mais comme il est extrêmement bien structuré, par le biais d’une palette restreinte de personnages crédibles et complexes, l’on prend plaisir à suivre ceux-ci à Rome, Turin, ou dans les montagnes toscanes.
Et puis, dans un final que nous laisserons aux lecteur·ices le soin de découvrir, les auteurs nous donnent à voir comme le politique n’est jamais bien loin des mythes. GV
Le roman Meadows
Le nouveau roman d’Abel Quentin, Cabane, nous emmène sur le campus de l’université de Berkeley, au début des années 1970. Quatre jeunes chercheur·ses en dynamique des systèmes travaillent sur l’évolution et la prédiction de la population humaine. Il s’agit du fameux rapport Meadows de 1972, pionnier sur les limites physiques de la croissance économique dans un monde fini – rapport qui a d’ailleurs beaucoup de… limites. Leurs résultats sont sans appel, alarmants: si la croissance industrielle et démographique ne ralentit pas, le monde tel qu’on le connaît s’effondrera au cours du 21e siècle, c’est certain. Face à cette découverte dramatique, l’auteur dépeint les réactions que les quatre chercheur·ses adoptent selon leur tempérament. Des comportements qu’on retrouve dans le contexte de dérèglement écologique et climatique actuel.
Entre espoir militant, déni, soif d’argent, folie ou anxiété, ce récit polyphonique alerte sur une catastrophe autrefois imminente, aujourd’hui presque inévitable. Sans jugement individuel, l’auteur nous invite à interroger la société de consommation et ses politiques inactives qui foncent droit dans l’abîme. ZS
Millenials mambo
Après les succès de Conversations entre amis et Normal People, la jeune romancière irlandaise Sally Rooney publie son quatrième roman Intermezzo. L’intermezzo, c’est à la fois l’intermède musical qui vient s’intercaler entre deux parties d’une œuvre et le nom d’un coup aux échecs qui crée une menace impossible à ignorer. Dans le roman, l’intermezzo, c’est le deuil du père; un intermède après lequel plus rien ne sera jamais pareil et durant lequel se révèlent les fragilités des personnages, et aussi les relations entre deux frères, qui s’aiment et se haïssent, qui peinent à anticiper les intermezzos que leur réserve l’existence.
Avec une écriture sensuelle et fine, l’autrice écrit sur l’amitié, l’amour, le rapport au corps, l’argent, le sexe, l’infirmité, la violence, l’anxiété, la dépression et la folie, les relations entre hommes et femmes, sur les luttes de pouvoir et la violence, l’idéologie et les classes sociales, sur la crise climatique, le marxisme et l’anticapitalisme. En sept ans, Sally Rooney est devenue l’analyste littéraire des couples, la théoricienne des relations atypiques de sa génération. JT
Visions du colonialisme
Naïlah, adolescente parisienne, s’apprête à passer un été ennuyeux chez sa grand-mère en Martinique. Pourtant ce voyage se transformera en une aventure pleine de magie. Construit autour de quatre personnages et entre deux époques, le roman d’Isis Labeau-Caberia utilise la petite histoire pour raconter la grande.
Téléportée au 17e siècle, début de la colonisation de l’île, Naïlah y rencontre Funmilayo, une prêtresse yoruba déportée comme esclave, Rozeen une paysanne bretonne avec un statut d’engagée et Nònoum, shamane Kalinago confrontée à la violence des colons. Ensemble, elles devront tenter de sauver l’île, personnage à part entière de ce roman.
Ce récit à quatre voix dévoile les visions et expériences du monde de chacune des héroïnes. C’est grâce à leurs interactions et leurs histoires que sont mis en lumières les mécaniques d’une société coloniale où l’exploitation des êtres humains et de la nature règne en maître.
Cerise sur le gâteau, les codes d’Heroic Fantasy font de ce roman une expérience jouissive, malgré la dureté des thèmes abordées. Ce bijou écoféministe et anticolonial est à mettre entre toutes les mains. MM
Essais
Le covid en commun
«Drôle de temps où on nous dit à la fois: ‹Faites de cookies› et ‹Ce soir, 833 morts›». Tel un pacte noué avec les lecteur·ices pour l’aventure formelle à suivre, Pour tout le monde en même temps s’ouvre sur un mode d’emploi. La première partie est un entrelacement de déclarations gouvernementales, coupures de presse et notes personnelles qui n’est pas sans rappeler le montage de Cinq mains coupées (Seuil, 2020) dans lequel l’autrice composait, avec les témoignages de Gilets Jaunes, un seul et même grand texte sur les violences policières.
La seconde partie du livre est une juxtaposition de souvenirs basée sur une série d’entretiens réalisés avec des proches en 2024, pour «dire l’importance de l’amitié» face au «désagrégement du temps» infligé par le confinement. Ces deux temps de l’écriture renvoient à celui de la réparation car, comme le rappelle l’autrice, «le confinement fut une expérience commune mais pas collective. D’où la répugnance à en parler, qu’on constate autour de nous. On l’a vécu chacun de son côté, comme un trauma, mais pas ensemble comme une grève ou une manifestation…» LV
Philosopher en féministe
La philosophie féministe ne s’intéresse pas seulement aux sujets qui ne concerneraient que les «femmes»: elle représente plutôt une autre manière de faire de la philosophie. Dans ce nouvel ouvrage, Vanina Mozziconacci montre que l’enjeu féministe relatif au savoir philosophique ne réside pas seulement dans les conditions de sa production – largement masculines, comme l’ont montré les philosophes féministes des sciences depuis les années 70 – mais aussi dans leurs conditions de transmission.
Aux pédagogies féministes traditionnelles dont elle montre le caractère à la fois psychologisant et individualisant, la philosophe oppose plutôt une didactique féministe avec une visée de transformation sociale. Celle-ci repose sur une attention constante à la diversité sociale, sexuelle et raciale de celleux qui prennent part au dispositif de transmission – qu’il soit scolaire ou non. La philosophie sert d’exemple privilégié dans le livre, mais la didactique féministe proposée par Vanina Mozziconacci intéressera tou·tes celleux qui cherchent et expérimentent des pratiques pédagogiques émancipatrices. AD
Podcast
Pour en finir avec la culture légitime
L’heure des prololottes est le nouveau podcast de Laurène Marx, autrice, metteuse en scène et actrice trans et non binaire, et Rose Lamy, à qui l’on doit notamment les ouvrages En bons pères de famille et Ascendant beauf. Elles y décortiquent la culture légitime, ses œuvres et ses représentant·es, son bourgeois gaze et son male gaze, son racisme. Et elles le font à partir de leur expérience située, dans laquelle nombreux·ses d’entre nous peuvent se reconnaitre. Celle de deux personnes qui ont pu aimer et apprécier ces œuvres et ces artistes par le passé et qui les voient aujourd’hui comme des outils de reproduction de la domination et de la violence classiste, patriarcale et raciale.
Les thématiques abordées n’ont rien de drôle ou de divertissante, mais Lauren Marx et Rose Lamy les traitent avec sensibilité, humour et une bonne dose de sarcasme. Surtout, elles révèlent très bien l’absurdité et l’impunité de cette culture légitime où les dominant·es se parlent entre elleux et se protègent les un·es les autres. Elles nous donnent envie de nous en détacher une bonne fois pour toute. NR
→ À écouter sur la plupart des plateformes
Films

Hôpital cantonal’s anatomy
En suivant la journée de travail d’une infirmière, interprétée par la brillante Leonie Benesch, le nouveau long métrage de Petra Biondina Volpe – réalisatrice de l’Ordre divin – se veut un réel cri d’alarme sur les conditions du personnel hospitalier en Suisse.
Dans une intense montée en tension maîtrisée à la perfection, orchestrée par son montage millimétré, sa caméra plongée au plus proche des souffrances et son travail sonore/musical anxiogène, le film dénonce les coupes budgétaires et les privatisations libérales au sein du système hospitalier.
Une œuvre d’une forte intensité réussissant à émouvoir aux larmes dans sa variété des situations montrées, que ce soit des travailleuses·eurs qui doivent se battre malgré le manque de personnel pour mener à bien leur mission de soins, mais aussi les patient·es qui subissent de manière inhumaine le manque de moyens.
En bref, une œuvre filmique helvétique bien trop rare qui mélange finesse de la mise en scène et grande justesse dans le propos. Un immanquable de l’été. LC
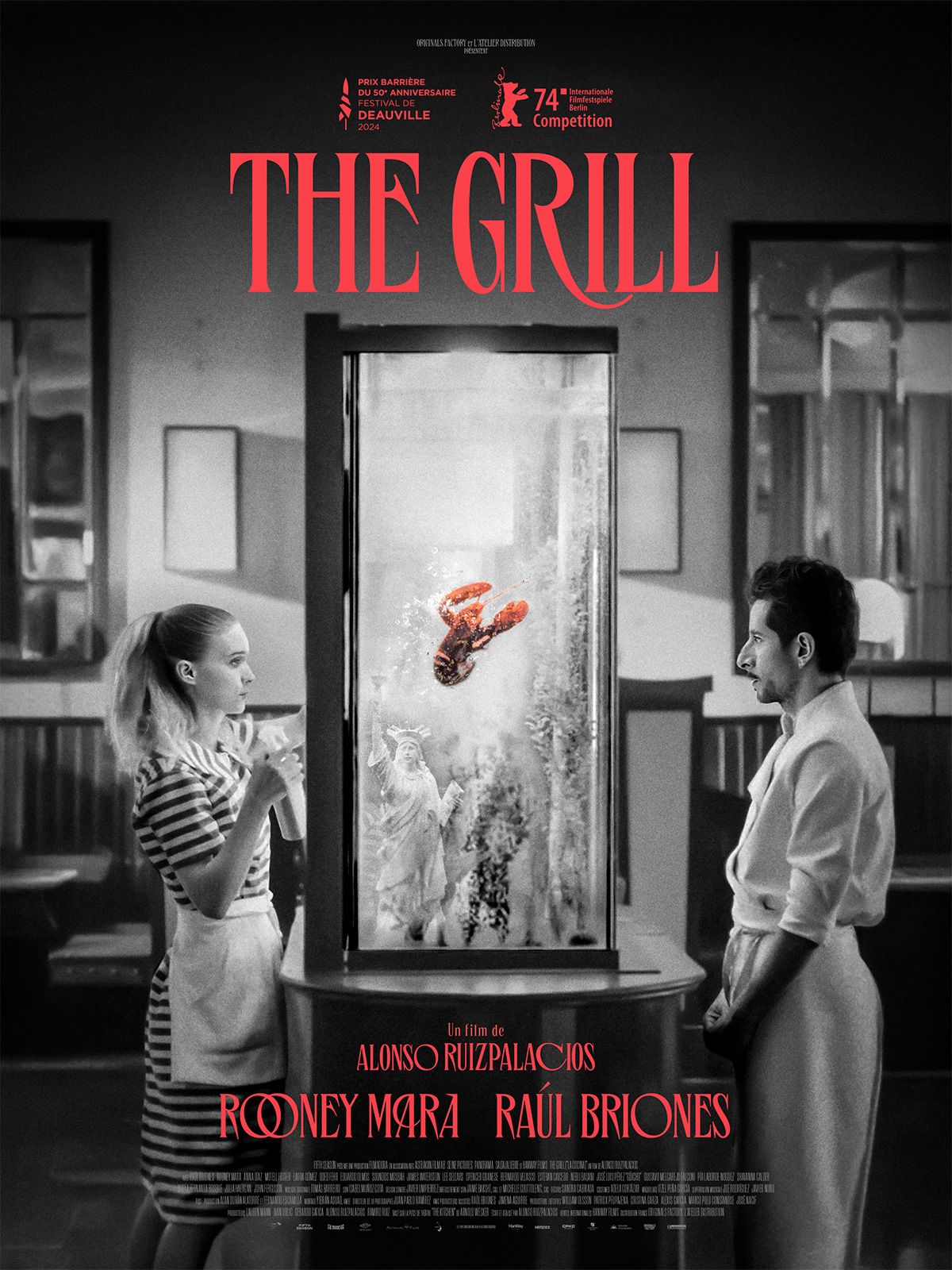
La cuisine de la Précarité
Connu pour ses longs métrages Güeros et Museo mais aussi pour la réalisation d’épisodes d’Andor et de Narcos, Alonso Ruizpalacios signe une adaptation de la pièce The Kitchen (1957) du dramaturge anglais Arnold Wesker. Montée par le Théâtre du soleil à Paris, en 1967, la pièce avait fait grand bruit. On pouvait alors lire dans la feuille de salle «Arnold Wesker n’idéalise pas les travailleurs. (…) La Cuisine est une pièce écrite sans revendication, sans protestation, sans prise de position simpliste. C’est une pièce sur la dignité humaine (…)» La description reste d’actualité pour ce film choral, tout en plans séquences, à la chorégraphie minutieuse, shooté dans un magnifique noir et blanc.
L’image prenant le dessus sur le dialogue, c’est par les sensations que nous recevons le rush aliénant d’un restaurant new-yorkais. Nous suivons une nouvelle employée, sans-papier comme la plupart de ses collègues, tout au long de sa première journée de travail. On parcourt ainsi les lignes de tensions qui font le présent des travailleur·ses les plus précaires. LV