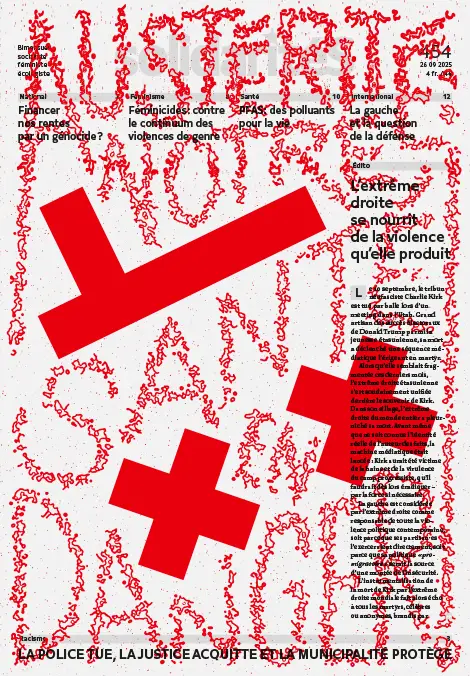PFAS: des polluants pour la vie
Les substances per- et polyfluoroalkylées, connues d’après leur acronyme PFAS, constituent une famille de molécules privilégiée par l’industrie. Ces dernières sont pointées du doigt pour leur toxicité et leur omniprésence dans l’environnement. Malgré une étude pilote aux résultats alarmants, la Confédération a décidé d’annuler son projet d’étude longitudinale concernant les effets de ces substances sur la santé de la population.

Les PFAS représentent une large famille de molécules – plus de 10000 recensées – caractérisées par la présence d’au moins une liaison carbone–fluor, particulièrement stable, qui confère à cette catégorie sa qualification de «polluant éternel» du fait de la difficulté à les dégrader, que ce soit par le métabolisme animal ou humain, ou des procédés techniques d’élimination des déchets. Mais comment en est-on arrivé à retrouver des PFAS jusqu’en Antarctique?
Les PFAS, favorites de l’industrie
Les PFAS présentent toute une série de caractéristiques qui les rendent très attractives. Leurs propriétés émulsifiantes, antiadhésives, ignifuges (qui empêche ou retarde l’inflammation), imperméabilisantes (contre l’eau et les matières grasses) en font des substances de choix pour toute une gamme de produits. On les retrouve ainsi dans les poêles en Teflon, les mousses anti-incendie, les emballages alimentaires et les textiles antitaches et imperméables (Gore-tex p.ex.). On les retrouve également dans de nombreux secteurs et procédés industriels: moulage des métaux, caoutchouc, plastiques, polymères, semi-conducteurs, etc…
C’est à partir des années 1950 qu’on voit apparaitre, puis se répandre, ces molécules dans l’industrie. Tout comme pour les grandes firmes du tabac, certaines entreprises découvrent la toxicité des PFAS qu’elles emploient mais maintiennent, durant plusieurs décennies, une chape de plomb sur leurs résultats. Dès 1961, le chef en toxicologie de la multinationale DuPont relève les effets toxiques sur les foies de rats exposés, même à très faible doses, de certains PFAS. À la même période, un travailleur de cette entreprise décède suite à une exposition aigüe aux PFAS. Des incidents similaires se répéteront au cours des années sans que la question de la pollution et de l’intoxication aux PFAS ne soit mise à l’agenda. Ce n’est qu’à partir des années 2010 que le sujet commence à être médiatisé massivement.
Quel danger pour la santé?
Du fait de la grande quantité de molécules présentes simultanément, de l’exposition faible mais constante et des effets à long termes (et souvent multifactoriels) de ces molécules, il est difficile d’établir clairement des liens de causalité entre une exposition et le développement subséquent de maladies.
Néanmoins, divers troubles résultant d’une exposition aux PFAS sont d’ores et déjà bien documentés. Ces derniers regroupent des troubles thyroïdiens, des taux de cholestérol anormalement élevés, des dommages hépatiques (foie), des cancers du rein et des testicules. Les PFAS affectent également la grossesse et le fœtus et induisent un développement retardé des glandes mammaires, une réponse immunitaire réduite à la vaccination et un faible poids à la naissance.
De nombreux autres effets présumés sont documentés sans qu’il existe à ce jour des résultats permettant de les affirmer avec certitude. Concernant l’exposition, cette dernière varie en fonction du degré de pollution du lieu de résidence. Certains hotspots (lieux présentant des concentrations élevées) sont fréquents aux abords de certains sites industriels, de sites d’entrainement contre les incendies, des décharges et dans les eaux usées. On en trouve également dans certains produits phytosanitaires qui sont ensuite pulvérisés sur les terres agricoles.
Solubles dans l’eau, les PFAS se retrouvent en grande quantité dans les étendues d’eau et nappes phréatiques à proximité des lieux cités précédemment. Ces molécules affectent évidemment également la faune et se bioaccumulent (accumulation progressive dans les tissus d’un organisme vivant) dans de nombreuses espèces au long de la chaîne alimentaire. Différents troubles immunitaires, hormonaux et de la reproduction ont été documentés chez certaines espèces exposées.
Quelles solutions?
Ces dernières années, plusieurs PFAS ont été frappés d’interdiction ou soumis à des restrictions. Pour autant, ces dernières visent quelques molécules ou dizaines de molécules et ne s’appliquent pas à une interdiction générale de ces substances.
La solution pour l’industrie? Remplacer les substances interdites par… d’autres PFAS dont la toxicité n’est pas encore établie et les présenter comme des alternatives «sûres». Pourtant, le consensus scientifique est clair. Un document de l’académie suisse des sciences naturelles préconise ainsi le remplacement, à long terme, de tous les usages possibles des PFAS.
À court terme, il est conseillé de remplacer les PFAS là où des alternatives existent (16% des cas aujourd’hui), d’accélérer le développement de substituts et d’étudier la présence et l’impact des PFAS sur l’environnement et la population suisse.
À moyen terme, l’académie conseille notamment de dépolluer les hotspots du pays. Récemment, des estimations ont donné une fourchette du coût de décontamination variable entre 1 à 26 milliards de francs pour les 20 prochaines années. Le bas de la fourchette correspond à un scénario où la pollution s’arrête complètement dès aujourd’hui et où seuls les sites les plus contaminés sont traités. Le scénario à 26 milliards prend en compte une utilisation maintenue des PFAS en Suisse. C’est bien vers ce second scénario que l’on se dirige.
Où va la Suisse?
Malgré ces constats inquiétants, le pouvoir politique helvétique ne semble pas pressé d’agir. En août 2023, les résultats d’une étude pilote sur la biosurveillance étaient publiés. Parmi les substances étudiées figuraient plusieurs PFAS. 789 adultes des cantons de Berne et de Vaud ont été testé·es pour établir la présence d’un panel de molécules (dont 30 PFAS) dans leur organisme. Plusieurs PFAS (PFOA, PFHxS, PFOS) ont été retrouvés dans le sang de tous les participant·es de l’étude et d’autres à de hauts pourcentages (PFNA 99,6%, PFDA 90,9%, PFHpS 87,9%, PFUnDA 51,2%). Parmi les 23 autres PFAS testés, certains (n=9) sont détectés dans une minorité des individus (0,1-4,8%) et d’autres (n=14) pas du tout.
Pour le PFOS, 3,6% des individus dépassaient le seuil au-dessus duquel des effets potentiels sur la santé sont attendus. Pour le reste des PFAS détectés, l’absence de données sur des seuils de santé ne découle évidemment pas de leur innocuité mais du manque de connaissance. On ne peut donc pas exclure, sur la base de cette étude, qu’une partie de la population suisse soit exposée à des seuils dangereux pour d’autres PFAS.
La principale conclusion à tirer est le besoin de faire de nouvelles études plus ambitieuses et qui suivent la population sur le long terme. C’est d’ailleurs ce qui avait été prévu par la confédération dans «l’Etude suisse sur la santé», un suivi longitudinal sur 20 ans de 100000 volontaires pour de nombreux polluants (PFAS, métaux lourds, glyphosate). Pourtant, le 2 septembre 2025, la RTS annonçait que ce projet était finalement abandonné du fait de son coût jugé trop élevé. Cette dernière aurait en effet coûté 12 millions de francs par an, soit 240 millions sur 20 ans. Deux jours plus tard, le 4 septembre, on apprenait de Martin Pfister, Conseiller fédéral à la défense, que la Suisse maintiendrait son achat de 6 drones, à l’entreprise israélienne Elbit Systems, notamment parce que la somme de 240 millions de francs déjà engagée ne pourrait probablement pas être remboursée…
À défaut de se donner les moyens de connaitre la santé de sa population, la Suisse pourra dormir sur ses deux oreilles sachant que son espace aérien est surveillé (à l’exception des jours de givre) par des drones (escortés par des hélicoptères) et que l’argent public aura été envoyé à une entreprise participant au génocide à Gaza.
Session spéciale
Le 9 septembre dernier, le Conseil national a tenu une session extraordinaire sur les PFAS. Le Conseil fédéral, complètement apathique sur les PFAS (comme sur tout le reste) et estimant que la Suisse en fait déjà suffisamment en la matière (comme toujours), a systématiquement appelé à rejeter les motions débattues. Le Conseil national en a néanmoins adopté certaines.
Sur les huit motions examinées, les trois qui étaient contraignantes ont été refusées. Aucune diminution à court (voire moyen) terme n’est donc exigée dans l’usage des PFAS. De même, la proposition de créer une taxe à la source sur les PFAS pour alimenter un fonds destiné à couvrir les coûts engendrés par l’utilisation de ces molécules a été refusé.
Parmi les mesures adoptées, on trouve une obligation de déclaration dans les produits contenant des PFAS et l’établissement de valeurs limites pour les PFAS qui tiennent compte de la santé – mais qui pourront être dépassées par l’industrie et l’agriculture si les réprésentant·es de ces dernières participent à des mesures de réduction.
La reprise automatique des prescriptions européennes en matière d’eau potable a été écartée, jugées «pas appropriées aux conditions suisses» (comprendre : trop contraignantes). Le Conseil fédéral sera chargé de définir les valeurs limites pour les PFAS en tenant compte de la santé mais également des «conséquences économiques». Lorsque les seuils pour la santé sont dépassés, il suffit de les élever!
Autre tour de magie helvétique, les produits alimentaires contaminés par des PFAS pourront quand même être vendus, à condition d’être mélangés avec des produits non contaminés pour ne pas dépasser les seuils. Cette possibilité découle de la situation de certaines exploitations agricoles du canton de Saint-Gall. En août 2024, des analyses révélaient la présence, à des concentrations beaucoup plus élevées que la moyenne, de PFAS dans la viande et le lait issues de certaines communes. En cause, l’utilisation, jusqu’en 2006, des boues d’épuration comme engrais. Non traitées, celles-ci sont particulièrement riches en PFAS, car elles concentrent le contenu de tous les déchets.
Après la découverte de valeurs trop élevées dans la viande de quinze entreprises et dans les œufs de cinq autres, les autorités cantonales ont décidé, en toute logique, de n’émettre aucune interdiction de vente. La solution? Tolérer l’excès de PFAS si les entreprises participent à la diminution ou bien mélanger les produits contaminés avec d’autres pour réduire les taux. Même le lobby Proviande, soucieux de l’image publique de ses produits, a émis une critique face à cette alchimie de comptoir. Ainsi, quand un canton innove, la Confédération a suffisamment de flair pour reprendre ses solutions! La situation pourrait faire rire, tellement elle est ubuesque, si cela ne concernait pas les produits qui se retrouveront dans nos organismes ces prochaines années.
Les perspectives ne sont donc pas réjouissantes: pas de suivi de santé, pas de réductions, valeurs seuil trafiquées… Bienvenue en Suisse!
Clément Bindschaedler