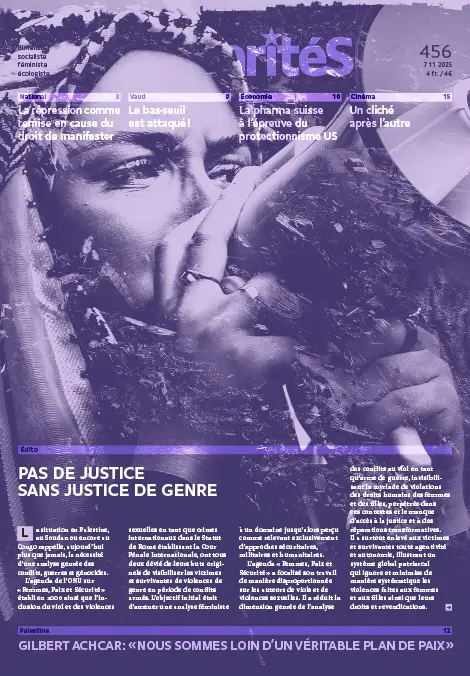Chèque en blanc et fuite en avant
Le Conseil d’État neuchâtelois a présenté le 23 octobre une dépense extraordinaire pour son budget 2026. Un fonds de près de 8 millions de francs, que la cheffe du DECS Florence Nater présente comme une aide aux industries confrontées aux hausses de droits de douane décrétées par Donald Trump.

Sous couvert de préserver « l’employabilité des travailleurs », des employeur·ses pourront solliciter ce fonds extraordinaire pour « diversifier, innover, mettre une technologie sur le marché ». Rien de vraiment « innovant » pour le patronat. Après la prolongation jusqu’à 24 mois des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) décidée par le Conseil fédéral, voilà que des aides cantonales sont mises en avant.
L’occasion était toute trouvée pour les patron·nes et leurs associations d’exiger de nouvelles aides, agitant dans un scénario du pire un chômage de 10 % dans le canton en 2026.
Déjà que les lamentations n’ont pas manqué ces dernières années (franc fort, inflation des prix de l’énergie, impôts élevés), tous les prétextes sont avancés pour refuser les revendications du monde du travail : hausse et indexation des salaires.
Des années rutilantes pour les capitalistes
Cependant, l’envolée des commandes et des profits ces 25 dernières années (si l’on excepte la période du covid) était bien réelle. Dans l’horlogerie par exemple, la hausse des exportations a été de 152 % selon les chiffres de la Fédération horlogère. Les salaires ont-ils suivi la même tendance ? Dans le canton, selon l’Office fédéral de la statistique, les salaires bruts médians ont stagné entre 2016 et 2020, après avoir fait le même sur place entre 2010 et 2014. Dans le secteur secondaire, ils ont même régressé. Ces données offrent un autre visage de la réalité sociale. Lorsque les exportations s’envolent, les travailleur·ses ne récoltent même pas des miettes, et la répartition des bénéfices reste dans la sphère des possédant·es.
Selon un sondage réalisé par UNIA fin 2019 dans la branche de l’horlogerie, représentatif selon ce syndicat (65 % des réponses venaient d’ouvrier·es dans la production), les salaires n’étaient pas mirobolants. Le salaire médian était d’environ 5000 francs par mois, plus de la moitié se trouvant en dessous. Encore pire, 12 % étaient inférieurs à 4000 francs par mois, et concernaient dans l’écrasante majorité des salaires féminins (82 %) ! Des salaires en-dessous du salaire minimum cantonal donc, car son inscription dans la loi ne garantit pas son application sur le terrain !
Tout n’est pas taxé à 39 %
Par ailleurs, le quotidien neuchâtelois ArcInfo s’est livré à une comparaison instructive. Selon une étude sur la composition sur le PIB romand, publiée le 22 octobre, l’effet de la taxe de 39 % imposée pour les importations suisses aux États-Unis est assez disparate selon les cantons. Cette étude met en parallèle la taxe moyenne selon le type de marchandises exportées. Il apparaît alors que tout n’est pas taxé à 39 %, car il faut pondérer cette valeur par la proportion de métaux précieux et des produits pharmaceutiques contenus dans les exportations cantonales. Comme ces deux secteurs ne sont pas touchés pour l’instant par les droits de douane, l’impact estimé des taxes douanières est sensiblement modifié.
Pour le canton de Neuchâtel, la taxe moyenne est ainsi de 17,7 %, Genève est à 26 %, Fribourg à 31 %, Vaud à 32 % et le Jura à 34 %. Il apparaît ainsi que le canton de Neuchâtel est le moins taxé, alors même que les États-Unis ont représenté la destination de produits neuchâtelois à hauteur de 38 % pour l’année 2024.
Pour une reconversion industrielle écosocialiste
Ces lamentations patronales ont produit leur effet immédiatement, et ont rencontré une oreille attentive du gouvernement. Or ce fonds ressemble fort à un chèque en blanc et à une fuite en avant. Faut-il vraiment « innover » dans l’industrie du luxe et de l’exportation ?
Les incertitudes quant au futur économique de la région devraient entraîner des réflexions plus fondamentales : sortir de l’industrie d’exportation, reconversion industrielle de type écosocialiste permettant de répondre à la transition énergétique (énergies renouvelables) et à la justice sociale (des emplois qualifiés et durables). Permettre aux capitalistes de définir « l’innovation » et la « diversification », c’est s’exposer aux aléas économiques, aux restructurations destructrices d’emplois, à la précarité justifiée par la concurrence locale et mondiale.
Si un fonds public devait être créé pour permettre une reconversion industrielle, deux conditions devraient au moins figurer. Le financement devrait être fourni par tous les grands groupes horlogers et pharmaceutiques qui ont largement bénéficié de la croissance des exportations vers les États-Unis ces 20 dernières années. L’innovation et la diversification devraient être réelles et répondre à des politiques répondant à des considérations sociales et écologiques à moyen terme. Par exemple, dans le secteur de l’énergie solaire, pour concevoir, produire, installer, maintenir des installations produisant de l’énergie électrique, afin de remplacer les sources fossiles et proposer un large spectre de métiers qualifiés et socialement utiles.
José Sanchez