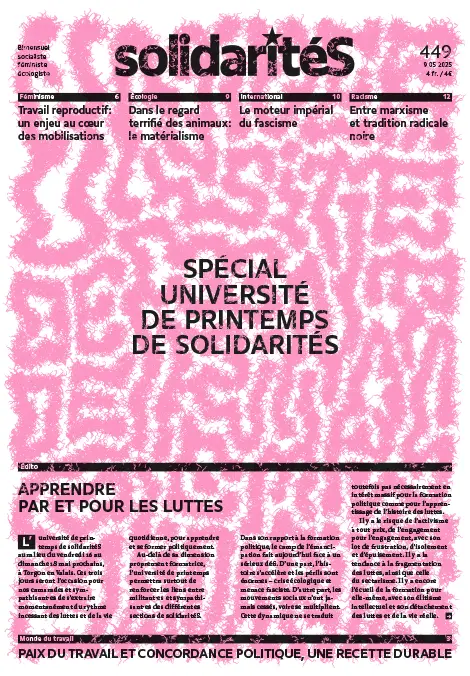Paix du travail et concordance politique, une recette durable
Un atelier de notre université de printemps 2025 aura pour thème «politiques patronales en matière de salaires et réponses syndicales». Quelques questions à notre camarade José Sanchez pour présenter ce sujet. Il a milité dans le syndicat FTMH (ancêtre d’UNIA) et a été membre d’une opposition interne connue sous le nom de «Manifeste 77», puis il a rejoint le SSP dont il fut un président de la région Neuchâtel et membre du Comité national. Son parcours syndical s’est aussi étoffé avec une activité de juge prud’homme sur 20 ans dans le secteur de l’industrie.

Que peut-on dire de la situation des syndicats en Suisse?
Comme dans d’autres pays, le mouvement syndical a été affaibli par les différentes crises économiques et le chômage de masse qui s’est installé. Les politiques de dérégulation, de démantèlement des droits des travailleur·ses aussi bien dans le secteur privé que public ont contribué à réduire les effectifs et la visibilité des syndicats. Après chaque crise, le chômage résiduel était en augmentation, favorisant chaque fois une précarité accrue. La mondialisation a produit une concurrence entre salarié·es de nombreux pays et a introduit massivement des modifications structurelles dans le monde du travail (type de contrats, précarité des emplois et des salaires).
La dégradation des conditions dans le monde du travail s’est installée comme une fatalité. Que le canton de Neuchâtel (région très industrielle et exportatrice) compte 15% de sa population en situation de pauvreté ne fait pas la une du 19h30. Mais dans le paradis helvétique, d’autres facteurs structurels jouent aussi un rôle majeur.
Quels sont ces autres facteurs structurels de l’affaiblissement du mouvement syndical?
En Suisse, il y a deux particularités majeures qui ont accentué cet affaiblissement. Ce sont les deux faces d’une même pièce, l’attachement à une politique active de collaboration de classe.
Il s’agit en premier lieu des coalitions politiques existant à différents échelons institutionnels, y compris national. C’est la plus visible et la plus médiatisée des politiques de concordances sociales. La gauche gouvernementale approuve et couvre des politiques d’austérité et de démantèlement dans beaucoup de domaines (assurance-chômage, assurances sociales, droit du travail, etc). Les conséquences ne touchent pas seulement les employé·es du secteur public, mais l’ensemble des classes travailleuses.
Quel pays européen peut se prévaloir d’un gouvernement national avec la même composition depuis 1959? Cette stabilité donne un avantage décisif aux forces capitalistes pour réduire le prix de la force de travail. Exemple caricatural, c’est un conseiller fédéral membre du PSS qui a vendu l’escroquerie du deuxième pilier. Et la liste est très longue!
Le deuxième facteur décisif pour l’ensemble de la bourgeoisie suisse est l’existence de la «paix du travail» entre les organisations patronales et syndicales dans la majorité des secteurs économiques, et qui précède (1937) la présence du PSS au Conseil fédéral.
Le renoncement à des mesures de lutte sur le lieu de travail ne permet pas de «négocier» avec un rapport de force suffisant et de tenir tête aux attaques patronales. Cela se traduit par une conception bourgeoise de la société et des rapports salariaux. La primauté, ce sont les intérêts des capitalistes, présentés comme défendant «l’intérêt général». La défense de «notre économie» (sic!) est au cœur de ce consensus, ce qui implique une subordination complète des intérêts vitaux des classes populaires, le maintien des salaires réels, des emplois ou des salaires indirects pour la vieillesse par exemple.
Bien entendu, l’existence de la «paix du travail» dans le domaine conventionnel ne va pas effacer les confrontations et éviter les conflits sociaux. Mais ceux-ci restent trop souvent isolés et résultent de circonstances particulières (mécontentement aigu, noyau syndical atypique et combatif).
Ainsi les mouvements revendicatifs d’ensemble sont rares. Néanmoins, il faut saluer le mouvement féministe pour avoir déclenché, en 1991, la première grève des femmes, puis ces dernières années les grèves féministes, comme des mouvements remarquables, par leur étendue nationale et par la radicalité de leurs revendications. Elles ont montré un chemin à suivre.
Des lueurs d’espoir dans cet environnement?
Rejoindre un syndicat (en y adhérant, voire en y exerçant des fonctions de secrétaire permanent) est nécessaire mais insuffisant. Pour tenter de surmonter certaines de ces difficultés, la mise sur pied d’une coordination interprofessionnelle permanente de militant·es syndicaux·ales au niveau national serait souhaitable et serait un premier pas pour regrouper des forces syndicales avec un horizon dépassant la seule entreprise, branche ou canton.
Une telle coordination permettrait de surmonter l’épuisement et l’isolement dans les fédérations actuelles. Au cours d’une ou deux rencontres annuelles, les participant·es pourraient échanger sur des luttes en cours ou en devenir, de préparer des échéances (congrès ou assemblées syndicales), d’intervenir sur des conflits ou sur des manifestations importantes (par exemple aux manifestations sur les salaires organisées par l’USS), de produire de manière collective des réflexions sur des sujets en cours. Améliorer l’organisation des forces critiques est un pas nécessaire pour contester la paix sociale et ses conséquences.
Propos recueillis par la rédaction