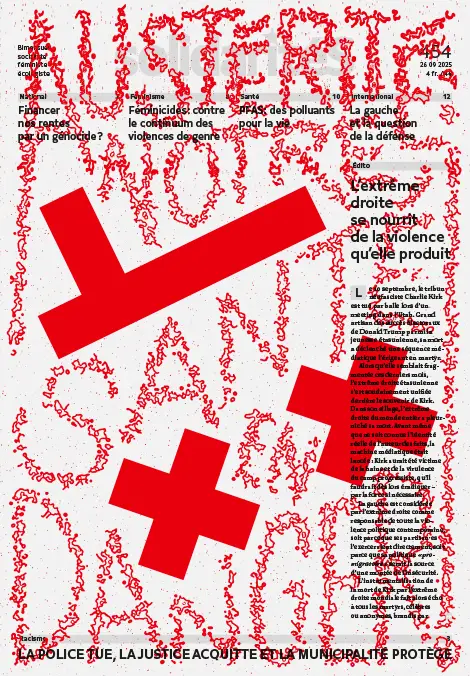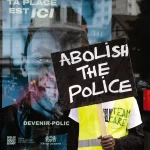Féminicides
Sortir de l’impuissance et lutter contre le continuum des violences de genre
L’année 2025 se caractérise par un déchainement meurtrier de la violence patriarcale en Suisse. Face à l’ampleur dramatique des féminicides, comment sortir de l’impuissance, penser et lutter contre la violence de genre dans sa totalité?

Depuis le début de l’année 2025, la Suisse a connu un nombre dramatiquement élevé de féminicides. Vingt-quatre meurtres de femmes et de filles en raison de leur genre ont été décomptés par la plateforme de recherche Stop Femizid ; soit un féminicide tous les dix jours. Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis le début du décompte annuel, en 2020 et il est probablement inférieur à la réalité. Neuf tentatives de féminicides ont également été relevées par la plateforme. Ce décompte repose sur un travail militant d’analyse des contenus de presse et des rapports de police. À l’heure actuelle, aucun organe officiel ne produit de données et de statistiques spécifiques aux féminicides en Suisse.
Des politiques publiques insuffisantes
En avril 2025, la Confédération annonçait que la mise en œuvre du numéro d’urgence pour les victimes de violence domestique était repoussée de six mois, pour cause de manque de «bases légales nécessaires» et de la «complexité technique accrue du projet». Il n’entrera en vigueur qu’en mai 2026. Rappelons que ce numéro représente l’une des mesures du plan national de lutte contre les violences, exigé par les collectifs de la Grève féministe depuis 2019. Il s’inscrit aussi dans le paquet de mesures rattachées à la convention du Conseil d’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique – aussi connue sous le nom de convention d’Istanbul – adoptée par la Suisse en 2018.
Un plan d’application national de cette convention, comportant quarante-quatre mesures, existe depuis 2022. Il est coordonné au niveau fédéral par le Bureau de l’égalité mais sa mise en œuvre concrète dépend des cantons.
Au mois de juin 2025, alors que le nombre de féminicides s’élevait à dix-huit, le comité responsable de la convention d’Istanbul en Suisse s’est réuni pour définir des mesures urgentes pour tenter d’endiguer cette vague meurtrière. Il a engagé la Confédération, les cantons et les communes à trouver des solutions régionales pour combler le manque de places dans les refuges et maisons d’accueil pour victimes, et insisté sur le renforcement de la prévention des violences conjugales et domestiques durant les phases de séparation, notamment par une meilleure formation des professionnel·les.
Ces mesures s’inscrivent dans la continuité de l’action publique qui se développe depuis plusieurs années autour de la thématique de la violence domestique et plus largement de réformes législatives ayant trait aux violences sexistes et sexuelles. En 2023 par exemple, le Parlement a adopté une révision du droit pénal en matière sexuelle qui supprimait la notion de contrainte dans la qualification des viols et des contraintes sexuelles et introduisait le refus de la victime, ainsi que l’état de sidération, comme facteurs permettant la caractérisation pénale du viol.
C’est un fait, les mobilisations féministes qui traversent notre pays depuis 2019 ont donné une visibilité nouvelle à la problématique des violences sexistes et sexuelles (VSS) dans l’espace politique, médiatique et plus largement dans la société suisse. Ces mobilisations, couplées à une dynamique plus large, européenne et internationale, d’élaboration d’un cadre d’action contre les violences faites aux femmes et la violence domestique – dont la convention d’Istanbul est le produit – ont entrainé des changements sur les plans légaux et de politiques publiques. Des changements, certes, mais qui demeurent largement insuffisants, notamment pour des questions de manque de moyens financiers.
Contre la particularisation et la hiérarchisation de la violence de genre
En tant que militantes féministes nous ressentons une forme d’impuissance, nouée à notre colère. Nos appels répétés à une augmentation conséquente et durable des moyens alloués à la lutte contre ces violences demeurent sans réponse. Tandis que les chiffres macabres recensés par la plateforme Stop Femizid démontrent que les violences de genre ne diminuent pas en Suisse, loin de là. Comment sortir de cette impuissance? Comment sortir d’une dynamique où nous nous évertuons à formuler des demandes à des autorités politiques qui ne prennent toujours pas la mesure de la gravité de la situation?
Depuis plusieurs années, des militantes et théoriciennes féministes, mobilisées principalement en Amérique Centrale et Latine, soulignent les limites d’une analyse des violences de genre qui se concentre uniquement sur celles qui se produisent dans la sphère privée et domestique et néglige ainsi d’autres formes de violences qui engagent plus directement la responsabilité de l’État. Elles incitent à repenser la violence de genre comme un outil transversal permettant la production et la reproduction de la domination patriarcale, mais aussi capitaliste et raciale, dans tous les espaces sociaux.
Leurs analyses s’inscrivent dans un contexte bien précis et très différent de la Suisse – où nombre de féminicides sont le fait de groupes paramilitaires et narco-trafiquants qui bénéficient d’une impunité totale dans des zones de maquiladoras à la frontière entre le Mexique et les États-Unis – mais elles entrent en écho avec d’autres réflexions, notamment celle élaborée par la professeure de psychologie sociale Patrizia Romito dans un ouvrage datant de 2006, Un silence de mortes. La violence masculine occultée.
Romito avance notamment l’idée que la séparation et la particularisation des différents types de violence de genre les uns par rapport aux autres a pour effet de masquer la dynamique structurelle qui les lient. Elle argumente pour une approche théorique et pratique de la violence de genre comme une réalité sociale transversale, qu’il ne s’agit pas de diviser en sous-champs pour lesquels développer des plans d’action spécifiques. Patrizia Romito identifie aussi les cadres légaux – élaborés dans le cadre de la progressive constitution des violences faites aux femmes comme problème public depuis les années 1980 – comme des outils permettant une invisibilisation de la dimension politique de la violence patriarcale, par des tactiques de psychologisation et de naturalisation des expressions de cette violence.
Sortir de l’impuissance, repenser la lutte féministe contre les violences
Ces analyses ouvrent des portes qui pourraient constituer autant de pistes pour repenser, depuis le mouvement féministe, la lutte contre les violences de genre dans le contexte helvétique. Elles nous poussent à repartir d’une appréhension de la violence de genre comme expression d’une domination systémique prenant des formes multiples, dont la violence domestique ne représente qu’un avatar. Elles nous incitent notamment à constater qu’en Suisse, les cadres qui définissent la lutte contre différentes formes de violence de genre sont multiples.
La convention d’Istanbul touche à la violence faites aux femmes et à la violence domestique à l’échelle fédérale, mais sa mise en œuvre concrète dépend des cantons. Certains d’entre eux disposent par exemple de lois spécifiques à la lutte contre les violences domestiques.
Le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, lui, est qualifié comme discrimination au sens de la loi sur l’égalité (LEG) depuis 1996.
Le statut et les droits des victimes sont encadrés depuis 1993 par la loi sur l’aide aux victimes (LAVI), qui n’est pas spécifique aux violences de genre mais concerne toutes les victimes d’infractions pénales.
Comme mentionné ci-dessus, les définitions et peines appliquées à des affaires de viols ou de contraintes sexuelles sont encadrées par le droit pénal en matière sexuelle.
Une multiplication de référentiels donc, dont résulte une fragmentation des qualifications et des stratégies de prise en charge. Sans parler des initiatives pour combattre des phénomènes comme le harcèlement de rue, dénoncées pour l’agenda sécuritaire et raciste qu’elles charrient bien souvent. Sans parler non plus des formes de violence de genre qui ne disposent d’aucune reconnaissance légale, à l’image de la transphobie.
La focale actuelle sur les violences qui se produisent dans l’espace domestique se justifie au vu de la prégnance de ce type de violence dans les statistiques dont nous disposons. Elle se justifie aussi parce que la reconnaissance de la sphère privée, et des actes de violences qui s’y produisent, comme des problèmes publics nécessitant une prise en charge collective représente une victoire historique du mouvement féministe. Il ne s’agit donc pas d’abandonner cette thématique des violences domestiques et de renoncer aux revendications actuelles et urgentes comme le plan national de lutte, l’ouverture du numéro d’urgence, l’amélioration de la formation des professionnel·les en première ligne dans le constat de ces violences et l’accueil des victimes, ou encore le renforcement et la pérennisation des financements des refuges et maisons d’accueil.
Mais en amont, une proposition pratique pour sortir de l’impuissance que nous ressentons face à l’escalade des féminicides en Suisse pourrait consister à élaborer une stratégie ayant pour horizon une lutte convergente et uniformisée contre toutes les formes de violence de genre.
Une lutte qui revendique la fin du traitement différencié des violences selon les espaces sociaux où elles se produisent: à la maison, au travail ou dans l’espace public.
Une lutte qui thématise la responsabilité des autorités politiques et judiciaires dans le maintien de cette division, de la hiérarchisation des types de violence contre lesquels il s’agit de lutter en priorité et de la particularisation des moyens qui sont envisagés pour cette lutte selon la position des auteurs supposés au sein des rapports sociaux de race et de classe.
Une lutte qui refuse l’instrumentalisation raciste et l’appropriation de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles par des organisations et figures publiques d’extrême droite et leur allié·es politiques, toujours plus nombreux·ses.
Une lutte finalement qui cherche à tisser et renforcer les liens avec d’autres collectifs militants eux aussi mobilisés contre des violences résultant de dominations systémiques, et pour lesquelles l’État et ses institutions portent une lourde responsabilité, à l’image des violences policières racistes.
Noémie Rentsch