Mettre fin au compromis technologique
Face aux évolutions techniques, la gauche et les syndicats ont souvent tenté de négocier un «compromis technologique» avec le capital: obtenir une partie des gains de productivité. C’est une stratégie à courte vue…
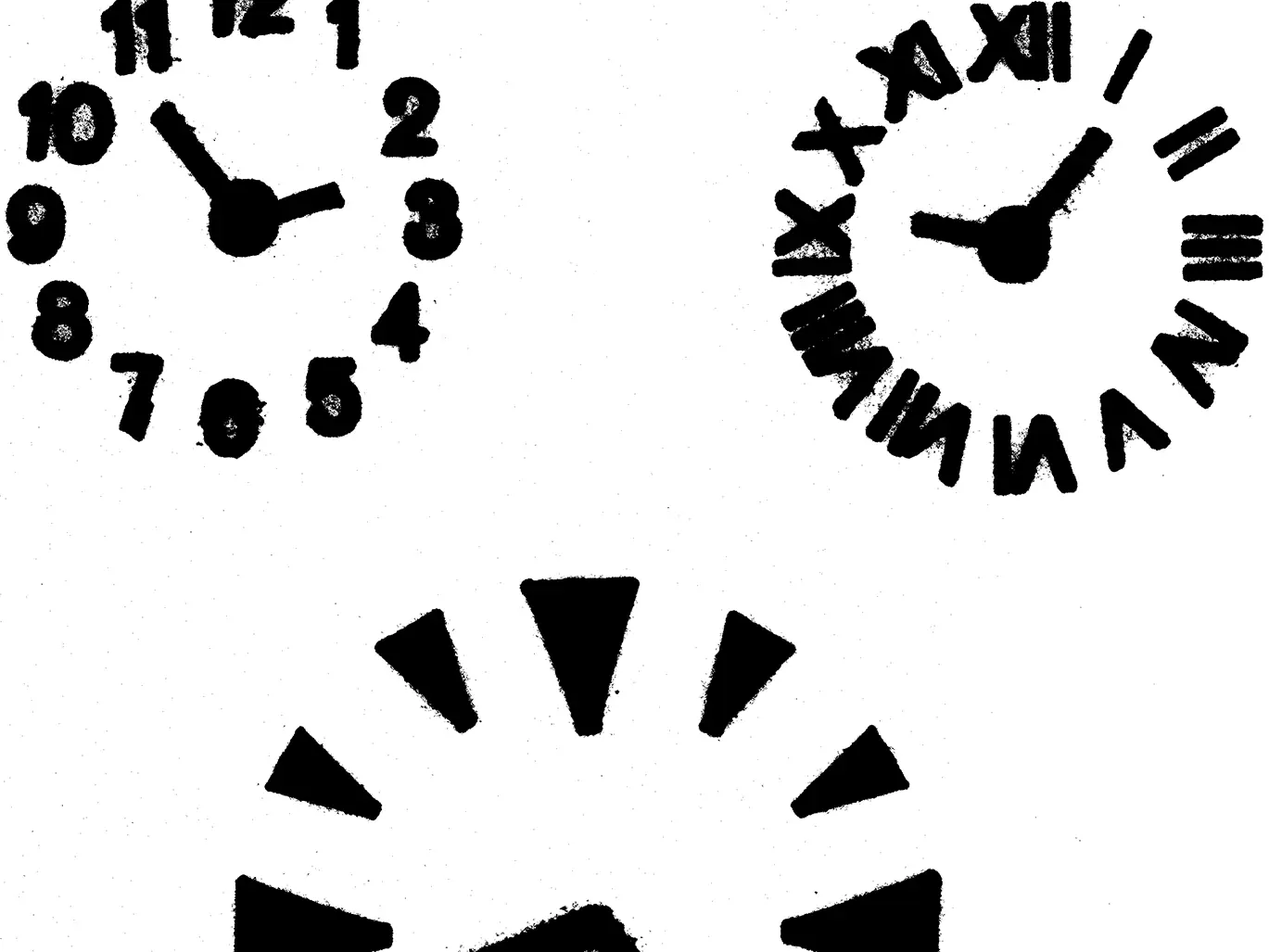
La technique n’est pas neutre. Ce slogan, largement partagé à gauche, ne résout toutefois pas l’affaire, car il faut bien s’entendre sur ce qu’il recouvre réellement. S’il s’agit de réfuter l’idée que la technique profite à tout le monde de la même manière, alors la formule fait effectivement consensus. En régime capitaliste, c’est avant tout la bourgeoisie qui en récupère les fruits. Les clivages apparaissent plutôt lorsqu’est interrogée la dynamique même du développement technique.
Toute opposition de principe à celle-ci risque de paraître réfractaire et de se ranger du côté du camp réactionnaire. Malgré l’existence de contestations émancipatrices du machinisme en son sein, le mouvement ouvrier s’est le plus souvent inscrit dans un horizon progressiste d’optimisme technologique.
Au cours des deux derniers siècles, le développement des forces productives a assurément donné lieu à des avancées techniques majeures. L’automatisation a contribué à réduire la pénibilité physique de certaines tâches productives et reproductives, ainsi que le temps de travail nécessaire pour les effectuer – de la tractopelle au lave-linge. Dans le même temps, le caractère capitaliste de ce développement a mécaniquement impliqué un renforcement continu du contrôle bourgeois sur les outils, les rythmes et les finalités du travail.
Les gains de temps et de pénibilité ont ainsi surtout permis de garantir plus de profits aux capitalistes.
Jusqu’ici, la gauche syndicale et politique s’est structurée autour de la négociation d’un «compromis technologique» avec le capital: il s’agissait d’obtenir que les travailleur·ses bénéficient, au travail comme en dehors, d’une petite partie des gains associés aux innovations déployées, sans remettre en cause ni la propriété des moyens techniques, ni l’orientation productiviste de leur usage. Ce compromis était fait au nom d’un «progrès» qui faisait encore illusion.
L’optimisme technologique n’est plus tenable à gauche aujourd’hui. Le ravage écologique comme l’avènement politico-économique du secteur de la tech obligent à considérer la question technologique pour elle-même, sans la rabattre immédiatement sur la question sociale. Autrement dit, la réappropriation des moyens de production ne suffit pas, car tout l’appareil productif ne pourra pas être facilement réorienté vers des usages désirables.
Une réflexion véritablement technocritique s’impose donc à gauche – à condition d’éviter certaines pentes glissantes technophobes. La nuance est certainement préférable aux grands discours – positifs ou négatifs – sur «la technologie» en général: chaque dispositif doit être considéré pour lui-même, à partir de son contexte d’élaboration et d’usage, comme de son degré d’intégration capitaliste et de ses conséquences écologiques et sociales. En d’autres termes, il s’agit de voir que chaque «technique» est toujours encastrée dans un certain régime de pouvoir – c’est-à-dire une «technologie».
Cela permet d’évaluer, de manière matérialiste, les effets sociaux et politiques réels de telle ou telle technique pour envisager son éventuel réemploi à des fins émancipatrices. C’est un travail politique qui ne pourra être réalisé qu’au cas par cas.
Deux entretiens de ce numéro ↗︎ ↗︎ participent de cet effort technocritique. Ils décrivent les effets concrets du changement technique sur le travail. Leur vocation d’ouvrir un débat rarement abordé en propre: le chantier politique qui attend la gauche sur la question technologique reste encore énorme.
Antoine Dubiau












