Pour une approche holistique de la GPA
La gestation pour autrui (GPA) est une formation familiale non traditionnelle dans laquelle une personne convient avec un autre individu ou un couple qu’elle tombera enceinte et donnera naissance à un enfant que la personne ou le couple a l’intention d’élever.
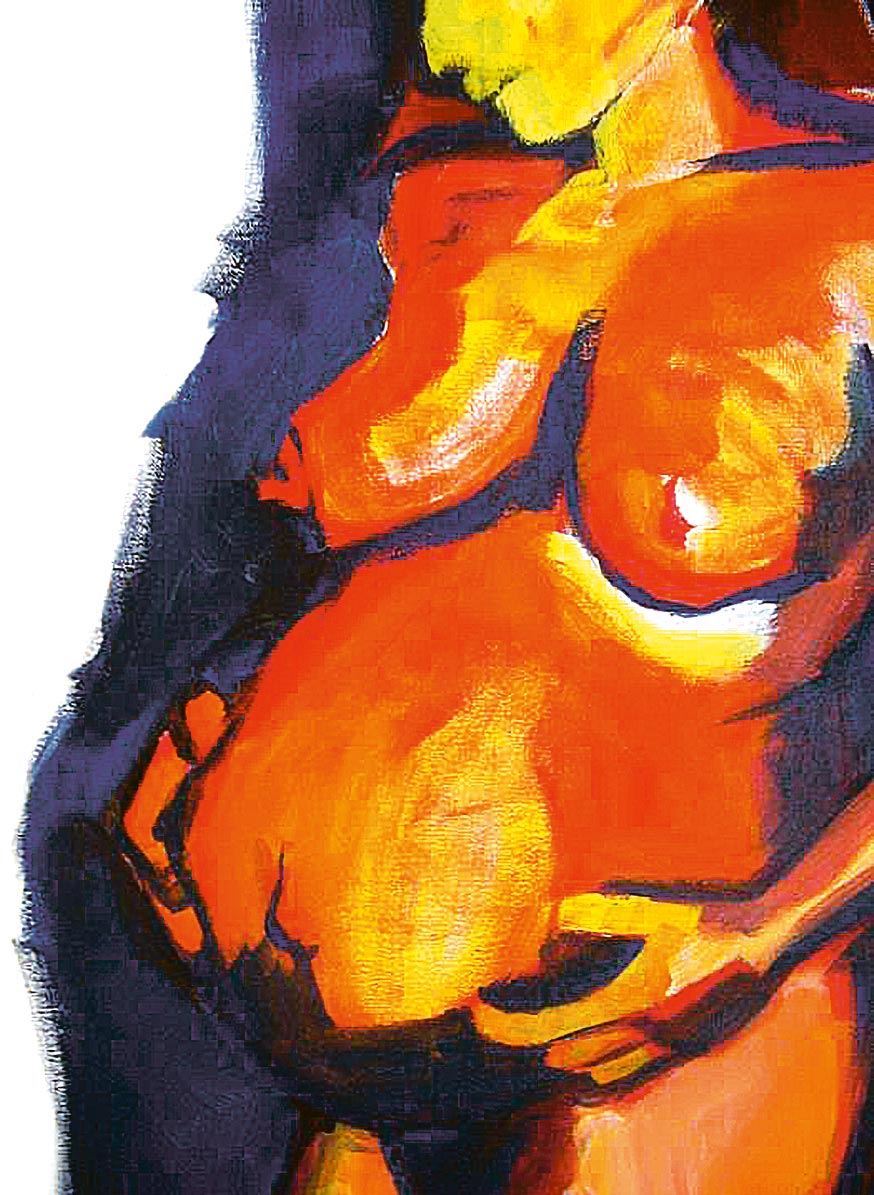
Bien que ce soit souvent des couples hétérosexuels touchés par l’infertilité qui ont recours à la GPA, elle représente également un type de formation familiale pour les couples de même sexe. La GPA peut être entreprise sous différentes formes, y compris traditionnelle et gestationnelle. La GPA dite traditionnelle fait référence aux accords dans lesquels la personne assurant la gestation fournit ses propres ovules pour devenir enceinte alors que dans les accords de GPA dite gestationnelle, la personne ne fournit pas ses propres ovules.
Souvent, les deux types de GPA impliquent l’utilisation des gamètes d’au moins un parent prévu. L’entente de GPA peut ne comporter aucun transfert financier. Dans d’autres cas, un défraiement est prévu, tandis que parfois, la personne assurant la gestation peut être indemnisée au-delà du remboursement des dépenses engagées.
Un accord de GPA peut impliquer de nombreux droits et intérêts : ceux de la personne assurant la gestation, de l’enfant né à la suite de la GPA, du parent ou des parents visés et, dans de nombreux cas, d’un·e ou deux fournisseurs·euses de gamètes. À ce titre, une analyse minutieuse fondée sur la recherche et une prise en compte des droits de chaque partie prenante doivent faire partie de tout discours sur la GPA, loin de la fureur idéologique portée par les mouvements conservateurs.
Une question de droits
Les débats récents concernant la GPA au niveau global ont principalement porté sur l’impact de celle-ci du point de vue des droits de l’enfant. Ainsi, les discussions concernant les implications du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant sur les cadres réglementaires et sur la pratique des États ont été prévalentes.
Bien que ces dernières soient importantes et nécessaires, il est également essentiel d’examiner la question de la GPA du point de vue des droits des autres parties prenantes. En particulier, il est primordial d’examiner les liens entre la pratique de la GPA et les droits des femmes : qu’il s’agisse du droit à l’égalité, à la non-discrimination, à la santé, à la santé reproductive et sexuelle, à l’autonomie corporelle , ainsi qu’en ce qui concerne les principes du consentement éclairé et l’inclusion des perspectives et de la participation des personnes les plus touchées.
Loin des discours clivants autour du concept de la famille héténormative et bourgeoise revendiquée par les mouvements conservateurs ainsi que des craintes d’exploitation et de marchandisation des corps portés également par certaines féministes, la pratique de la GPA nous force à nous interroger sur les relations familiales et sur des alternatives à la famille traditionnelle. Sortant de l’idée d’exploitation qui serait selon certain·e·s inhérente à cette pratique, il serait pertinent de discuter ce qui constitue le travail reproductif et l’impact du capitalisme sur les choix des femmes.
Une part d’exploitation en tout
Des relations inégales de pouvoir peuvent bien exister lors d’arrangements de GPA et léser les personnes assurant la gestation. Pour autant, la solution ne réside certainement pas dans la criminalisation de la pratique, solution utilisée dans des pays comme le Cambodge. Bien loin d’éradiquer la GPA, elle n’a fait que déplacer la pratique, la rendre illégale et souterraine, laissant les personnes assurant la gestation sans protection en cas d’abus et à la merci d’intermédiaires. La criminalisation de la GPA et sa catégorisation en tant que « trafic humain » ôtent également toute autonomie aux personnes concernées et les entraînent bien souvent dans un cycle d’incarcération.
Si la GPA déclenche autant de passions, c’est parce qu’elle touche aux fondements des sociétés bourgeoises : dans ces représentations, la femme, mère avant tout, gardienne de la famille hétéronormative, productrice de la future force de travail exploitable à merci, n’a pas d’activité sexuelle indépendante de la reproduction et ne perçoit pas la maternité hors d’un cadre romantisé et pré-établi. En permettant des formes alternatives de composition familiale et en faisant voler en éclats ces fondements, la GPA remet en question l’utilité même de ces cadres et met en avant l’autonomisation des femmes.
Selon Sophie Lewis, autrice du livre Full Surrogacy Now, tout travail dans un système capitalisme contient une part d’exploitation, et le travail reproductif n’échappe pas à cette règle. C’est bien pour cela que tout l’ordre capitaliste doit être renversé afin de laisser libre choix aux personnes d’utiliser leur corps comme elles l’entendent.
Paola Salwan Daher














