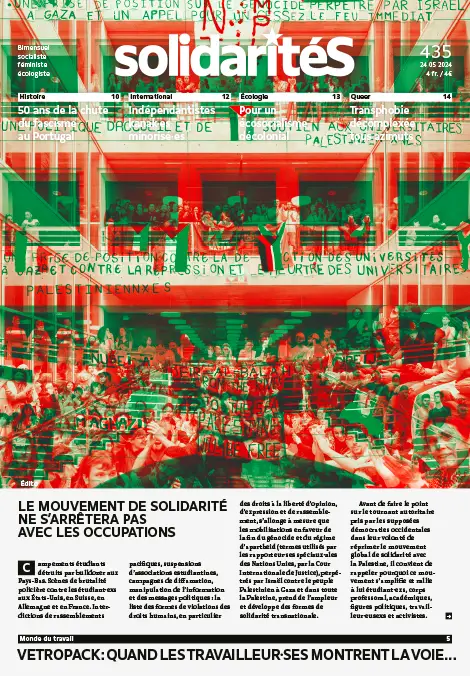Kanaky
Une tentative de minoriser les indépendantistes
Après l’avancement unilatéral du dernier référendum pour l’indépendance de 2021, largement boycotté par les Kanaks, le projet de loi élargissant le corps électoral de la Kanaky attise les tensions. Celui-ci nie une fois de plus le droit à l’autodétermination des autochtones et met à nu la brutalité coloniale de l’État français.

Le 13 mai 2024, l’Assemblée nationale française a voté la loi constitutionnelle «portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie» présentée par le gouvernement. Ce projet de loi élargit le corps électoral de la Kanaky à quelques 25000 citoyen·nes supplémentaires né·es ou résidant depuis plus de dix ans sur le territoire pour les prochaines élections locales.
La Kanaky, un territoire singulier
Pour comprendre l’impact de ce projet, il est nécessaire de revenir brièvement sur l’histoire de ces territoires. Ce que l’État français appelle la Nouvelle-Calédonie est un ensemble d’îles et d’archipels de l’ouest de l’océan Pacifique. Territoire colonisé depuis 1853, il s’agit d’abord d’une colonie pénitentiaire où sont déporté·es les condamné·es aux travaux forcés, puis les communard·es et les indépendantistes algérien·nes. Devenue colonie de peuplement, la Nouvelle-Calédonie est un territoire inscrit sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser établie par les Nations Unies depuis 1986.
Habitant ces territoires depuis environ trois mille ans, les Kanak·es sont le peuple premier de la Kanaky. En 2019, on compte près de 271000 habitant·es, dont 41% de Kanak·es, 24% d’Européen·nes et 11% de métis·ses. Cet archipel est marqué par des inégalités socio-économiques racialisées importantes. Majoritaires jusque dans les années 1970, les Kanak·es passent sous la barre des 50% de la population du fait de l’arrivée de nouvelles populations lors du boom du nickel.
Le taux d’activité des Kanak·es est inférieur de 20 points à celui des Européen·nes en 2014, tandis que le taux de non-diplômé·es est quatre fois plus important chez les Kanaks que chez les Européen·nes.
La lutte pour l’autodétermination du peuple Kanak
Dans leur lettre ouverte au peuple de France, le peuple Kanak revient sur l’histoire des luttes d’indépendance et ses nombreuses révoltes (1878, 1917, 1984/1988). À Nainville-les-Roches, en juillet 1983, deux principes importants sont posés: la reconnaissance par l’État français du «droit inné et actif à l’indépendance» pour le peuple Kanak et l’acceptation par le peuple Kanak d’associer les différentes communautés au processus de décolonisation de la Kanaky. Ces deux principes sont intrinsèquement liés, le deuxième ne saurait être mis en œuvre en l’absence du premier.
En 1998, avec les accords de Nouméa, l’État français reconnaît pour la première fois les violences coloniales et prévoit un transfert progressif de compétence vers la Kanaky, un plan de réduction des inégalités ainsi que trois référendums pour déterminer l’indépendance de la Kanaky. Afin de préciser la composition des listes électorales présents dans ces accords, en 2006 est adopté le gel du corps électoral en Kanaky, réservant le droit de vote aux élections provinciales et territoriales aux personnes installées sur le territoire depuis dix ans à la date du 8 novembre 1998.
La continuité coloniale française à l’œuvre
Aujourd’hui, le projet de loi constitutionnel devrait élargir de 14% l’électorat local. Les groupes indépendantistes acceptent d’ajouter aux listes provinciales les personnes nées après 1998, mais refusent l’élargissement aux nouveaux·elles arrivant·es. L’État propose ainsi une condition de résidence de 10 ans, sans pour autant fournir une étude d’impact de cette réforme sur les prochaines échéances électorales.
Ce projet de loi reste dans la continuité de la brutalité juridique de l’État. Prévus par les accords de Nouméa, trois référendums pour l’indépendance ont eu lieu: 2018 (56,7% de non), en 2020 (53,3% de non). Puis le scrutin prévu initialement en 2022 a été avancé par Macron contre l’avis des populations locales en 2021, présentant une abstention record de 56,13%. Largement boycotté par les Kanak·es, ce référendum ne peut être considéré comme légitime.
Derrière l’élargissement du corps électoral, c’est bien la remise en cause par le gouvernement du processus de décolonisation et de la construction locale d’une communauté de destin en Kanaky qui est visé.
À la suite du vote, de nombreuses révoltes et barrages ont éclaté sur l’archipel à l’appel du peuple Kanak. Une situation jugée insurrectionnelle par le gouvernement, qui a décidé de réprimer violemment une insurrection qu’il a lui-même provoquée. L’état d’urgence a été décrété mercredi 15 mai, s’accompagnant de restriction des libertés et d’un ban de TikTok. Six Kanaks ont été assassiné·es par balle lors des affrontements, à priori tués par des Européen·nes. Ce bilan sanglant aurait pu être évité si le gouvernement avait choisi de respecter le processus de décolonisation, au lieu de provoquer le peuple Kanak.
Marie MK