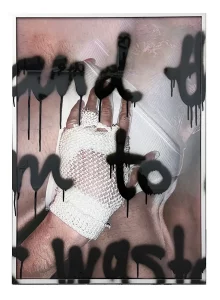Plongée en eaux queer-féministes
Mets tes palmes est un collectif fondé en 2020 dans une perspective féministe, intersectionnelle, queer, décoloniale, anti-capitaliste, anti-étatique, écologique et anti-spéciste. Nous avons réalisé cet entretien dans le cadre de la parution du septième numéro de leur revue, qui porte le même nom.

Peux-tu nous présenter votre collectif ? Votre mode de fonctionnement et votre démarche ?
Le collectif a été fondé en 2020 à Vevey, juste avant le début de la pandémie de covid. Le nom Mets tes palmes vient d’une volonté de s’inscrire dans l’histoire des courants des féminismes qui nous ont précédé. C’est aussi une forme d’appel à la lutte, d’enfiler ensemble ces palmes pour se jeter dans le grand bassin des luttes féministes.
On est un collectif qui fonctionne de manière entièrement militante et la majorité des membres ne vient pas du monde du journalisme. On se nourrit des compétences des unexs et des autres pour apprendre ensemble. On fonctionne en mixité choisie sans hommes cis et on adopte un fonctionnement horizontal. On a aussi une charte de fonctionnement que chaque personne qui veut nous rejoindre doit lire et approuver. Actuellement, on est environ une dizaine de membres et on est toujours ouvertexs à des nouvelles personnes ! On publie environ une revue par année.
Comment se passe la construction d’un numéro de la revue ?
On n’a pas vraiment de ligne éditoriale prédéfinie très stricte. On définit ensemble une thématique, entre nos envies et des éléments de l’actualité sociale et politique qui nous importent. Dans chaque numéro, il y a un mélange entre des articles militants, des articles académiques et des articles plus poétiques. Le but étant de refléter plusieurs voix et les plumes de tout le monde. On a aussi toujours des témoignages et des interviews avec des personnes qui ont des pratiques que l’on ne retrouve pas forcément au sein du collectif.
Après avoir défini ensemble la thématique, les personnes impliquées rédigent leur article. On a ensuite une relecture collective générale de tout le contenu, une deuxième relecture plus en profondeur qui est effectuée par des petits sous-groupes, suivie d’un travail de vérification des sources effectué aussi par un petit groupe de personnes. Après il y a toute la partie graphisme et illustration qui est encore réalisée par un autre sous-groupe de personnes.
On fait imprimer la revue chez un imprimeur à Vevey, c’est la seule étape qui n’est pas DIY et pour laquelle on a un coût fixe. Et pour finir, on vernit la revue ! En amont, il y a tout un travail de recherche de fonds, de comptabilité, de communication, d’organisation d’événements qui est plus invisible mais qui constitue une part tout autant importante de notre activité militante.
On tire chaque numéro à environ 300 exemplaires, en fonction des moyens financiers dont nous disposons au moment de l’impression du numéro. On a un système d’abonnement à trois numéros, avec différentes échelles de prix, car nous pratiquons le prix libre. On les distribue à différents endroits, comme à Vevey (café le Bachibouzouk), Lausanne (disquaire Disc-à-Brac et librairie les Médusales), Genève (librairie Fahrenheit 451), Nyon (boutique The Gallery), Fribourg (librairie l’Art d’Aimer et disquaire Ablette Records) et les numéros sont disponibles dans différentes bibliothèques et en version PDF sur notre site.
Concernant les thématiques, jusqu’ici, on a fait un premier numéro sur les problématiques soulevées par la crise du covid, un deuxième sur l’intersectionnalité, un autre sur la thématique du corps, un quatrième numéro qui parlait de la mort, ensuite un numéro qui portait sur le thème de la chaleur et un sixième qui tournait autour de la thématique du jeu. Pour notre septième numéro, on a décidé de travailler sur la problématique des frontières/limites.
Peux-tu nous parler un peu plus de ce nouveau numéro ?
La thématique a été abordée de plein de manières différentes. Il y a notamment un article sur les droits d’asile des personnes queer, un autre sur les initiatives étudiantes développées pour l’intégration à l’université des personnes réfugiées, un sur le génocide en cours en Palestine, un autre sur le rapport à la sobriété comme pratique pour poser des limites corporelles, ou encore un autre sur les limites de l’imagination.
Les rédacteuricexs sont généralement des membres du collectif mais, pour la première fois, dans ce numéro, une personne externe nous a envoyé un texte que nous avons publié. On a aussi un article qui est une carte blanche à des membres du collectif Voix d’Exils.
Récemment, vous avez inauguré un nouveau format en organisant une exposition à partir d’archives de revues féministes romandes des années 1970–1980. Peux-tu nous parler un peu de cette exposition ?
L’exposition s’appelle Plongée en archives féministes (1975-1986) — De la revue L’Insoumise à CLIT 007 : une décennie de féminisme romand. Elle est née d’une collaboration spontanée avec Eeeeh ! — qui est un espace d’art à Nyon qui organise des événements culturels et artistiques avec une ligne militante et engagée.
Au départ, on était un peu intimidéex parce que la plupart des membres du collectif ne viennent pas du monde de l’art contemporain. Initialement, on avait réfléchi à la possibilité d’inviter des artistes mais assez vite, on est arrivéex à la conclusion que l’on n’était pas des spécialistes des expositions et du monde de l’art contemporain. Du coup, quand l’idée de faire une exposition sur des archives de revues a émergé, on a trouvé une envie collective de s’investir dans ce projet.
On a préparé l’exposition pendant l’été avec un groupe de travail « curation ». On a passé beaucoup de temps dans différents centres d’archives et on s’est renduex compte que c’était aux archives contestataires qu’il y avait le plus de contenu qui nous intéressait. On a eu une approche assez naïve de ces archives parce qu’on ne disposait pas vraiment de connaissances préalables sur la presse féministe de ces années-là. On a tout regardé, tout feuilleté. Les archives contestataires nous ont aussi beaucoup aidéexs dans notre démarche et on les en remercie !
On a cherché des personnes qui défendaient un féminisme qui ressemble au nôtre et c’est comme ça qu’on est tombéex sur deux revues : L’Insoumise, qui est née en 1976 et a duré quelques années, et CLIT 007, qui découle du collectif Vanille-Fraise qui s’est détaché de L’Insoumise en 1979 pour fonder en 1981 cette nouvelle revue « Concentré Lesbien Irrésistiblement Toxique ». Cette revue s’est transformée en bulletin de L’ILIS (International Lesbian Information Service), qui a duré jusqu’en 1986.
Ces deux revues nous ont intéresséexs parce qu’elles regroupaient des thématiques qui nous parlaient. Dans L’Insoumise, on trouve beaucoup de questions liées à la précarité, à l’avortement, aux conditions d’existence des femmes ouvrières ; avec toujours des actions directes, comme une occupation d’usine. Dans CLIT 007, on trouve plutôt des thématiques qu’on qualifie de lesbiennes ou queer. Une dimension vraiment intéressante de cette revue, c’est la manière dont elle devient plus intersectionnelle au fil des numéros.
On s’est sentiex proche de ces deux productions militantes pour des raisons variées. On trouvait intéressant les différences qui pouvaient exister dans notre collectif sur ce sentiment de proximité justement et sur ce que ça pouvait dire des prérequis nécessaires pour construire une communauté basée sur la proximité des vécus et des expériences. En même temps, on trouvait aussi intéressant de montrer comment, au-delà des différences, L’Insoumise et CLIT 007 étaient aussi reliées ; notamment par leur participation au Mouvement de libération des femmes (MLF).
Dans le cadre de l’expo, on a organisé une table ronde à Eeeeh ! avec des anciennes militantes du MLF – qui étaient membres de ces revues et qui militent encore aujourd’hui – et une historienne de l’art qui a écrit un ouvrage sur les pratiques curatoriales d’archives. Ça nous intéressait de faire dialoguer cette double perspective expérientielle d’un côté, et plus académique et de recherche de l’autre, et de créer un dialogue intergénérationnel. C’était un moment très beau et très fort !
Cette exposition et la table ronde entrent en résonnance avec la thématique de la mémoire et de la transmission des luttes féministes et queer. Comment cette problématique raisonne-t-elle au sein de Mets tes palmes ?
Cette question d’accessibilité et de transmission des pratiques et des témoignages, c’est une réflexion qu’on a depuis le début et qui s’articule aussi dans la volonté de faire une revue, mais peut-être de manière moins formalisée. C’est vrai que le contact des archives nous a aussi fait réaliser qu’on devait réfléchir à comment garder des traces de nos propres productions, par exemple en déposant des exemplaires des numéros aux archives contestataires. De la même manière, les discussions pendant la table ronde ont mis en lumière cette problématique intemporelle de la fragilité de nos productions militantes, qui reposent sur les épaules d’un petit nombre de personnes qui ne sont souvent pas loin d’un burn out militant. Des supers projets comme celui de L’Insoumise ou de CLIT 007 ont pu prendre fin pour des questions d’épuisement.
Cette exposition a aussi développé chez nous une réflexion autour de la question de la continuité et un intérêt pour les luttes féministes en Suisse, qui sont encore très peu connues et souvent invisibilisées. On s’est renduex compte qu’il y avait aussi malheureusement une continuité dans les problématiques contre lesquelles on doit se mobiliser, comme la montée des forces réactionnaires et du fascisme, ou encore les attaques contre les droits reproductifs ou l’autonomie corporelle.
Ouvrir des espaces comme ceux de l’exposition et de la table ronde, ça permet aussi de se rendre compte que l’on n’est pas seulex, qu’il y a eu des choses avant nous. Par exemple, l’usage de l’humour et du détournement dans les pancartes et les actions féministes était déjà très présent dans les années 1970 – 1980. Pareil pour les techniques comme le collage. Un enjeu que la table ronde et les archives ont permis de soulever, c’est celui des conditions nécessaires pour se rencontrer entre personnes sexisées, entre lesbiennes, entre militantes féministes. Par exemple, dans CLIT 007, on trouve beaucoup d’appels pour des rencontres de femmes. Ce type d’usage permet de donner une nouvelle fonction à l’objet de la revue et donne envie d’organiser plus d’événements comme ceux-ci, pour se rencontrer davantage et faire des choses ensemble à partir de nos vécus.
Pour finir, Est-ce que tu as des futurs événements à nous annoncer ?
Le 25 octobre, il y a le finissage de l’exposition à Eeeeh !, avec des lectures et un dj set de Kween K. On sera aussi au microsalon organisé par askip le 26 octobre à Ripopée (Nyon) si vous voulez venir acheter le nouveau numéro, ou des anciens ! Vous pouvez aussi nous suivre les réseaux pour connaitre nos prochaines activités.
Propos recueillis par Noémie Rentsch