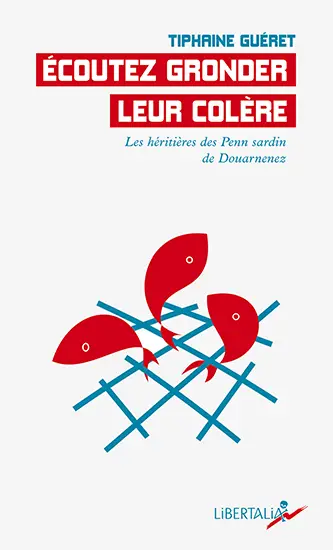(G)Rêver ensemble
Deux récits historiques – Il n’y aura pas de sang versé de Marilyne Desbiolles et Une belle grève de femmes d’Anne Crignon– trouvent un contrepoint contemporain dans le livre Écoutez gronder leur colère de Tiphaine Guéret. Un fil reliant deux époques, la volonté de se défendre même dans des conditions difficiles.

Été 1869: les ovalistes, travailleuses des manufactures de soie, en ont assez. Deux mille femmes posent les outils et descendent dans la rue. Hiver 1924: les travailleuses des «fritures» – les conserveries de poisson – de Douarnenez se mettent en grève.
Soie et poisson, même combat: les ouvrières demandent un meilleur salaire horaire, moins d’heures de travail, des heures supplémentaires rémunérées. Qu’importe si on parle d’une rémunération bien en-deçà de celle de leurs collègues masculins, ou de faire passer une journée éreintante de 12 heures à une journée éreintante de 10? Les revendications sont posées. Les patrons se braquent. On connait la suite.
En 2023, deux livres paraissent qui mettent en lumière ces mouvements de lutte, ces moments de solidarité féminine: Il n’y aura pas de sang versé de Marilyne Desbiolles (Sabine Wespieser) et Une belle grève de femmes d’Anne Crignon (Libertalia). Tous deux évoquent la joie de ces mouvements autant que de la dureté du terrain dont elles s’élancent.
Ces deux textes – engagés, littéraires – s’élèvent contre l’invisibilisation des ouvrières. Marilyne Desbiolles répète les noms de ses grévistes comme une litanie, pour les sauver de l’oubli: Toia, Rosalie Plantavin, Marie Maurier, Clémence Blanc. Elle nous fait entrer dans l’histoire par la petite porte: l’intimité, le quotidien de ces femmes, les liens qui les unissent, la granularité de leur quotidien. Anne Crignon aussi pose une liste sobre et partielle des noms des Penn sardin, état civil et histoires personnelles effacées. Les deux écrivaines butent contre l’effacement des meneuses: noms mal orthographiés, réduits à un prénom ou un surnom, simplement disparus de l’histoire officielle.
Les autrices posent leurs histoires dans un cadre précis et imagé – Crignon parle du «relent âcre de saumure et d’entrailles» qu’est «l’haleine chargée de l’usine»; Desbiolles explique que «la soie grège est […] moulinée, travaillée, torsadée, affinée, consolidée pour se transformer en un fil brillant et régulier». Le regard historique éclaircit et trouble notre perspective. On apprend, par exemple, que les patrons non seulement toléraient la chanson dans le cadre des ateliers, mais l’encourageaient, voyant que ces élans augmentaient la productivité.
Un contrepoint nécessaire
Mais il y a un danger dans la célébration, une petite odeur d’eau de rose: le danger de l’écrasement de la perspective, de la lutte – sa violence, ses échecs – aplanie en chanson. Contre cette «folklorisation» historique de la grève s’élève la voix de Tiphaine Guéret, qui publie Écoutez gronder leur colère chez Libertalia en 2024.
«Sur les conditions de travail, le chœur des filles de chez Chancerelle chante à l’unisson, à quelques nuances près: «Aujourd’hui c’est: produire, produire, produire»» Ainsi parle Mathilde, une de ces ouvrières du 21e siècle employées pour étriper et emboîter le poisson à Douarnenez.
On y découvre un cadre de travail toujours aussi brutal bien qu’un poil assaini. «Les machines saturent le champ visuel, remplissent l’espace sonore.» Froid, odeur de désinfectant, néons: voici où travaillent les sardinières d’aujourd’hui.
Le portrait est navrant, à la fois à l’échelle humaine et à celle, élargie, du capitalisme colonialiste et extractiviste, qui perpétue des schémas d’exploitation aussi grinçants que ceux d’un roman de Zola. Rhétorique essentialiste, langue de bois, raisonnement colonial: ces multinationales déguisées en entreprises familiales se cachent derrière ce que Guéret appelle «l’inconscient du commerce». En ses mots, «la tradition et le local sont vendeurs, à condition de ne pas penser aux petites mains qui le produisent».
En réalité, ces usines sont peuplées de travailleuses intérimaires épuisées, sous-payées, beaucoup d’entre elles issues de la migration. Le débit des machines augmente d’année en année, épuisant à suivre. La qualité importe peu, le travail est peu valorisé. Les pannes des machines – impliquant une baisse de productivité – sont répercutées sur les congés payés des ouvrières.
Une nouvelle vague
Quelques lueurs d’espoir surgissent toutefois, dans les petits gestes de solidarité entre travailleuses tout autant que dans des mouvements plus élargis comme celui des Gilets jaunes. Et dans le ras-le-bol du 11 mars 2024, un jour de grève qui gagnera aux nouvelles sardinières quelques petites améliorations dans leurs conditions de travail. À Douarnenez, 100 ans plus tard, on ne lâche rien.
Vers la fin de son livre, Anne Crignon revient sur l’héritage des Penn sardin: «à l’issue de six semaines et demie d’une marche quotidienne contre l’adversité, ces persévérantes savaient une chose: aucune lutte ne ‹sert à rien›. Aucune n’est ‹perdue d’avance›».
Elodie Olson-Coons