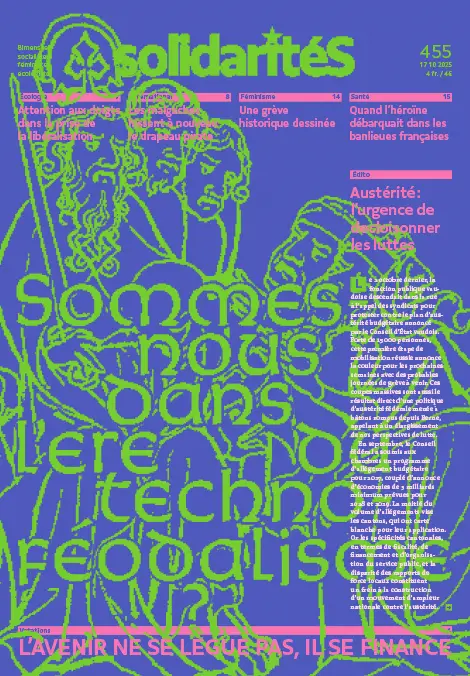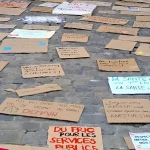Syrie
Élections et transition très partielles
Le 5 octobre, la Syrie a connu ses premières élections à l’Assemblée du peuple depuis la chute du régime des Assad. Cet événement, largement critiqué comme non démocratique, met en évidence les défis politiques, socio-économiques, sécuritaires et humanitaires auxquels fait face la transition post-baassiste du pays.

Organiser des élections après la chute d’un régime autoritaire peut signaler un regain de vie politique dans un pays ravagé par la guerre. Mais la procédure a plutôt ressemblé à une sélection: deux tiers des élu·es ont été désigné·es par 6000 électeur·ices choisi·es et un tiers nommé·es directement par le président de transition Ahmed al-Charaa. Cette élection contribue ainsi à concentrer le pouvoir présidentiel et, potentiellement, à favoriser les loyalistes au détriment de la volonté populaire.
Les partis étant toujours interdits, notables et intellectuel·les se sont présenté·es en indépendant·es. Des critères d’exclusion flous ont écarté des candidat·es sans explication. Le décret réservait un minimum de 20% de sièges pour les femmes, mais celles-ci en ont remporté moins de 3%. Des régions hors du contrôle gouvernemental, notamment le Nord-Est et Soueïda, ont été exclues. Le nouveau Parlement doit siéger trois ans avant l’adoption d’une nouvelle Constitution.
Epuisement général
Dix mois après la chute du régime, des centaines de milliers de personnes – pour la plupart victimes du régime Assad et de ses alliés, mais aussi de groupes non étatiques – demeurent portées disparues, et aucun processus judiciaire large et ouvert n’a été engagé. 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté tandis que les prix explosent: des appartements se vendent à 100000 dollars (parfois jusqu’à 2 millions), alors que le salaire public moyen plafonne à 25 dollars par mois. Malgré une amélioration, l’électricité n’est disponible que quelques heures par jour.
Des forces étrangères restent présentes: bases russes et étasuniennes, troupes turques. L’occupation coloniale-génocidaire sioniste a détruit l’essentiel des capacités militaires syriennes et étendu son incursion au sud-ouest pour sécuriser des corridors vers l’Iran. Le pays subit aussi sa pire crise environnementale en soixante ans (sécheresse, pénuries d’eau, incendies).
Parallèlement, le président transitionnel a surtout recherché légitimité externe et garanties de sécurité, au détriment des urgences internes. Il faut reconnaître que les obstacles logistiques à la tenue de vraies élections sont réels: infrastructures dévastées, pas de recensement, 4,5 millions d’exilé·es, 7 millions de déplacé·es).
Durcissement de l’emprise du pouvoir
Le gouvernement de transition n’a, jusqu’à maintenant, jamais mentionné le mot démocratie. Des rapports évoquent arrestations arbitraires et tortures. Les auteurs d’assassinats et d’enlèvements sur la côte en mars puis à Soueïda en juillet n’ont pas été traduits en justice. Al-Charaa n’a pas pris de mesures dissuasives contre les discours sectaires et le revanchisme. Les exécutions extrajudiciaires, l’exclusion et l’absence de garanties pour les minorités ont poussé le leader sécessionniste druze al-Hijri à remercier Israël pour son soutien militaire et certain·es habitant·es de Soueïda à brandir des drapeaux israéliens. Mais la solution au séparatisme dans le Nord-Est et à Soueïda est politique, y compris la décentralisation, et non militaire.
Le système né après décembre 2024 rappelle celui du HTS à Idleb dès 2017: néolibéralisme autoritaire, clientélisme et kleptocratie sous un vernis conservateur. Des responsables de l’ancien régime sont demeurés en place ou impunis, y compris Bachar al-Assad (même s’il se trouve en Russie, les deux bases russes en Syrie pourraient servir de levier pour le faire comparaitre en justice) et le criminel Fadi Saqr. Le frère du président de transition, Maher, est devenu de facto le numéro deux de l’État ; un autre frère, Hazem, aurait récupéré plus de 1,6 milliard de dollars auprès d’hommes d’affaires liés aux Assad en échange d’amnisties et de protection.
Quelle direction?
Il y a certainement des signaux positifs: allègement des sanctions, liberté d’expression accrue, ré-électrification, levée d’interdictions de voyager pour cinq millions de personnes, 1,4 million de retours (selon l’ONU). Néanmoins, les revendications profondes et légitimes qui ont amené au renversement d’Assad, présentes dès 2011, demeurent insatisfaites: égalité citoyenne, démocratie effective, réforme électorale, participation politique et économique, place des femmes, inclusion.
La justice pour les centaines de milliers de victimes doit être centrée sur ces dernières, transparente et placée au cœur de la transition. Il ne s’agit pas de remplacer un groupe par un autre pour se venger, mais de briser la logique d’oppression et de division.
La reconstruction doit servir l’intérêt public, sous contrôle citoyen, et non enrichir un cercle proche du pouvoir. Les forces étrangères doivent partir, être traduites en justice et payer des réparations. La démocratisation du pouvoir et de la richesse ne doit pas être un rituel, mais l’objectif premier, vital depuis 2011.
Wafa al-Karamah