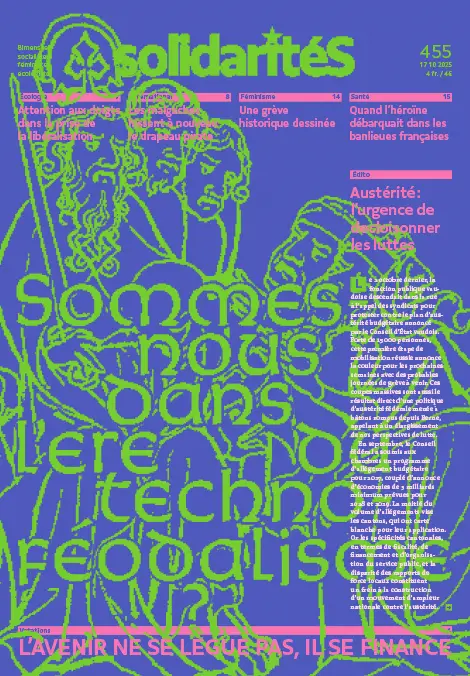Faire et écrire l’histoire des mobilisations autour du travail
Quelle histoire des mobilisations au travail à l’heure de l’intelligence artificielle? Quelle histoire des mouvements sociaux pour les luttes présentes? Telles sont les questions à l’ordre du jour de rencontres-débats qui auront lieu le 31 octobre et le 1er novembre.

«Pour la population laborieuse, [l’accumulation du capital] se manifeste, tout d’abord, par un changement continuel dans le processus de travail. » C’est ainsi que le sociologue marxiste étasunien Harry Braverman introduisait, en 1972, son important ouvrage Travail et capitalisme monopoliste. Ce changement continuel dans l’organisation et les techniques est particulièrement sensible aujourd’hui. Les discours publics contradictoires sur la technique, tantôt optimistes, tantôt radicalement pessimistes, accentuent le sentiment de perte de contrôle et d’accélération. Tout cela nous plonge dans un présent permanent: notre travail n’a pas d’histoire, puisqu’il paraît sans cesse en transformation.
Le changement, une nouveauté?
Pourtant, le «changement continuel dans le processus de travail» que pointe Braverman n’est pas une nouveauté. L’introduction de nouvelles techniques de production comme la machine à vapeur, l’électrification ou la chaîne de montage ont produit des effets massifs sur les rapports capital–travail, rapports qu’il faut se garder d’interpréter de façon mécaniste.
Comme l’a montré l’historien Edward Palmer Thompson, ce n’est pas la machine à vapeur qui crée mécaniquement la classe ouvrière britannique. Celle-ci se constitue en trouvant ses propres moyens de lutte face aux changements dans les processus de travail que lui impose le capital. Dans un récent volume collectif, François Jarrige, spécialiste de l’histoire des techniques, souligne que les machines, l’organisation du travail et les sources d’énergie sont toujours des sources de conflits. Ceux-ci se développent non seulement entre le capital et le travail, mais également parmi les capitalistes eux-mêmes qui n’ont pas les mêmes intérêts ni les mêmes capacités d’investissement dans les techniques nouvelles.
Ainsi, les discours contemporains sur la technique semblent nous mettre dans une position d’impuissance, tandis que l’étude du passé montre que le mouvement ouvrier a fait face, à de nombreuses reprises, à des bouleversements profonds du processus de travail. Dans ce contexte, les historiennes et les historiens des mouvements sociaux doivent relever un défi de taille. Comment écrire un récit qui n’écrase pas les préoccupations du présent tout en les mettant en perspective? L’histoire et la mémoire des mobilisations au travail permettent-elles d’opposer des résistances à l’accablement que provoquent les changements accélérés dans lesquels nous sommes projeté·es?
Désengagement et réengagement
Dans un récent article de bilan, l’historienne Laure Piguet relève, au tournant des années 2000, une phase de désengagement de l’histoire ouvrière, autrement dit une séparation plus nette entre travail scientifique et travail militant. Cette phase coïncide avec un recul des mobilisations ouvrières elles-mêmes. L’historienne regrette cette évolution qu’elle n’est pas seule à constater et plaide pour un «réengagement assumé».
Il faut dire que des dispositifs sophistiqués de co-construction des connaissances historiques ont existé dans les années 1970 autour des History Workshops d’E. P. Thompson et Raphaël Samuel ou du Forum histoire de Jean Chesneaux. L’idée de ces initiatives était que, si les questions posées au passé sont toujours informées par le présent, il y avait quelque chose à gagner à ce que ces questions ne viennent pas des seul·es professionnel·les habilité·es à les formuler. Ces pratiques ont disparu ou se sont fortement institutionnalisées. Mais le temps du désengagement est peut-être révolu.
Jérôme Lamy et David Hamelin, co-fondateurs de la toute récente Revue d’histoire sociale, écrivent en introduction au premier numéro de janvier 2025: «Puisque cette histoire sociale interroge l’ordre social tel qu’il est ou a été, il s’agira de conduire, par-delà les nécessaires assises académiques, un travail de médiation et de popularisation».
Des rencontres-débats ouvertes à toutes et tous
Les Archives contestataires et le Collège du travail voudraient approcher ces vastes questions dans le cadre de rencontres-débats qui se tiendront les 31 octobre et 1er novembre prochains. Celles-ci débuteront par une conférence de la sociologue Maud Simonet qui interrogera les ressorts des mobilisations au travail. Suivra une discussion autour des archives des mouvements sociaux. Enfin, six historien·nes présenteront au public les résultats de travaux récents sur les mouvements sociaux. Dans l’esprit d’un réengagement de l’histoire du mouvement ouvrier, ces rencontres-débats sont ouvertes à toutes et tous, et particulièrement à celles et ceux qui se mobilisent aujourd’hui autour du travail.
Patrick Auderset Collège du travail
Frédéric Deshusses Archives contestataires
Programme et inscriptions: