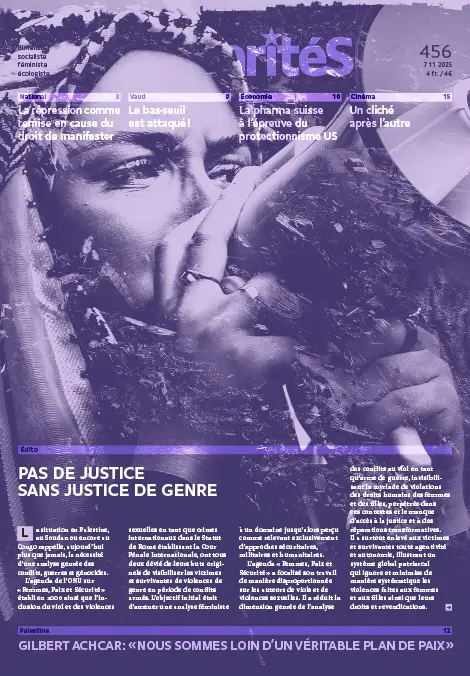Le bas-seuil est attaqué !
Refus massifs aux portes des hébergements d’urgences, restrictions d’accès pour certain·es usager·es des espaces de consommation sécurisée, fermeture d’un accueil de jour autogéré : attaqué de tous les côtés, le bas-seuil prépare la riposte.

Aujourd’hui, plus que jamais, le secteur du bas seuil se trouve fragilisé et fait face à de multiples pressions et attaques qui compromettent sa mission. En réponse, une assemblée générale des acteur·ices du domaine s’est tenue le 28 octobre à Lausanne, à l’appel du SSP. Plus de 70 personnes représentant 27 institutions et associations y ont participé.
L’appel est une réponse à l’offensive menée par la droite et le PS contre l’espace de consommation sécurisé (ECS) de la Riponne, géré par la Fondation ABS. Ces derniers mois, deux postulats déposés par le PLR et le PS ont été adoptés par le Conseil communal. Le premier demande que seul·es les résident·es vaudois·es puissent bénéficier de l’ECS, tandis que le second exige de définir des critères d’accès à la structure. De son côté, l’UDC demande la fermeture totale de l’ECS.
Ces propositions vont à l’encontre de la politique de réduction des risques, qui vise à préserver la santé et la dignité des personnes consommatrices, et de leur permettre de bénéficier d’un accompagnement social, sans condition d’abstinence. Le GREA a par ailleurs récemment publié un papier de position défendant l’accès universel à ces structures.
Trier au lieu d’aider
Si ces postulats visent principalement l’ECS, c’est tout le bas-seuil qui se sent concerné. L’élargissement potentiel de ces mesures s’exprime déjà dans les postulats déposés : demain, ce sont aussi les hébergements d’urgence, les soupes populaires, les espaces d’hygiène et d’autres formes d’aide inconditionnelle qui risquent d’être touchés. Les principes même de bas-seuil et d’inconditionnalité sont remis en question. S’il est nécessaire de le rappeler, l’article 33, alinéa 1 de la Constitution vaudoise définit que « Toute personne dans le besoin a droit à un logement d’urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine ».
Or, dans les faits, le dispositif est plus que saturé. Cette année, au 30 octobre 2025, les hébergements d’urgences lausannois enregistrent déjà 10 936 refus (incluant certes quelques doublons anecdotiques), soit 36 refus par soir en moyenne. Dans certaines structures, plus de personnes sont refusées qu’accueillies. Inconditionnalité et pénurie ne sont pas des principes compatibles. Que se passe-t-il quand le dispositif est saturé ? Il faut faire du tri, accueillir certaines personnes et en refuser d’autres, faire la police plutôt que de l’accueil.
Si, contrairement à la volonté exprimée par le PLR et l’UDC, les non-résident·es vaudois·es ne sont pas exclu·es des hébergements d’urgence, iels disposent de moins de droits d’accès : leur nombre de nuits est restreint et leur place n’est jamais assurée.
Le choix politique de maintenir un nombre insuffisant de places a des incidences directes : ce système reproduit de la violence et du racisme systémiques. Chaque soir, ce sont des hommes racisés précaires qui sont refusés aux portes des structures. Ils sont ensuite confrontés à la rue et aux violences policières. On ne peut alors s’empêcher de penser à Michael Kenechukwu Ekemezie, qui fréquentait le système d’hébergement d’urgence, et, un soir, est décédé entre les mains de la police.
Plus de Demeure
Cet automne également, la Demeure, un lieu social autogéré qui propose un accueil de jour, est sommée de quitter la petite place qu’elle occupait à Malley. Ces dernières années, la Demeure était devenue un véritable refuge pour beaucoup de personnes à la rue. Cette décision met fin à une initiative associative et bénévole qui assurait un travail social essentiel – permanences médicales, repas partagés, projets culturels – et comblait ainsi le manque criant de structures d’accueil dans le Canton.
Dès lors, le travail social se transforme. Il faut composer avec trop peu, renier l’accès aux droits élémentaires. Les travailleur·ses de première ligne appliquent des décisions politiques inhumaines, qui trient et répriment les plus précaires. Ce glissement sécuritaire dans les pratiques du travail social n’est que le reflet d’un mouvement plus large à l’échelle sociétale, et des choix révélés encore une fois par ces coupes budgétaires.
Comme le démontre Lucile Franz dans sa thèse qui analyse le phénomène (2022), les problèmes « sociaux » sont de plus en plus amenés à être « gérés » par du sécuritaire : on lutte contre les pauvres plutôt que contre la pauvreté. Les choix budgétaires en témoignent. Tandis que les financements alloués à la police augmentent, ceux du social ne cessent d’être réduits. Mais lorsque « surveiller et punir » prend le pas sur « accueillir et soutenir », c’est toute la vocation du travail social qui vacille.
Marie Crittin