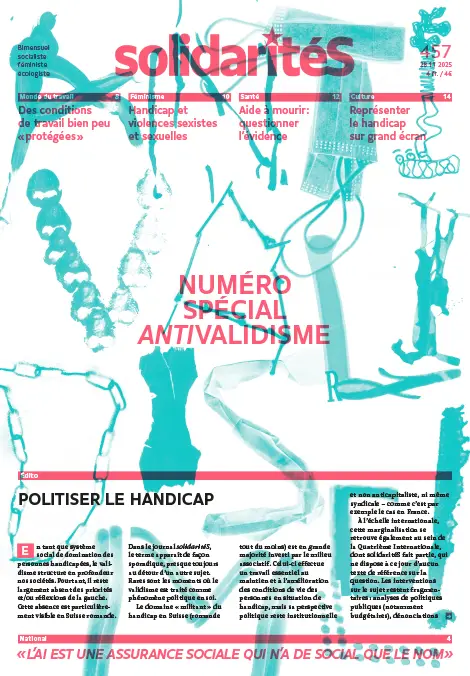Lutter pour la désinstitutionnalisation
L’institutionnalisation des personnes handicapées repose toujours sur les mêmes principes: restriction du choix, routines imposées, isolement et organisation paternaliste. Elle leur retire toute autonomie. Promue à l’échelle internationale, la désinstitutionnalisation apparaît indispensable pour construire des cadres de vie qui garantissent autonomie, inclusion et contrôle réel sur les décisions quotidiennes à toutes et tous.

La désinstitutionnalisation est un processus politique et social qui permet le passage d’une prise en charge en institution, et d’autres environnements isolants et ségrégatifs, à une vie indépendante.
Une désinstitutionnalisation réelle a lieu lorsqu’une personne placée en institution a la possibilité de devenir un·e citoyen·ne à part entière et de prendre le contrôle de sa vie (avec un soutien si nécessaire).
La mise à disposition de logements abordables et accessibles dans la communauté, l’accès aux services publics, l’aide à la personne et le soutien par les pairs sont essentiels au processus de désinstitutionnalisation.
La désinstitutionnalisation vise également à prévenir l’institutionnalisation à l’avenir, en veillant à ce que les enfants puissent grandir avec leur famille et aux côtés de leurs voisin·es et ami·es dans la communauté au lieu d’être séparé·es dans des établissements de soins.
La désinstitutionnalisation n’est pas possible sans le développement de services et de soutiens communautaires qui permettent aux personnes handicapées de vivre de manière indépendante et d’être incluses dans la communauté.
Le développement de services communautaires nécessite une approche à la fois politique et sociale, et consiste en des mesures visant à rendre tous les services publics, tels que le logement, l’éducation, les transports, les soins de santé disponibles et accessibles aux personnes handicapées dans des structures ordinaires.
Les personnes handicapées doivent pouvoir accéder aux services et aux opportunités ordinaires pour vivre en tant que citoyen·nes à part entière. Des services communautaires devraient être mis en place afin d’éliminer le besoin de services spéciaux et séparés, tels que les institutions résidentielles, les écoles spécialisées, les hôpitaux de longue durée pour les soins de santé, le besoin de transports spéciaux (parce que les transports ordinaires sont inaccessibles), etc.
Une transformation systémique
La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) exige des États qu’ils adoptent une stratégie et un plan d’action concrets en faveur de la désinstitutionnalisation. Il s’agit d’un processus qui nécessite une transformation systémique, notamment «la fermeture des institutions et la suppression des réglementations institutionnalisantes dans le cadre d’une stratégie globale, ainsi que la mise en place d’une série de plans de transition individualisés et de services de soutien inclusifs assortis de budgets et de calendriers».
La désinstitutionnalisation nécessite une approche coordonnée et intergouvernementale «qui garantisse des réformes, des budgets et des changements d’attitude appropriés à tous les niveaux et dans tous les secteurs du gouvernement, y compris dans les autorités locales».
Il existe d’autres publications utiles sur la désinstitutionnalisation. Par exemple, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) a publié une série de rapports sur le droit à une vie autonome. En 2012, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a publié un document thématique sur le droit à une vie autonome qui comprend des indicateurs et des questions directrices pouvant être utilisés pour vérifier si les gouvernements mettent en œuvre l’article 19 de la CDPH. La même année, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a publié un rapport sur la vie autonome intitulé Getting a Life.
Il est important de noter qu’en septembre 2022 le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies a adopté les Guidelines on Deinstitutionalisation, including in Emergencies. Ces lignes directrices, fondées sur une série de consultations avec des personnes handicapées du monde entier, définissent les standards clés sur lesquels tout processus de désinstitutionnalisation devrait reposer et qui devraient être respectés. Ces lignes directrices devraient également être utilisées par les gouvernements lors de la planification et la conception de leurs stratégies et plans d’action nationaux, ainsi que pour évaluer les réformes en cours ou passées.
Des logements accessibles et abordables, une éducation inclusive et une reconnaissance égale devant la loi (c’est-à-dire l’abolition de la législation sur la tutelle) sont quelques-unes des conditions préalables à une désinstitutionnalisation réussie, tout comme la pleine participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent, en particulier celles qui ont une expérience de l’institutionnalisation.
Traduit et adapté du site de l’European Network on Independent Living (ENIL) par la rédaction