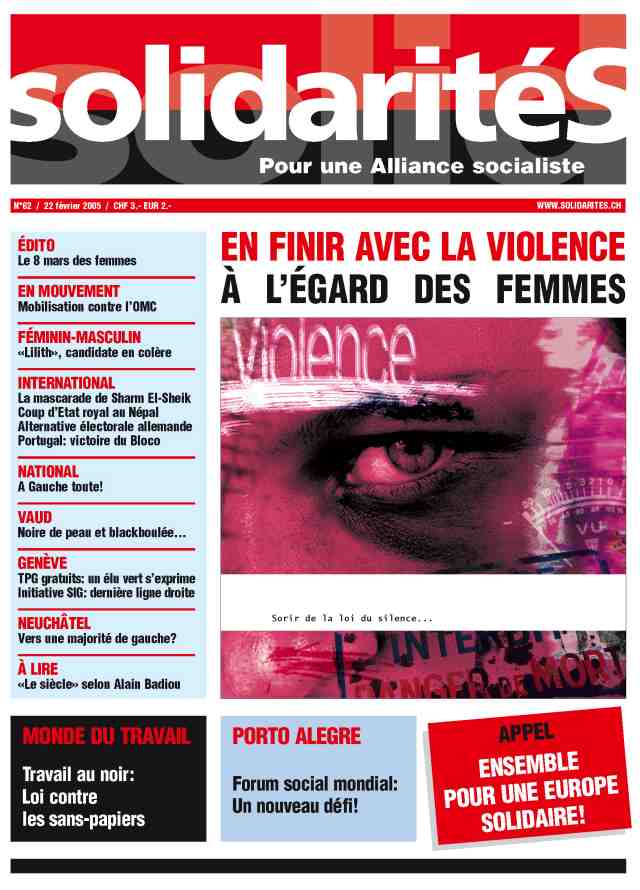Le siècle: un livre d'Alain Badiou
Le siècle: un livre d’Alain Badiou
André Malraux qui lui demandait ce qu’il pensait de la Révolution française, le dirigeant communiste chinois Chou En-Lai rétorqua: «Il est trop tôt pour le dire.» Cette réponse en forme de subversion de la question aurait pu servir d’exergue au nouveau livre que le philosophe Alain Badiou1 consacre au XXe siècle, intitulé Le siècle, qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Bien des analyses portant sur ce dernier révèlent une intention manifeste de la part de leurs auteurs: le clore une fois pour toutes. Tour à tour siècle des barbaries, des idéologies ou des totalitarismes, le siècle écoulé paraît à beaucoup inconcevable au vu de la dynamique civilisatrice à l’uvre au cours des époques précédentes. La chute du mur de Berlin ayant permis à la dynamique en question de reprendre son développement normal, il suffirait désormais de solder le bilan des catastrophes passées afin d’en prendre définitivement congé.
Quoiqu’on en dise, nul ne peut faire l’économie du constat suivant: «Le XXe siècle a eu lieu.» Selon Badiou, prévenir la répétition des tragédies qui l’ont jalonné implique que le siècle soit constitué en véritable objet de pensée. Or, contrairement à ce que suggère la profusion d’ouvrages le concernant, la logique globale qui a présidé à ses destinées est largement sous-théorisée. La compréhension d’une époque n’est pas uniquement affaire de périodisation «court» ou «long» XXe siècle? pas davantage qu’elle ne se suffit de l’accumulation de données factuelles portant sur tel de ses événements marquants. Interpréter un siècle suppose avant tout de s’interroger sur la manière dont il s’est lui-même pensé, c’est-à-dire, comme le dit Badiou, de le «subjectiver comme composition vivante.»
L’une des particularités du XXe siècle est de s’être constamment questionné sur son propre déroulement. Ecrivains, philosophes, artistes ou hommes politiques ont cherché à saisir, alors même qu’elles prenaient forme sous leurs yeux, les transformations sociales et culturelles qu’ils subissaient. La réflexion de Badiou prend ainsi appui sur l’analyse d’une série d’uvres littéraires, philosophiques et politiques tenues pour représentatives du regard porté par le siècle sur lui-même. De Freud à Pessoa, en passant par Lénine et Saint-John Perse, le philosophe capte par fragments le sentiment de la grandeur, de même que la conscience tragique qui lui est indissociablement liée, caractéristiques de cette période.
L’hypothèse qui parcourt l’ouvrage est que loin d’être le siècle des utopies ou des idéologies, le XXe siècle fut au contraire celui de la passion du réel. Selon Badiou, «Le XIXe siècle a annoncé, rêvé, promis, le XXe siècle a déclaré que lui, il faisait, ici et maintenant.» La Première guerre mondiale avait vacciné les populations contre l’excès de confiance en l’Histoire, c’est-à-dire contre l’idée que celle-ci contiendrait en elle-même un principe d’émancipation. Selon une métaphore que Badiou emprunte au poète russe Mandelstam, le siècle fut dès lors assimilé à une «bête», que tout l’enjeu pour les acteurs-trices de l’époque au premier rang desquels le prolétariat était de s’apprivoiser. C’est dans ce contexte que se comprend le volontarisme radical des avant-gardes politiques et artistiques qui marquèrent la période. Car si l’«homme nouveau» n’éclôt pas de lui-même, il s’agit de le forcer à advenir.
Selon Badiou, le XXe siècle fut à bien des égards anti-humaniste. La subordination de l’individu à des catégories collectives race, peuple, classe a certainement été à l’origine de la cruauté inouïe dont le siècle fit preuve à son égard. La gauche ne saurait toutefois se satisfaire de l’humanisme confiant prescrit par l’idéologie des «droits de l’homme», en vogue à l’heure actuelle. Une certaine forme d’anti-humanisme demeure à ce jour la condition de possibilité d’un véritable humanisme. Car, dit le philosophe, «l’homme s’accomplit, non comme plénitude, ou résultat, mais comme absence à soi-même, dans l’arrachement à ce qu’il est, et c’est cet arrachement qui est au principe de toute grandeur aventurière.»
Razmig KEUCHEYAN
- Alain Badiou est né à Rabat, en 1937. Mathématicien, puis philosophe, il enseigne à l’Université de Paris VIII, de 1969 à 1999, avant d’être nommé à l’Ecole Normale Supérieure. Longtemps responsable de l’Union des Jeunesses Communistes (marxistes-léninistes) de France, il s’engage dans l’Organisation Politique, un mouvement post-partidaire qui prône l’intervention populaire directe. Il est l’auteur de plusieurs romans, pièces de théâtre et ouvrages philosophiques, dont L’Etre et l’événement (1988), le Manifeste pour la philosophie (1989) et L’Ethique (1993). C’est le penseur de l’innovation radicale, de ses conditions de développement et de ses acteurs. (réd.)