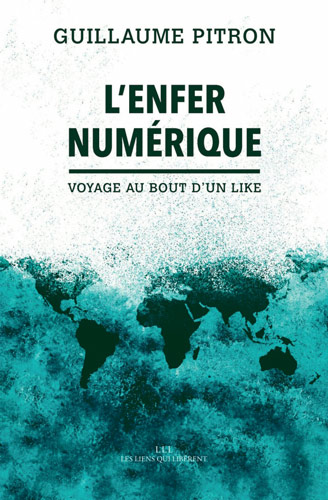Voyage au bout d’un 😭
Un livre dévoile l’usage incontrôlé de matières premières et la consommation croissante d’énergie nécessaire au fonctionnement d’Internet. Le green IT, tout comme le IT for green, sont de vastes escroqueries.

Selon certaines estimations, l’écosystème numérique consomme 10 % de l’électricité mondiale. Soit le troisième consommateur planétaire, derrière la Chine et les États-Unis. Comme l’électricité est aujourd’hui produite à 35 % par du charbon, cela équivaut à environ 4 % des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui donne entre 15 millions et 25 millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone (CO₂) par an, son empreinte représente deux fois celle transport aérien civil.
Pourquoi cette explosion énergétique ?
Le fonctionnement de ce système de communication mondial présente une complexité méconnue. Pour beaucoup d’utilisateurs de périphériques (ordinateurs et surtout téléphones portables), cela semble très simple. Une connexion Wi-Fi vers des antennes invisibles et le tour semble joué. Les écrans affichent une proximité trompeuse. Le développement des technologies numériques a provoqué un malentendu. La simplicité d’utilisation cache une grande complexité de fonctionnement. Non seulement les données voyagent sur des milliers ou des dizaines de milliers de kilomètres, mais elles nécessitent une infrastructure complexe pour y être transportées.
Derrière les antennes, des millions de câbles en métal (vestiges de l’ancien réseau téléphonique fixe) et surtout des millions de câbles en fibre optique transportent les données et les informations numériques. Cette infrastructure câblée passe régulièrement par des aiguillages numériques, qui trient et envoient ces données vers les bonnes destinations, comme sur un réseau ferroviaire. Ces aiguillages transforment aussi les signaux physiques (courant en lumière, et vice-versa), les contrôlent et les codent.
La consommation énergétique pour faire fonctionner ce réseau de transport est gigantesque, tout comme son entretien et sa surveillance. Ce n’est pas de l’énergie grise. La planète n’est pas seulement parcourue par des routes maritimes ou aériennes. Désormais, les fonds des océans sont tapissés par de multiples câbles de fibres optiques, qui assurent le transport des informations, dont la croissance est plus qu’exponentielle.
Un « cloud » d’émissions de CO₂
Après ces transits planétaires, vous arrivez dans d’autres structures informatiques. Ce sont les centres de données, où les informations sont traitées et emmagasinées. Les grandes entreprises d’internet comme les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) ont construit ces infrastructures d’abord pour leurs propres besoins de stockage. Comme l’usage de leurs applications et le nombre d’utilisateurs étaient toujours croissants, cela leur a donné un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises d’informatique historiques (IBM, Oracle) pour proposer des infrastructures de services à d’autres entités, privées ou publiques.
Cette délocalisation a produit le fameux cloud, présenté à tort comme une forme « dématérialisée » de l’informatique. Rien de plus faux. Simplement les machines ne se trouvent plus sur un territoire proche, mais dans de gigantesques usines électroniques, principalement en Asie et aux États-Unis. Ces infrastructures sont très gourmandes en électricité, car il faut alimenter en courant des millions de puces, et les refroidir pour qu’elles continuent à fonctionner en permanence.
Le cryptage, introduit d’abord pour des motifs de sécurité, a encore augmenté le nombre de calculs à effectuer.
Par exemple, les images d’une vidéo-conférence, les vidéos enregistrées, les films téléchargés sont codés et cryptés sur votre périphérique, mais aussi sur les serveurs qui les accueillent.
La pollution carbone digitale est donc colossale, et ne se réduit pas à la fabrication et à l’usage des périphériques. Son fonctionnement global consomme 10 % de l’électricité produite dans le monde, en croissance de 5 à 7 % par année actuellement. L’envoi d’un simple like nécessite le déploiement d’une des plus grandes infrastructures jamais édifiée dans une société, comparable par sa densité au réseau routier mondial.
Finalement, dans les débats pour réglementer l’activité des GAFAM, la question énergétique va apparaître comme de plus en plus cruciale. Ce biais semble plus pertinent que les codes déontologiques ou les jugements moraux pour réguler les activités des réseaux sociaux et les activités numériques. Le recours à l’e-commerce, la réalité virtuelle, les jeux en ligne, la culture du téléchargement doivent aussi être soumis à la critique d’un point de vue énergétique. La sobriété numérique peut devenir un outil d’une perspective écosocialiste. « Le numérique tel qu’il se déploie sous nos yeux n’est pas dans sa très grande majorité mis au service de la planète et du climat. »
José Sanchez