Dépasser l’opposition nature/culture
Notre camarade Claude Calame a publié un petit essai intitulé Humans and Their Environment. Dans une perspective écosocialiste, il y déroule l’évolution de la conception que l’humanité a de son rapport à son environnement en Occident, avec ses effets pratiques, notamment du point de vue écologique. Entretien.

Quelle est la conception dominante que nous avons en occident de la « nature » et du rapport que l’humanité entretient avec elle ?
C’est chez le philosophe Francis Bacon (1516–1626) qu’on trouve une définition fondatrice de l’homme comme «ministre et interprète de la nature». C’est chez lui que l’objectivation, que la réification de l’environnement en nature sont les plus nettes, selon une conception européocentrée. Ainsi l’homme serait maître de ses actions et de ses connaissances sur «l’ordre de la nature».
L’historienne des sciences écoféministe Carolyn Merchant a bien montré que, dès le 16e siècle, la pensée occidentale du progrès scientifique conjugue la justification de la domination des femmes et la domination d’une nature réduite à l’état de machine.
La référence est ici aussi de rigueur à René Descartes, qui trouve dans la physique mécanique de Newton le fondement d’une connaissance portant sur «la force et les actions du feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent». Cette connaissance est à même «de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature» (pour citer un passage célèbre du Discours de la méthode, paru en 1637). Mais Descartes ajoute que ces « artifices » doivent contribuer en particulier à la santé, qui est le fondement des biens de la vie, à l’écart de tout profit économique et financier.
La nuance est essentielle. En effet, la question à laquelle nous sommes désormais confronté·e·s n’est pas uniquement celle de nos usages de notre environnement par les techniques et désormais les technologies qui ont fondé l’industrialisation. Car désormais l’objectif de notre exploitation des ressources offertes par la terre et la biosphère n’est plus celui d’une amélioration du bien commun, mais celui du développement économique et financier (la «croissance» !). Cette exploitation est donc soumise à une marchandisation généralisée, sous l’impulsion de la règle capitaliste, animée par le néolibéralisme, de la maximisation des profits.
Ton livre s’ouvre sur la conception de la ‘nature’ dans la Grèce antique. Comment peut-on résumer celle-ci ?
Ma longue fréquentation professionnelle des manifestations culturelles de la Grèce antique m’a conduit à adopter à leur égard une perspective d’anthropologie critique. Qui dit culture grecque, dit culture éloignée, dans le temps et dans l’espace. Cela implique un regard oblique sur ses représentations et catégories propres, et ce regard décentré permet un retour réflexif et critique sur nos propres concepts et pratiques.
Ainsi en va-t-il par exemple pour la notion de phúsis, généralement donnée comme équivalente de notre concept moderne de «nature». Pourtant, la phúsis n’est pas entendue comme « nature », mais comme processus dynamique de développement du cosmos ou d’un organisme, animal ou humain.
Dans la tragédie d’Eschyle, le héros Prométhée enchaîné aux confins de la terre habitée énumère les arts techniques qu’il a inventés pour les hommes mortels. Ces pratiques sont fondées sur la compréhension que l’homme civilisé a de son environnement ; c’est le cas par exemple de la lecture des astres qui permet agriculture et commerce. Ces techniques sont définies par leur utilité sociale, dans des limites à ne pas dépasser.
Cette double référence à la Grèce classique permet un retour réflexif sur ce que nous, modernes, nous avons constitué en «nature» face à notre «culture». Elle permet de critiquer l’idée de domination et d’exploitation de cette « nature » pour en tirer un profit économique et financier. Cette idée est au cœur du modèle idéologique et pratique imposé par le capitalisme néolibéral ; désormais ce paradigme façonne et détruit aussi bien les individus dans leurs communautés que leurs milieux respectifs.
Tu fais ensuite la critique de cette différence entre «nature» et «culture», qui est encore dominante aujourd’hui.
Je reviens sur les techniques prométhéennes fondées sur une interprétation de l’environnement. Elles nous invitent à revisiter l’opposition tracée entre «nature» et «culture», devenue dangereusement idéologique: non plus la culture face à la nature, mais les relations interactives, complexes des communautés des hommes avec leurs milieux. Loin de constituer une nature objective qui peut être dominée par l’homme, l’environnement s’avère aussi indispensable à l’être humain qu’il est par ailleurs configuré par lui, par ses représentations et par ses pratiques. Il n’y pas d’un côté une nature soumise passivement à la raison humaine et de l’autre une culture des hommes susceptibles, par leur intelligence et leurs arts techniques, de tirer un profit, désormais économique et financier, de cette nature passive.
Tu évoques à plusieurs reprises la recherche en génétique. En quoi celle-ci permet d’envisager une nouvelle conception des interactions entre les humains et leur environnement?
Du point de vue contemporain du génie génétique, les praticiens les plus critiques des sciences de la vie ont largement montré que la mise en œuvre du génome humain ne saurait être compris de manière autonome; c’est dire que l’information génétique de l’organisme humain, contenu dans chacune de ses cellules, n’est pas simplement interprétée comme des phrases codées susceptibles d’un déchiffrement déterministe. La «transcription» de l’ADN en ARN «messager» et sa «traduction» en séquences d’acides aminés dans les protéines qui animent les cellules constitutives de notre organisme vivant ne sauraient être envisagés sans tenir compte d’une double action externe : d’une part l’influence de l’environnement épigénétique et physiologique; d’autre part l’interaction avec le milieu biophysique, avec l’environnement !
Ainsi, l’être humain peut être considéré comme un animal incomplet. En raison même de cet inachèvement constitutif qui est bien montré par le Prométhée d’Eschyle, l’homme se développe à travers ses pratiques culturelles et ceci autant du point de vue de l’histoire de l’espèce que sur le plan de l’individu. Et ces pratiques il les exerce en interaction avec l’environnement dont dépend sa survie.
Face à la crise climatique, plusieurs conceptions de la «nature» sont apparues dans les mouvements qui luttent contre la destruction de l’environnement. À tes yeux, celles de la Pachamama sud-américaine ou de Bruno Latour sont insuffisantes voire problématiques.
À côté de Pachamama, il faudrait aborder la figure de la grecque Gaia. Comme figure d’une hypothétique Terre-Mère primordiale, elle a été recréée par certains mouvements écoféministes étasuniens très fondamentalistes: on s’y réclame d’une nouvelle théalogie (sic !), excluant les figures divines masculines… Je compte revenir dans un petit essai sur ces nouveaux avatars de Gaia.
Quant à la figure de Pachamama, la Terre-mère qui habite et anime la cosmogonie des Aymaras et des Quechuas, peuples amérindiens des Andes, elle est censée favoriser la fertilité des terres et l’abondance de ressources agricoles qui en découle. Identifiée avec la Nature, elle a inspiré les droits de la Terre inscrits successivement en 2008 dans la constitution de l’Équateur, puis dans la loi de la Bolivie en 2010. L’article 71 de la constitution équatorienne stipule désormais que: «La nature, ou Pacha Mama, où se produit et se reproduit la vie, a le droit de voir intégralement respectés son existence et le maintien et la régénération des cycles vitaux, sa structure, ses fonctions et ses processus évolutifs. Toute personne, toute communauté, tout village ou toute nationalité pourra exiger de l’autorité publique qu’elle respecte les droits de la nature».
Par le jeu des majuscules et par le biais théologique de la religion indigène, la nature est à nouveau sacralisée, sinon essentialisée ; de plus elle devient un hypothétique sujet de droit. Mais, divinisée ou non, comment la terre pourrait-elle comparaître et s’exprimer devant une cour de justice ? Comment pourrait-elle se défendre en invoquant une juridiction rédigée par des humains dans un contexte historique, culturel et idéologique particulier ? Les rédacteurs·ices de la constitution bolivienne ont été contraint·e·s de prévoir la création d’un « Défenseur de la Terre-Mère » chargé de la mise en œuvre des droits conçus et formulés par les constituants… La démarche reste donc forcément anthropocentrique.
Quant à Bruno Latour, s’il reconnaît les effets délétères qu’ont sur le système-terre les pratiques humaines caractérisant l’anthropocène, non seulement il recourt au subterfuge linguistique de mettre Gaïa au pluriel (toujours avec majuscule…), mais il y ajoute le sophisme de l’argument historiciste : Gaïa ne correspondrait pas à la Nature, mais selon lui « Gaïa, ce sont les avatars localisés, historiques et profanes de la Nature ». Toute sa réflexion est à l’avenant. Je compte aussi y revenir.
Tu cites Marx, notamment sa célèbre phrase du tome I du Capital : «le capital épuise deux choses, le travailleur et la nature».
C’est bien l’objectivation de notre environnement en nature qui a permis de l’envisager comme un réservoir, supposé inépuisable, de ressources, sans égard aux conséquences de leur exploitation sans limites. Le passage à ce paradigme technique nouveau a marqué l’entrée du genre humain dans ce qu’il est convenu d’appeler l’anthropocène. Par ce concept on fait référence à la période nouvelle, moderne, où dans l’évolution des écosystèmes les pratiques techniques des hommes ont prévalu sur les forces géophysiques. Dans ce mouvement, notre environnement désormais objectivé comme nature a été plié, par le biais de l’industrialisation, à la logique de l’accumulation du capital.
Par la transformation de l’artisanat en travail ouvrier, par la soumission de la production à la valeur marchande, dans la domination de la valeur d’échange sur la valeur d’usage, le modèle patriarcal dominant les sociétés européennes s’est renforcé. Il faut le comprendre avec une approche intersectionnelle : fondée sur la domination de la «nature», la domination généralisée des hommes sur les femmes se combine avec les hiérarchies sociales induites notamment par la naissance d’une classe ouvrière, corvéable à merci. On assiste en effet à une division du travail par son organisation «scientifique» avec pour finalité l’augmentation de la plus-value, au sens marxiste du concept, au profit des détenteur·trice·s du capital – et cela en interaction avec un environnement objectivé en « nature ». Et par une mondialisation fondée sur la seule logique du libre-marché, on assiste à la domination néocoloniale des pays riches sur les plus pauvres, avec les conséquences sociales, culturelles et environnementales que l’on sait.
En conclusion, tu affirmes qu’adopter une ecopoiesis écosocialiste peut nous permettre d’affronter la destruction capitaliste. Qu’entends-tu par cette expression?
Ainsi la transition écologique ne saurait s’opérer sans rupture avec une économie capitaliste destructrice des hommes et de leurs milieux. Elle implique une économie démondialisée et par conséquent plus régionale ; une économie non pas planifiée et centralisée, mais démocratiquement programmée et contrôlée ; une économie fondée sur une forte limitation à la propriété privée dans le retour aux services publics et aux communs (on lira à ce propos les conclusions de la résolution écosocialiste de solidaritéS).
Pour l’anthropologue helléniste que je suis cela signifie que, par comparaison critique avec la Grèce ancienne, cette transition ne peut être qu’écosocialiste. Elle implique un développement écosocial non seulement du processus que j’appelle anthropopoiésis – la fabrication physique, sociale et culturelle de l’homme en interaction avec ses proches ; mais aussi du processus d’écopoiésis – la création de relations constructives et interactives de l’être humain avec un environnement indispensable à son développement biologique et social. Et personnellement, pour la compréhension physique de ce double processus, les pratiques d’escalade, été comme hiver, dans un environnement alpin victime du changement climatique ont été déterminantes !
Propos recueillis par Niels Wehrspann
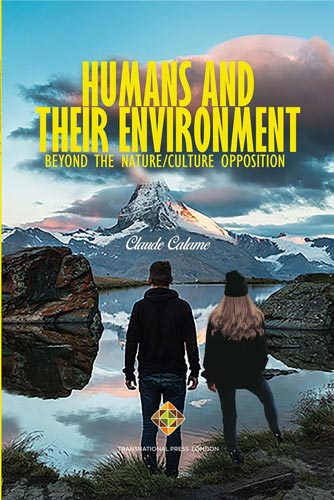 Claude Calame, Humans and Their Environment, Beyond the Nature/Culture Opposition (en anglais), Londres, Transnational Press, 2023.
Claude Calame, Humans and Their Environment, Beyond the Nature/Culture Opposition (en anglais), Londres, Transnational Press, 2023.
Cet ouvrage est une version remaniée de l’essai Avenir de la planète et urgence climatique. Au-delà de l’opposition nature/culture, Paris, Lignes, 2015













