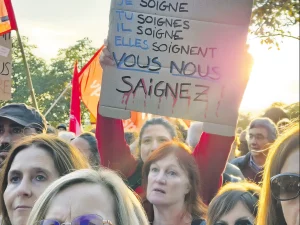Une autre école est possible: un livre de Samuel Joshua
Une autre école est possible: un livre de Samuel Joshua
Samuel Joshua, professeur en Sciences de léducation à lUniversité de Provence, vient de publier un Manifeste pour une éducation émancipatrice sous le titre: Une autre école est possible, Paris, Textuel, 2003. Sa lecture permet de mieux comprendre le débat entre Dario Lopreno (solidaritéS n° 42) et celles/ceux qui, à gauche, sidentifient aux positions de lassociation ARLE (Association Refaire lEcole, Genève) (voir ci-contre). Nous ne pouvons que recommander la lecture de ce petit livre.
En France, depuis le milieu des années 90, on observe une «stagnation du nombre des bacheliers, la fin de la progression du niveau moyen des connaissances (et laugmentation des difficultés pour les plus faibles), laugmentation des tensions, voire de la violence, entre les élèves, et contre linstitution et ses représentants» (p. 9). Pourtant, les «difficultés scolaires» actuelles ne renvoient pas, comme laffirme Luc Ferry, à la «malédiction individualiste datant de Mai 1968». En réalité, elles ne sont pas intelligibles sans la prise en compte de la massification de lenseignement secondaire et de leffondrement de lEtat Providence.
Face à ces évolutions, la gauche a nourri deux attitudes antagonistes, qui conduisent aujourdhui à des impasses symétriques. Dun côté, un secteur estimait que «les inégalités de classe pouvaient être surmontées par une extension continue de la scolarisation. Une école méritocratique, neutre socialement par nature, traitant également les citoyens égaux, serait à même de produire une progression sociale sans discontinuité ( ) Cette stratégie a été durement mise à mal par les mouvements de jeunesse autour de Mai 68, quand, justement, les ressorts de classe de cette école apparemment égalitaire furent dénoncés». Elle sest brisée sur le mur des contre-réformes néolibérales.
Une autre fraction de la gauche a «gardé une solide méfiance pour lécole et ses professeurs», tout en se convainquant que «le capitalisme était un horizon indépassable ( ) de la nature humaine». Mais pour elle, «la démocratie va inévitablement de pair avec lindividualisme et les inégalités» Là encore, «cest la violence de la globalisation capitaliste qui a fait exploser la timide coloration progressiste de ces orientations. Coupés dune perspective socialement transformatrice, tous les thèmes de cette deuxième gauche (individualisation, autonomie, réseaux, projets, critique des savoirs pesants et formels au profit de la formation des compétences) se sont révélés dexcellentes voies de pénétration des offensives néolibérales» (pp. 13-15).
Ce manifeste «reprend et précise les critiques contre les hypocrisies de cette école républicaine farouchement élitiste, incapable de relever les défis contemporains dune éducation de masse». De ce point de vue, «le déferlement des thèmes conservateurs, sur la substitution du répressif à léducatif, sur le retour de la tradition, sur léducation comme transmission de lautorité, la fascination envers un passé mythifié, sont dévidence incompatibles avec une éducation émancipatrice» (p. 122). En même temps, il «rejette systématiquement une certaine position postmoderne, fascinée par lémiettement généralisé, qui nhésite pas à faire dune donnée de fait (la déchirure du corps social, la concurrence et les inégalités en son sein) une valeur symbolique positive» (p. 19).
Samuel Joshua montre aussi que loffensive des milieux dominants ne saurait se réduire à la privatisation de lécole, que les secteurs éclairés du capitalisme ne préconisent pas pour la formation de base. Il rappelle que lécole est «un champ de lutte entre les classes» et que le mouvement socialiste a toujours été partagé entre une méfiance légitime pour linstitution scolaire et un appel au renforcement de lécole pour toutes et tous. Ainsi, les trois questions essentielles «qui est scolarisé?», «quenseigne-t-on?» et «comment enseigne-t-on?» demeurent des enjeux éminemment politiques (p. 67).
Rédaction