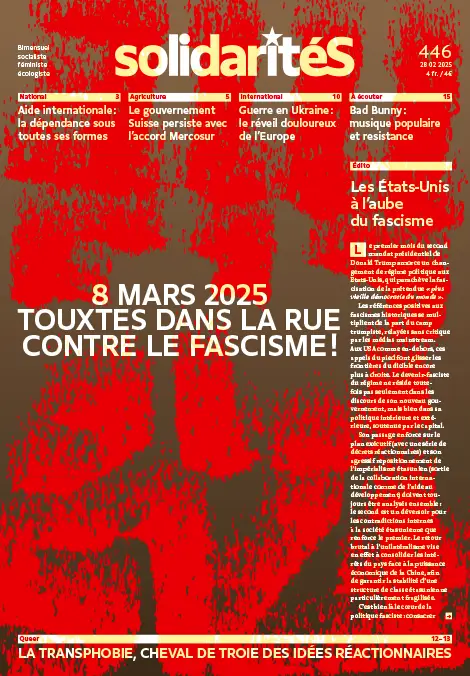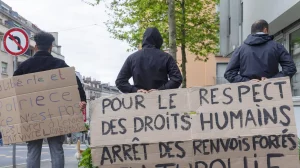Union européenne
La bourgeoisie suisse préfère la désunion
Les négociations en vue de renouveler les accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne ont été bouclées fin 2024. Mais les discussions et consultations vont durer au moins deux ans. Prenons donc un peu de recul sur les relations du petit pays avec ses voisins, avec une série d’entretiens avec Sébastien Guex, ancien professeur d’Histoire contemporaine à l’Unil et auteur de Du pouvoir et du profit (Antipodes, 2022).

En quoi est-il important pour notre camp politique de suivre de près l’évolution des relations entre la classe dirigeante suisse et l’Union européenne?
C’est une question de la plus haute importance puisqu’elle va déterminer les rapports entre la Suisse et l’Union européenne. Elle surdétermine déjà et va surdéterminer encore davantage une bonne partie des débats politiques à la fois sur la politique étrangère mais aussi en matière de politique interne de la Suisse, autour des rapports entre les classes, des rapports entre la droite et la gauche, mais aussi entre les différentes fractions de la bourgeoisie et les diverses composantes de la gauche. Bref, c’est une question qui va jouer un rôle de premier plan dans les prochaines années.
De plus, c’est une question qui est extrêmement complexe, et qui est devenue encore plus complexe durant ces dernières années, vu l’extraordinaire champ que couvrent ces accords. Ils comprennent la libre circulation des personnes, questionnant le marché du travail interne de la Suisse, mais aussi la concurrence que le capitalisme suisse peut exercer vis-à-vis de l’Union européenne ou inversement, en passant par toutes sortes de questions qui vont de l’expulsion ou non des criminel·les étranger·es, la production et la distribution de l’électricité, les transports, la santé, etc.
En fin de compte, ces accords touchent aux questions hautement délicates du degré de souveraineté ainsi que du système politique interne de la Suisse. C’est d’une complexité redoutable. Je peux donner deux exemples, non seulement de la complexité, mais aussi des tensions très élevées que ces questions suscitent au sein de la classe dominante suisse elle-même. Premièrement, durant ces 11–12 dernières années, le Conseil fédéral a procédé à cinq ou six changements à la direction des délégations helvétiques qui négocient avec l’Union Européenne. Le ou la chef·fe a changé tous les deux ans, ce qui témoigne notamment de l’ampleur des divergences au sein des milieux dirigeants suisses. Un autre exemple de cette complexité est l’incroyable longueur de l’accord final: les seuls textes – sans les commentaires – que le Conseil fédéral va soumettre à la consultation en été 2025 comprendront pas moins de 1400 pages!
Tu parles de divergences au sein des classes dirigeantes suisses sur la question européenne. Quelle a été l’orientation, d’un point de vue historique, de la position de la bourgeoisie suisse à l’égard de la construction européenne?
Depuis la constitution de la Suisse moderne, en 1848, la stratégie de la bourgeoise suisse a été de tenter de profiter des rivalités et des conflits entre les différents États, en particulier entre les grandes puissances européennes, pour jouer ses propres cartes et développer ses propres intérêts. Tirer les marrons du feu, pour imager. Et cela, la bourgeoisie suisse a historiquement pu le faire à deux conditions, qui sont les fils rouges de sa politique étrangère depuis le milieu du 19e siècle jusqu’à aujourd’hui.
La première condition pour pouvoir jouer ses propres cartes réside dans la défense de la souveraineté de la Suisse. Pour la classe dirigeante, il est nécessaire de maintenir une pleine souveraineté de la Suisse dans tous les domaines, sur le plan de la politique extérieure et intérieure, en matière de politique économique, monétaire, financière, des transports, etc. Le deuxième axe, c’est le maintien de relations et de liens avec toutes les puissances européennes et mondiales en dépit des conflits, parfois militaires, qui opposent ces dernières. Dans ce sens, la bourgeoisie suisse doit éviter d’entrer dans le giron, de devenir le satellite d’une grande puissance particulière, que ce soit l’Allemagne, la France ou les États-Unis. C’est ce double axe que synthétise ladite «politique de neutralité» de la classe dirigeante en Suisse: la défense de la souveraineté et le maintien de relations avec tous les autres États, en particulier avec toutes les grandes puissances.
Quels ont été les résultats de cette politique extérieure?
Cette politique a été couronnée de succès pour la bourgeoisie suisse. Elle s’est révélée particulièrement efficace, puisqu’elle a permis à ce petit pays, du point de vue de sa surface territoriale et du point de vue démographique, de devenir extrêmement compétitif sur le plan industriel et bancaire par rapport aux autres bourgeoisies, et donc de se transformer en une puissance moyenne sur le plan industriel et même en une puissance de premier ordre sur le plan bancaire. Cette compétitivité extraordinaire du capital industriel, commercial et bancaire suisse s’appuie sur de multiples aspects, mais principalement sur deux grands piliers.
Le premier pilier, ce sont des rapports internes entre capitalistes et salarié·es, particulièrement favorables au patronat. Ou, pour l’exprimer dans le jargon néolibéral, un marché du travail particulièrement flexible. Cela s’exprime notamment par le fait que les salarié·es en Suisse ont beaucoup ou sensiblement moins de droits que dans d’autres États, notamment la plupart des États européens. Par exemple, il n’y a quasiment aucune protection en Suisse contre les licenciements, même pour les délégué·es syndicaux·ales ou les représentant·es du personnel. C’est un gros atout aux mains du patronat.
Le deuxième avantage considérable, en Suisse, est le fait que la plupart des conventions collectives de travail ne garantissent que très peu de choses aux salarié·es. Nombre d’entre elles ne contiennent quasiment rien de mieux que le strict minimum, c’est-à-dire ce qui est inscrit dans le Code des obligations.
Le troisième avantage est le système de l’apprentissage, qui soumet de nombreux·ses salarié·es dès leur plus jeune âge aux diktats du patronat. Tout cela entraîne une productivité particulièrement élevée en Suisse. Ce pays est, pour ne prendre que cet aspect, celui ou l’un de ceux où la durée du travail annuel est la plus longue au monde, avec, en outre, un taux d’absentéisme relativement bas.
Quand les gens ont très peu de droits et craignent de perdre leur boulot, ils travaillent davantage et plus intensivement que dans les pays où ils sont bien protégés. Du point de vue capitaliste, les salaires relativement élevés en Suisse sont donc compensés, en large partie, par une productivité et une flexibilité plus grandes.
Le deuxième pilier de cette réussite, c’est toute la dimension que je résume sous la notion de paradis fiscal suisse, dont l’aspect central réside dans les privilèges fiscaux parfois hallucinants accordés aux capitalistes, tant aux personnes qu’aux entreprises. Cependant, la notion de «paradis fiscal» ne se résume pas, pour moi, à ces privilèges fiscaux. Il s’agit aussi d’un laxisme général, délibéré, d’une permissivité particulièrement étendue de l’État, aux niveaux fédéral, cantonal et communal, vis-à-vis des activités capitalistes. Les entreprises en Suisse peuvent se permettre des choses qu’elles pourraient difficilement se permettre dans d’autres pays, par exemple en matière de corruption, de blanchiment d’argent, etc.
Même si les organisations patronales n’arrêtent pas de prétendre le contraire, dans les faits, l’État est si peu regardant avec les entreprises, en Suisse, qu’on peut aller jusqu’à dire qu’il entretient souvent un rapport clientéliste avec elles. Un seul exemple: récemment le Président du groupe suisse Bertschi a expliqué pourquoi les patrons comme lui étaient farouchement opposés à ce qu’ils appellent «la bureaucratie de Bruxelles» (Le Temps du 19 avril 2024). Quand le journaliste lui a demandé de définir cette bureaucratie, il a simplement répondu qu’en Suisse, le contrôle fiscal de son entreprise de 800 employé·es est terminé en deux jours, alors qu’en Allemagne, le contrôle fiscal de sa filiale comptant 80 employé·es prend jusqu’à deux mois. C’est ça le spectre que craint une large part du patronat helvétique quand il dénonce «la bureaucratie de Bruxelles». En outre, dans certains cantons suisses, une entreprise est soumise à un contrôle fiscal tous les trente ou même quarante ans. Cherchez la différence…
Comment cette position historique de la bourgeoisie suisse a-t-elle évolué avec la géopolitique mondiale?
Ce que je viens de décrire est la position de la classe dirigeante suisse depuis 1850. Au fond, elle aurait voulu et voudrait conserver cette position. À cet égard, il faut se souvenir que non seulement la bourgeoisie suisse n’a pas adhéré à l’Union européenne, mais elle a cherché activement à torpiller sa construction. C’est dans ce sens qu’elle a participé à la création de l’AELE (Association européenne de libre-échange). Mais l’AELE s’est finalement révélé un échec parce qu’elle n’a pas réussi à entraîner la bourgeoisie d’un grand pays, notamment du Royaume-Uni, mais seulement les classes dirigeantes de petits pays. Durant les dernières décennies, le proto-État européen s’est solidifié, ce qui crée une nouvelle situation pour la bourgeoisie suisse. Malgré de très sérieuses difficultés, comme le Brexit et la guerre en Ukraine, le mouvement général va plutôt dans le sens d’une consolidation et d’une extension de ce proto-État européen, avec aujourd’hui 27 États et une monnaie commune. La Suisse est donc géographiquement complètement entourée par ce gigantesque proto-État de 450 millions d’habitant·es, qui concentre à lui seul environ 60% des échanges économiques effectués par la Suisse.
Donc évidemment les rapports de force se sont modifiés en défaveur de la bourgeoisie suisse, cette dernière ne pouvant plus continuer comme avant, et autant qu’avant, à tirer profit des rivalités, des tensions et des guerres entre les puissances européennes. C’est ça la toile de fond des divisions qui traversent la bourgeoisie suisse quant à la stratégie à adopter dans cette situation nouvelle.
Propos recueillis par Lola Crittin