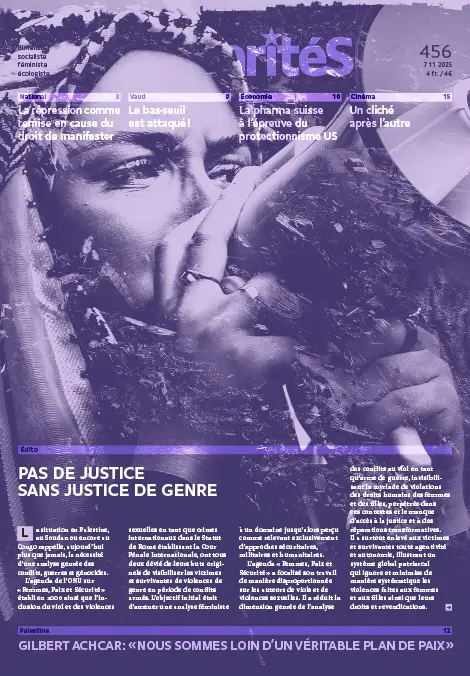États-Unis
La pharma suisse à l’épreuve du protectionnisme étasunien
Sous la pression de Washington, l’industrie pharmaceutique helvétique bute sur les limites de son modèle d’exportation. Dans la recomposition du capitalisme impérialiste étasunien que reflète le bras de fer commercial en cours, la santé devient un instrument de puissance.

L’année 2025 est décidément interminable pour la bourgeoisie suisse. Fin septembre, la Maison Blanche annonce une taxe de 100 % sur les médicaments importés, sauf promesse d’investissements massifs aux États-Unis. Une mesure qui vient clore un été déjà marqué par la hausse de 39 % des droits de douane.
Si de prime abord le projet de taxe annoncé le 1er août impressionnait par son ampleur, il déconcertait tout autant par l’exclusion singulière de la première industrie exportatrice de Suisse : le secteur pharmaceutique. Ce traitement préférentiel, ou plutôt exceptionnel, ne suggérait pas tant une situation privilégiée qu’il ne révélait l’attente d’une réforme spécifique du marché pharmaceutique promise par Donald Trump.
Plusieurs scénarios circulaient alors dans les coulisses : une taxe de 250 % sur les traitements importés, une obligation de relocaliser la production destinée au marché étasunien et une régulation féroce des prix. C’est donc une version allégée qui a finalement été retenue : une taxe de 100 %, évitable sous deux conditions. Premièrement, la promesse de construire de nouvelles usines sur le sol étasunien, deuxièmement, la réduction de certains prix facturés à son système de santé.
On peut toutefois noter toute l’ambiguïté des annonces officielles, qui se font en parallèle des négociations bilatérales entre le gouvernement Trump et les représentants des firmes, mis en scène devant les caméras du monde entier. À ce jour, seuls les géants étasunien Pfizer, britannique AstraZeneca et allemand Merck KGaA se sont prêtés à l’exercice. Roche et Novartis ont, jusqu’à présent, uniquement rappelé leurs projets antérieurs d’investir dans de nouvelles lignes de production – respectivement 50 milliards et 23 milliards – et les discussions avec les autorités sont encore en cours.
Il faut dire que l’enjeu est vital pour les géants helvétiques : le marché étasunien représente à lui seul près de 50 % des dépenses pharmaceutiques mondiales, et tout soubresaut sur les prix menace directement la profitabilité des capitaux investis et, par extension, la stabilité du modèle productif. Si le secteur pharmaceutique pèse un peu moins de 10 % du produit intérieur brut suisse, la moitié de la balance commerciale du pays est constituée de produits pharmaceutiques. En poids financier, Roche et Novartis représentent à eux deux plus d’un tiers de la capitalisation boursière du Swiss Market Index (SMI, l’indice regroupant plus de 80 % des capitalisations boursières suisses) loin devant le secteur assurantiel et financier, et très loin devant les firmes de l’industrie manufacturière traditionnelle.
Rapport de force ou comédie dramatique ?
Il faut encore replacer les discussions entre la Maison-Blanche et les laboratoires dans leur contexte. Depuis plusieurs années, et en dépit des alternances partisanes, deux lignes de fracture nourrissent la discorde entre le gouvernement étasunien et l’industrie pharmaceutique. D’une part, l’augmentation des prix qui pèse sur les dépenses du système de santé des États-Unis, d’autre part, le relatif déficit commercial du secteur face aux autres pays européens.
En 2017, lors de son premier mandat, Trump transforme cette tension en bras de fer ouvert, accusant publiquement les laboratoires « d’assassiner les contribuables ». Le ton est donné, le constat est plutôt juste.
En 2020, Trump tente d’imposer la règle de la « Nation la plus favorisée », qui alignerait certains prix pratiqués sur le marché étasunien avec les prix les plus bas constatés dans les pays de l’OCDE. Le dispositif est finalement bloqué par les tribunaux, puis abandonné.
Deux ans plus tard, Biden reprend la main avec l’Inflation Reduction Act (IRA) qui autorise pour la première fois le système d’assurance pour personnes âgées Medicare à négocier directement les prix de certains médicaments avec l’industrie. Cette négociation concentre immédiatement l’hostilité du patronat de la pharmaceutique qui se lance dans un lobbying agressif et dans une offensive judiciaire auxquels participent pleinement les grands groupes multinationaux suisses.
En 2025, Trump affiche sa volonté de finaliser les négociations tout en maintenant un véritable flou sur la méthode. Un bras de fer dont le président est désormais coutumier, pays par pays, secteur par secteur, industrie par industrie. L’enjeu consisterait à réindustrialiser le pays, à diminuer le déficit de la balance commerciale et à muscler les sources de financement de l’État fédéral. Un jeu d’équilibriste filmé en 4K, visant à satisfaire une base sociale aux intérêts contradictoires. D’un côté, celles et ceux qui plébiscitent la lutte contre l’inflation, en particulier celle des produits de santé, et qui se réjouissent de l’arrivée de nouveaux capitaux industriels sur le sol national. De l’autre, les monopoles technologiques aux intérêts mondialisés qu’il ne faut surtout pas faire fuir.
À ce bras de fer télévisé, on peut toutefois opposer la relative faiblesse des concessions faites par le capital pharmaceutique. Premièrement, parce que contrairement à l’IRA, les accords concernent le programme de sécurité sociale Medicaid, dont le poids budgétaire est significativement plus faible que celui de Medicare. Ensuite, parce que les promesses d’investissement relèvent, à certains égards, d’effets d’annonce : elles étaient prévues indépendamment des récentes négociation et leur réalisation concrète se fera dans plusieurs années (voire après le mandat de Trump). Enfin, parce que la réduction des prix se fera surtout par la suppression des intermédiaires, via la mise en place d’une plateforme numérique nommée TrumpRx, permettant aux laboratoires de vendre leurs traitements directement aux patient·exs.
Un jeu de dupes, donc ? Les « marchés » n’ont pas tardé à saisir le message, avec une croissance des titres de plus de 10 % en quelques jours – un record depuis 2002.
L’irrésistible destin étasunien de la pharma suisse ?
Alors même que le secteur enregistre des marges confortables, des dividendes en série et des rémunérations patronales à huit chiffres. Pour le capitalisme suisse, les annonces successives venant des États-Unis constituent une sérieuse déstabilisation de son modèle d’exportation. Il reste toutefois difficile, aujourd’hui, de mesurer l’ampleur des répercussions sur le tissu productif helvétique. Le rapport de force esquissé plus haut n’a pas encore déployé tous ses effets.
La première des conséquences consiste à répercuter le « manque à gagner » du marché étasunien sur les systèmes de santé occidentaux. Autrement dit : faire payer la Suisse et l’Europe. La pharma vivrait en quelque sorte ce que l’industrie de la guerre a connu quelques mois plus tôt, à savoir une tentative de transfert du poids des dépenses vers les systèmes de santé des pays de l’OCDE. Cette brèche a été immédiatement exploitée par la pharma. Le CEO de Novartis l’a formulé sans détour dans une interview à la NZZ : « Nous travaillons avec le gouvernement [étasunien] et nous essayons de trouver des solutions constructives pour que les Américains paient moins pour leurs médicaments. (…) En particulier en Suisse, les prix des médicaments sont beaucoup trop bas. » Quelques semaines plus tard, Roche annonçait le retrait immédiat de son traitement oncologique Lunsumio du marché helvétique. La multinationale amplifie ainsi son bras de fer avec le Conseil fédéral et l’Office fédéral de la santé publique, en prétextant un risque de « dumping » sur les prix qui donnerait des idées à d’autres pays.
Le retour de la clause de la « Nation la plus favorisée » devient, paradoxalement, une défense coordonnée de ce qu’il reste du modèle libéral étasunien et une offensive frontale contre les institutions de régulation du vieux marché européen. Une lame de fond aux résultats jusqu’ici connus : la hausse continue des primes d’assurance maladie.
Sur l’emploi, ce sont les travailleur·sxes qui paieront. La question des prix servant presque systématiquement de prétexte aux plans de licenciement dont l’industrie est coutumière. L’année passée, Novartis publiait un plan de restructuration visant 440 postes dans ses départements de recherche en Suisse. Le signal est clair. Le rapport de force risque de déplacer hors de Suisse certaines lignes de production, mais également des fonctions jusqu’ici considérées comme intouchables : développement clinique, affaires réglementaires, gestion d’essais. Les emplois hautement qualifiés ne sont plus garantis de rester sur le territoire.
Face à ces pressions croisées, les capitaux suisses se tournent également vers la Chine, qui apparaît comme une possible roue de secours. Novartis répète depuis ce printemps que Pékin, en réponse à Trump, cherche ouvertement à se présenter comme juridiction « stable » et « amicale » pour les multinationales. Le capital se trouve ainsi dans un vrai jeu d’équilibriste entre deux arrière-bases en concurrence directe : la valeur du marché étasunien contre le dynamisme du marché chinois. Dans les deux cas, ce sont les systèmes de soins, les patient·exs et les travailleur·sxes qui feront les frais de cette période de recomposition.
Refuser l’austérité, déprivatiser et socialiser le progrès médical
La séquence actuelle montre comment le capital pharmaceutique organise déjà sa propre survie. Face à cela, le camp progressiste ne peut ni rester spectateur ni accepter de payer les coûts des guerres commerciales entre impérialistes. Le progrès médical ne peut plus être brandi comme « intérêt national » quand il sert en réalité à protéger des marges et des profits. L’accès universel aux traitements, la levée des brevets et la socialisation du travail d’innovation doivent être mis sur la table des négociations par la création de pôles internationaux du médicament.
Le refus des logiques austéritaires et la défense de l’emploi dans la branche restent évidemment centraux, mais ils doivent devenir une revendication de contrôle : contrôle ouvrier et contrôle des usager·exs sur les moyens de produire du soin.
Jimmy