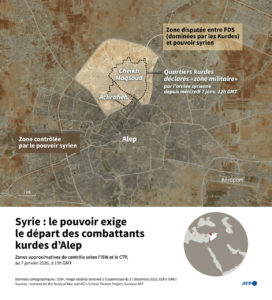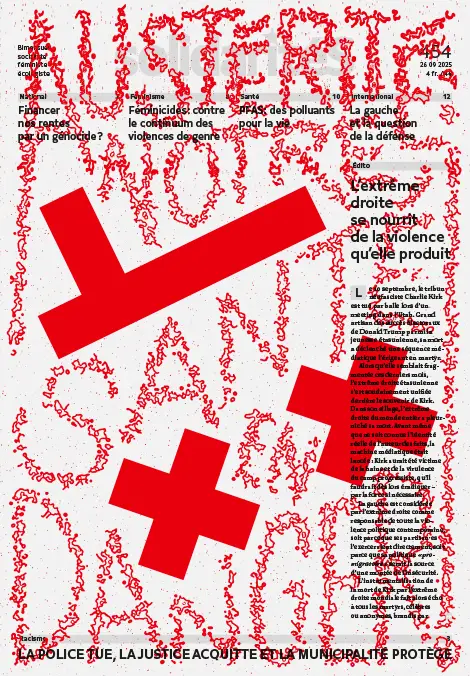France
L’autre république en marche
La France d’en bas s’agite à nouveau. À la crise politique s’ajoute la crise sociale. De nouvelles perspectives sont désormais possibles.

En mobilisant plus de 80000 policier·es, l’ex-ministre de l’intérieur et le roi de l’Élysée ont clairement montré leur méthode pour affronter les participant·es au mouvement du 10 septembre, l’intimidation, la peur et la répression. Face à la mobilisation organisée par les syndicats le 18 septembre, la même approche a été utilisée.
La volonté de criminaliser le mouvement, en le jugeant violent et manipulé par certains courants politiques, en spéculant sur des images de confrontation et de dégâts matériels, n’a manifestement pas fonctionné dans les deux cas.
Bloquons tout!
La très grande majorité des actions de mercredi (piquets de blocage, manifestations, rassemblements) a mis en mouvement de nouvelles forces et a probablement ouvert une nouvelle période de mobilisations en France.
Loin des calculs électoraux (municipales en 2026, présidentielle en 2027) et des manœuvres des grandes écuries politiques de gauche, le mouvement va peut-être modifier la carte militante.
Ce mouvement, né d’appels sur les réseaux sociaux, s’est ensuite transformé dans son organisation. Des assemblées générales ouvertes se sont déroulées, avec des participations variables, et des compositions sociales inédites et diverses.
Les participant·es ont pu s’exprimer librement sur les types d’actions et de revendications, faire une nouvelle ou une première expérience de démocratie, d’unité et de discussion politique. Dans le cafouillage et les arrière-pensées électoralistes de la gauche, ce fait est à souligner. Les activistes n’étaient pas des petit·es soldat·es, prêt·es à suivre et à obéir à un·e chef·fe. Cette expérience de démocratie et d’unité est totalement différente des pratiques sur les réseaux sociaux.
Le tour des syndicats
Les centaines de rassemblements ou manifestations organisées à l’appel de l’intersyndicale (regroupant huit fédérations) le 18 septembre a réuni environ 700000 personnes. Plus classique que la mobilisation précédente, mais bien plus massive. La coalition des huit syndicats n’a pas exprimé d’objectif précis, en s’opposant à une série de propositions du gouvernement démissionnaire, et susceptibles d’être retirées.
Les limites objectives à élargir ce nouveau mouvement de protestation, ou à simplement y participer activement, ne doivent pas être minimisées. La précarité et la paupérisation du monde du travail augmentent. Cette aggravation de la situation alimente bien sûr la colère sociale, elle peut aussi engendrer du désespoir. L’impossibilité pour de bas revenus de perdre une journée de salaire n’est pas à négliger. Surtout si cette action n’apparaît pas comme déterminante.
S’agit-il de refaire des journées d’action espacées et imposées par l’agenda des confédérations syndicales comme durant la lutte des retraites en 2023? L’échec de cette stratégie a suscité de multiples interrogations quant à la manière de s’opposer à l’arrogance gouvernementale.
En bon élève de Macron, l’ex-premier ministre Bayrou a exaspéré par ses propositions. Parlant seulement d’économies pour réduire les déficits budgétaires, dont il rend responsable l’ensemble de la population, il refuse de taxer les grandes fortunes et de revenir sur les cadeaux fiscaux de la macronie. Ainsi il gonfle la colère populaire, en proposant par exemple de supprimer deux jours fériés.
Et maintenant?
Le mouvement du 10 septembre représente ainsi une détermination à exprimer une opposition sans compromis, illustrée par le slogan «bloquons tout» et avec un horizon politique plus large qu’un simple changement de personnel politique.
Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT a déclaré que le budget «se fera dans la rue». Sur le principe, elle a raison de mettre en avant les rapports de force en s’appuyant sur les classes populaires plutôt que de compter sur des manœuvres au sein de l’Assemblée nationale ou d’autres échéances institutionnelles. Mais comment compte-t-elle élargir la mobilisation, transformer la colère en détermination et le désespoir en mouvement? Le mouvement du 10 septembre avait mis en avant une stratégie, «bloquons tout», après le constat que des manifestations massives n’avaient pas réussi à obtenir le retrait de la réforme des retraites en 2023.
La principale faiblesse de ces deux mouvements était l’absence de revendications sociales centrales, susceptible de rassembler et d’unir un large spectre professionnel et générationnel. L’austérité ne se combattra pas en exigeant le départ de Macron, mais en combinant des moyens de lutte radicaux peu employés impliquant une masse de participant·es, en les faisant monter contre une ou deux mesures décidées par le nouveau gouvernement.
Ces deux actions de septembre ne peuvent être qu’un début, afin de construire un mouvement plus vaste, durable et offensif. D’autres perspectives sont désormais possibles. Dans la situation de déprime actuelle, une étincelle peut faire partir et grossir un vaste mouvement, comme l’avaient encore rappelé les «gilets jaunes».
José Sanchez