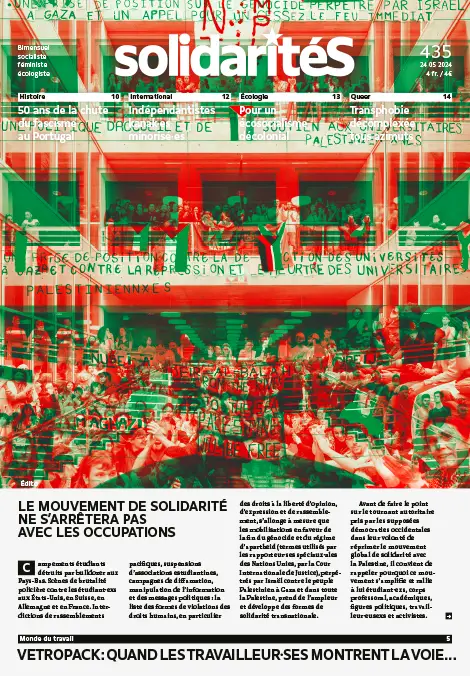Portugal
50 ans de la chute du fascisme au Portugal
La Révolution des Œillets a 50 ans cette année. C’est la dernière en Europe de l’Ouest. Elle a été fêtée par des centaines de milliers de personnes à Lisbonne et dans le reste du Portugal et relayée par la presse internationale comme jamais. Entretien avec Ugo Palheta, sociologue, auteur de Découvrir la révolution des Œillets.

À l’heure où fleurissent les mouvements décoloniaux, ce cinquantenaire s’inscrit pleinement dans l’actualité puisque tu expliques que la Révolution n’aurait pas eu lieu sans les mouvements d’indépendance existants dans les colonies portugaises.
Effectivement, c’est bien l’action héroïque des mouvements anticoloniaux – en particulier en Angola, en Guinée-Bissau et au Mozambique – qui a permis la chute du régime en accentuant toutes ses contradictions, ces dernières finissant par exploser en 1974. Au début des années 1970, le Portugal est un pays dominé par les grandes puissances capitalistes. Un pays dépendant à bien des égards et le plus pauvre d’Europe, mais c’est également un très vieil empire.
Outre les profits que les grands monopoles capitalistes portugais tirent du pillage et de surexploitation des colonies, le fascisme portugais – mais la République avant lui également – a fait du maintien de l’Empire un enjeu politique et symbolique central.
Quand les militant·es anti-coloniaux·ales angolais·es lancent une première offensive en 1961, le régime intensifie la propagande coloniale pour susciter une union sacrée autour de la défense de l’empire (l’obtenant en bonne partie au début, les communistes mis·es à part), et lance une guerre qui va durer 13 ans, jusqu’au 25 avril 1974. Entretemps, la dictature va consacrer une part de plus en plus importante de ses ressources à la guerre (jusqu’à 40% du budget de l’État), rendant impossible de satisfaire un tant soit peu les besoins de la population. Dans les campagnes, les quartiers populaires des villes et a fortiori les bidonvilles qui ont poussé dans les années 1960 à Lisbonne et Porto notamment, la population vit dans des conditions misérables.
Avec l’instauration du service militaire de quatre ans en 1968, c’est cette misère qui va pousser à l’exil plus d’un million de Portugais·es, dans un pays qui compte à peine plus de 8 millions d’habitant·es au début des années 1970. Paradoxalement, c’est de l’institution qui constituait le pilier du régime – l’armée – que va venir la solution, puisque le régime tombe en quelques heures le 25 avril 1974, grâce à un soulèvement militaire mis en œuvre par un mouvement clandestin d’officiers intermédiaires (capitaines et commandants), convaincus qu’il faut en finir avec la guerre coloniale et, pour cela, se débarrasser de la dictature.
Dans les manuels d’histoire, la Révolution des Œillets est décrite comme un mouvement de révolte d’officiers intermédiaires contre la dictature qui, après quelques péripéties, remettent le pouvoir à des gens sérieux et forcément démocratiques. La réalité est plus complexe et a suscité un espoir anticapitaliste tant dans le pays, que dans notre camp social ailleurs.
On oublie bien souvent que la Révolution portugaise, ce ne sont pas seulement les œillets du 25 avril 1974. L’image très photogénique de ces soldats acclamés par la foule et mettant des fleurs à la pointe de leurs fusils.
Évidemment, la chute d’une dictature fasciste presque cinquantenaire est en elle-même un fait d’une importance considérable, qu’il importe de célébrer. Mais il ne doit pas faire oublier la part inassimilable, par la bourgeoisie, du 25 avril: le fait que cette journée inaugure un processus révolutionnaire de 19 mois qui ne fut prévu par personne. Le 25 avril aurait en effet pu demeurer une transition dans l’ordre entre une forme politique particulièrement brutale de domination du capital à une autre, reposant sur des élections libres et pluralistes, et la garantie de certaines libertés démocratiques. C’est grosso modo ce qui va se passer dans l’État espagnol. Au Portugal, c’est alors le projet de la fraction de la bourgeoisie aspirant à une modernisation de l’économie nationale, mais aussi du MFA (Mouvement des forces armées, regroupant les officiers opposés à la dictature).
Ce qui va déjouer ces plans, c’est l’irruption sur la scène politique des travailleurs·euses des villes et des campagnes du Sud, par les méthodes du mouvement ouvrier: grèves de masse, occupations, blocages, manifestations de rue quasi-quotidiennes, etc. Le propre d’une révolution, pour reprendre la définition de Lénine, c’est que les dominants ne peuvent plus (dominer comme ils le faisaient), et que les dominé·es ne veulent plus (être dominé·es comme ils et elles l’étaient). C’est précisément ce qui se joue au Portugal en 1974-75. Non seulement un État paralysé et fracturé (notamment du fait de l’action de ces capitaines qui brisent la hiérarchie militaire), accompagnant une insubordination généralisée des classes populaires. Mais aussi les plus grands mouvements grévistes de l’histoire portugaise, une multiplication des initiatives de contrôle ouvrier dans les grandes usines, un vaste mouvement d’occupation et d’autogestion de terres dans les campagnes du Sud, l’appropriation à une échelle de masse de maisons vides pour loger des habitant·es des bidonvilles, créer des crèches, etc.
Cinquante ans plus tard, le parti d’extrême droite Chega («ça suffit») remporte 50 sièges avec 18% des voix aux élections du 10 mars dernier. Le dirigeant de ce mouvement se revendique aussi du 25 avril qui aurait été confisqué par la gauche et l’extrême-gauche, tout en faisant sa campagne en attaquant les minorités (gitan·es, migrant·es, de genre… ), en promettant d’abroger les accords de circulation avec les anciennes colonies et en dénonçant une insécurité peu existante dans le pays. Bref, les thèmes classiques de ses confrères en France, en Italie, en Suisse… Comment en est-on arrivé là?
Ce que rejette Chega, c’est précisément le processus révolutionnaire portugais. Car ce processus a permis la décolonisation, alors qu’une partie de la bourgeoisie portugaise et leur représentant politico-militaire après le 25 avril, le général Spínola, voulaient une solution néocoloniale: une fédération sous domination portugaise. Ce sont aussi les luttes populaires après le 25 avril qui ont permis d’imposer les libertés politiques fondamentales pour la classe travailleuse, en particulier le droit de grève, alors que Spínola voulait un État fort avec une législation très restrictive en matière de grève.
Ce qu’exalte Chega et son leader trumpiste Ventura, c’est à la fois la nostalgie de l’empire, un régime autoritaire où chacun·e restait à sa place, le racisme anti-tsiganes et anti-immigré·es, la négrophobie, ou encore la misogynie (d’où son attrait important pour les jeunes hommes, qui réagissent à la montée du féminisme par un masculinisme exacerbé).
Mais la progression rapide de Chega s’explique également par une série de facteurs politiques: en premier lieu la déception, voire le sentiment de trahison, qu’a engendré l’expérience du PS au pouvoir (surtout au regard des accusations de corruption qui ont conduit à la démission d’Antonio Costa, le Premier ministre socialiste pendant 9 ans) ; la radicalisation de certains secteurs de la droite politique (de nombreux cadres actuels de Chega viennent des partis traditionnels: PSD et CDS-PP) ; la présence croissante dans les médias dominants de cet agitateur habile qu’est Ventura qui, comme ses équivalents ailleurs, a su alimenter diverses «paniques morales» ; la lame de fond internationale en faveur de l’extrême droite (avec l’influence spécifique du bolsonarisme au Portugal, à travers divers influenceurs s’exprimant sur les réseaux sociaux).
Il faut ajouter à cela que l’extrême droite n’avait jamais disparu au Portugal: non seulement existaient des courants politiques (il est vrai jusque-là groupusculaires), mais aussi et surtout des sensibilités présentes dans les organisations de droite ou les médias dominants.
Dans ce contexte, émaillé aussi d’affaires touchant le PS, quel rôle notre camp social (du Bloc de gauche aux collectifs de soutien aux sans-papiers, de Luta Justa, collectif de quartier aux syndicats et d’autres) peut-il jouer pour faire revivre les idéaux sociaux et anticapitalistes portés en 1974 et 1975?
Comme dans bien des pays, l’un des facteurs de la montée de l’extrême droite c’est effectivement la difficulté pour la gauche radicale portugaise – Bloc de gauche mais aussi Parti communiste portugais – à apparaître comme une alternative politique, y compris sur le terrain électoral.
Après les années marquées par une cure d’austérité extrêmement brutale imposée au peuple portugais par la Troïka (Commission européenne, Banque centrale européenne et FMI), le Bloc et le PCP ont été amenés à soutenir le PS sans participation au gouvernement. Cela a permis certaines mesures positives dans la période 2015-2019, mais pas de retour sur les pires contre-réformes de la Troïka (et encore moins des conquêtes sociales).
Lorsque ces deux partis ont fini par lâcher le PS, ils ont été sanctionnés électoralement et le PS a obtenu une majorité absolue. La division entre les deux forces, liée au sectarisme du PCP qui depuis la fondation du Bloc de gauche (1999) refuse toute discussion avec lui, n’y est pas pour rien.
Mais comme ailleurs il y a une difficulté de plus grande ampleur, à savoir les liens distendus de la gauche radicale avec les classes populaires. Accroître notre capacité hégémonique, autrement dit, unifier autant que possible la classe travailleuse – avec ou sans emploi, des villes et des campagnes – autour d’un projet politique de rupture et entraîner dans son sillage d’autres couches sociales (petite bourgeoisie salariée, petit·es indépendant·es appauvri·es, etc.), dans les luttes comme dans les urnes, voilà sans doute la tâche historique de la gauche, au Portugal comme ailleurs. On ne sait pas quelle étincelle mettra le feu à la plaine mais des explosions sociales et des convulsions politiques vont survenir: il faut s’y préparer en accroissant le niveau d’organisation des exploité·es et des opprimé·es, en brisant les sectarismes croisés (entre secteurs de lutte, entre organisations) et en toute indépendance de la bourgeoisie et de ses représentant·es politiques.
Entretien de la rédaction












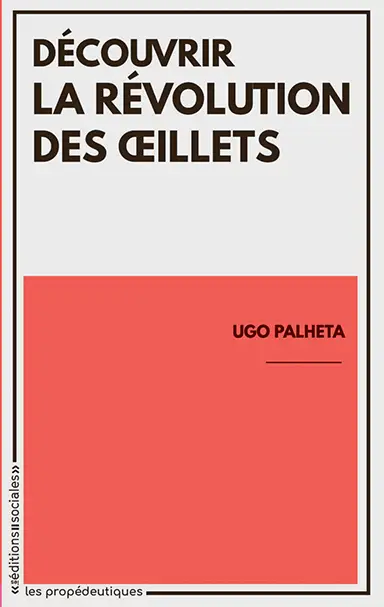 Ugo Palheta, Découvrir la révolution des Œillets. Portugal (1974–1976). Paris, Éditions sociales, 2024
Ugo Palheta, Découvrir la révolution des Œillets. Portugal (1974–1976). Paris, Éditions sociales, 2024