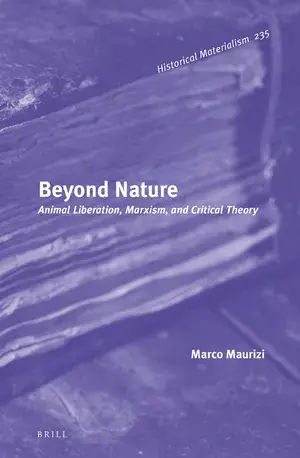Dans le regard terrifié des animaux: le matérialisme
La domination des animaux non-humains est intrinsèquement liée à celle des humains par d’autres. Quelques aspects de cette relation avec Marco Maurizi, qui interviendra lors de l’atelier «Marxisme et cause animale» lors de notre université de printemps 2025.

Ce qui me semble vraiment intéressant dans votre approche de la libération animale, c’est le rappel constant à situer historiquement les relations entre l’humain et la nature et entre l’humain et les animaux non-humains et également à évacuer les préoccupations morales. Un exemple frappant est lorsque, dans la partie de votre livre qui s’appuie principalement de la pensée de Marx et Engels, vous affirmez que l’exploitation des animaux (non-humains) était une «nécessité historique». Que faut-il comprendre par cela?
Par «nécessité historique», je n’insinue pas que cette exploitation était éthiquement justifiée ou inévitable au sens métaphysique. Je suggère plutôt que l’exploitation des animaux est apparue dans des conditions matérielles et des relations sociales spécifiques qui l’ont rendue fonctionnellement nécessaire au développement de certains modes de production. Il s’agit là d’un point de vue historico-matérialiste: les formations sociales ne résultent pas de choix moraux, mais des besoins structurels et des contradictions des sociétés humaines à différents stades de leur développement. Marx et Engels parlent souvent de «nécessité» dans ce sens, non pas pour excuser la domination, mais pour en comprendre les racines. Dans les sociétés de classes primitives, par exemple, la domestication et l’instrumentalisation des animaux ont joué un rôle clé dans la division du travail, l’accumulation des surplus et l’établissement de la propriété privée. Il s’agissait là de conditions matérielles préalables à la domination de classe, et l’exploitation des animaux s’y est intégrée.
N’étant pas primitiviste, je considère le développement de la Civilisation comme une étape importante non seulement pour la croissance de notre potentiel en tant qu’espèce mais aussi pour l’autodétermination de l’humanité en tant que sujet actif de son histoire, c’est-à-dire la condition préalable à tout discours moral sur notre relation à la nature.
Le but de cette analyse est de déplacer le discours d’un débat moral abstrait sur le comportement individuel vers une critique politique des structures socio-économiques qui produisent et entretiennent l’exploitation animale. Ce n’est qu’en historicisant ces relations que nous pourrons comprendre comment les abolir, non pas par la culpabilité ou la pureté, mais par une transformation collective.
Au cours de l’histoire, l’intégration de l’exploitation animale dans la production a évolué, mais y a-t-il des spécificités de l’exploitation animale sous le capitalisme?
Oui, absolument. Du point de vue d’une théorie «monétaire» du capital (que j’approuve), le capitalisme n’est pas motivé par la production de valeurs d’usage, mais par la réalisation de valeurs d’échange. Cela signifie qu’il est structurellement indifférent à la nature spécifique ou à la subjectivité de ce qui entre dans ses circuits de valorisation – ce qui compte, c’est de savoir si quelque chose peut être abstrait, quantifié et rentabilisé. En ce sens, les animaux ne sont pas exploités pour ce qu’ils sont, mais parce qu’ils peuvent être transformés en marchandises porteuses de valeur. En même temps, le capitalisme dépend aussi fondamentalement de la domination de la nature. Ainsi, le profit exige non seulement l’exploitation du travail, mais aussi la transformation constante du monde naturel.
Le capitalisme est un système intrinsèquement développementaliste, basé sur la nécessité d’étendre perpétuellement les forces productives et de repousser de nouvelles frontières à l’accumulation.
Par conséquent, les animaux et la nature en général sont non seulement dominés, mais aussi continuellement remodelés et subordonnés à la logique du capital. Cet assujettissement prend des formes historiquement spécifiques, mais la dynamique sous-jacente demeure: la nature doit être rendue productive pour le capital.
C’est pourquoi la question de la libération des animaux doit être comprise comme inséparable du mode de production lui-même. Tant que le système économique reste organisé autour de la production de valeur d’échange et de l’expansion sans fin des forces productives, la domination des animaux et de la nature persistera sous de nouvelles formes. Une véritable transformation exige une rupture avec cette logique, un changement systémique.
Vous citez Horkheimer: «La domination de la nature implique la domination de l’homme». Comment fonctionne cette relation?
Cette citation est cruciale pour comprendre la relation dialectique entre ce que lui et Adorno appellent la nature «extérieure» et la nature «intérieure». La domination de la nature extérieure – animaux, écosystèmes, monde matériel – n’est jamais un simple acte technique ou instrumental. Elle implique toujours, et présuppose en fait, un processus d’auto-domination: la suppression de nos désirs, sensibilités et capacités relationnelles qui nous lient au monde non-humain. La «nature intérieure» fait référence à l’être humain en tant qu’être naturel – nos pulsions, nos affects, notre existence incarnée – et à la manière dont ceux-ci sont façonnés et réprimés au sein d’un ordre social donné.
Pour dominer le monde extérieur, les êtres humains ont d’abord dû se dominer eux-mêmes: discipliner les corps, fragmenter les perceptions, rationaliser les expériences. Ce processus, intensifié sous le capitalisme, conduit à une forme de subjectivité adaptée aux besoins de la production et du contrôle social, mais coupée du reste de la vie.
Encore une fois, la domination des animaux n’est pas une simple défaite éthique; c’est un moment dans une dialectique plus large d’aliénation. Lorsque nous réduisons les animaux à des moyens de production, nous nous réduisons également nous-mêmes – notre nature profonde – à de simples instruments de travail et de production de valeur. Pour inverser cette logique, il faut non seulement libérer les animaux de l’exploitation, mais aussi récupérer la capacité humaine à établir des relations non instrumentales, affectives et réciproques avec le monde naturel. En d’autres termes, il s’agit de transformer la nature extérieure et intérieure.
Propos recueillis par Niels Wehrspann