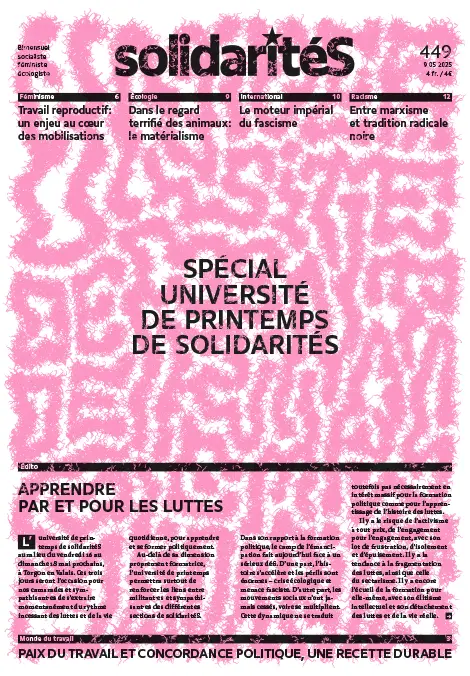Préserver nos conditions d’existence, un enjeu de lutte sur tous les fronts
solidaritéS se définissant comme un mouvement écosocialiste, un atelier de l’université de printemps 2025 abordera les implications de cette orientation. Un autre mettera en discussion les perspectives stratégiques de ces luttes telles qu’elles se déploient dans le monde occidental. Nous publions ici une contribution de Kelmy Matinez, membre des Grondements Des Terres et de solidaritéS.

Il est difficile de dater l’émergence des mouvements environnementaux tant l’histoire regorge d’exemples de populations s’élevant pour la préservation de leurs droits d’accès aux communs et contre la dégradation de leur environnement. Mais, il est indéniable que les années 1970 marquent un tournant dans la conception de l’écologie politique telle qu’on la connait aujourd’hui en Occident. Les acteurs·rices des luttes environnementales d’alors se réunissent notamment autour de la question de l’atome.
À titre d’exemple, Greenpeace naît en 1971 lorsque des militant·es embarquent dans un navire vers une zone d’essai nucléaire au large de l’Alaska afin d’empêcher les essais de l’armée étasunienne.
Cette même décennie est marquée par un momentum écologique avec notamment la publication du premier rapport du Club de Rome sobrement intitulé Les limites à la croissance (Rapport Meadows). Abordant la question des limites planétaires à l’aune des croissances économiques et démographiques, les scientifiques établissaient alors plusieurs scénarios dont la majorité mènent à un effondrement plus ou moins brutal de l’écosystème entrainant avec lui l’effondrement des sociétés industrielles et leurs modèles économiques avec.
C’est à la même période que naissent certains partis écologistes à l’image des Vert·es suisses qui parviennent à faire élire en 1977 le premier parlementaire national écologiste au monde. La gauche européenne s’empare elle aussi de la question environnementale et pose à ce moment-là les bases de l’écosocialisme. C’est dès cette époque qu’on perçoit les trois pôles qui façonnent l’écologie politique d’aujourd’hui: la société civile, les milieux scientifiques et la politique institutionnelle.
La fin des années 2010, émergence d’un nouveau front écologique
À la fin des années 2010 l’on assiste à un nouveau momentum dans l’écologie politique occidentale. L’accord de Paris sur le climat de 2015 commande à un groupe onusien d’expert·es sur le climat un rapport spécial. Publié en 2018, il tire des conclusions alarmantes sur l’origine anthropique du dérèglement, ses enjeux et ses impacts.
Contrairement à de nombreux rapports vite passés aux oubliettes, celui-ci met un véritable coup d’accélérateur à deux mouvements émergents dans le monde occidental: Fridays for Future (les grèves scolaires pour le climat) et Extinction Rebellion, véritable bouffée d’air frais dans le large paysage des luttes environnementales.
Prenant le contre-pied du recentrage bourgeois et de la transformation technocratique en cours depuis les années 90, ces mouvements ont été structurants d’une nouvelle vague écologiste en Europe: plus jeune, plus féminine, plus intersectionnelle. Ils ont également contribué à ouvrir une fenêtre politique ayant poussé à la mise à l’agenda des enjeux environnementaux par les acteurs·rices du capitalisme globalisé.
Le renouvellement de l’écologie radicale par la question des communs
Les différentes phases de confinement liées à la pandémie du début des années 2020 et le backlash des milieux économiques et bourgeois laissent des traces auxquelles s’ajoute une certaine perte d’intérêt des masses populaires pour les manifestations de grande ampleur qui avaient marqué l’année 2019. Les mouvements écologiques nouvellement apparus ont pour certains décidés de laisser de côté l’aspect très (parfois trop) théorique des luttes pour le climat. Ainsi, ils renouent et remettent au goût du jour une stratégie historique des luttes environnementales en se focalisant à plus petite échelle contre de larges projets perçus comme inutiles et imposés.
Influencés par les milieux autonomes, libertaires et paysans, ce renouveau de l’écologie radicale prône la défense des communs face à l’accaparement des terres par de grands groupes industriels, le retour à une écologie de terrain et proche des populations (à l’image des Soulèvements de la Terre et des Grondements Des Terres). En certains points, la stratégie de ce renouveau de l’écologie radicale évoque la mouvance altermondialiste des années 1990–2000 et laisse pleine l’interrogation de la suffisance des actions locales pour résoudre ce problème global.
Kelmy Martinez