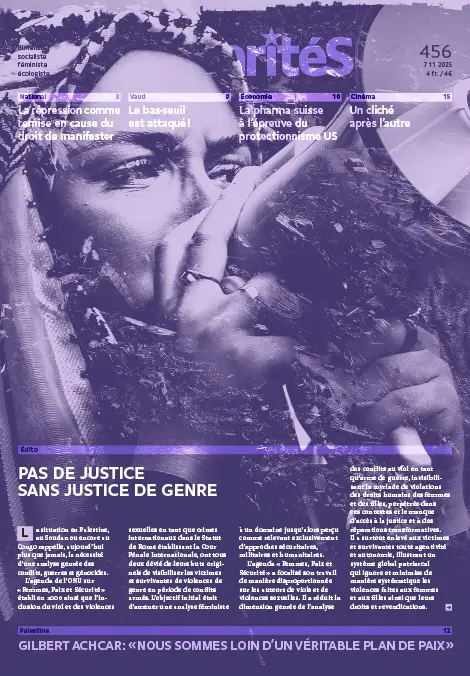Palestine
Israël
«Nous sommes loin d’un véritable plan de paix»
Entretien avec Gilbert Achcar à l’occasion de la sortie de son dernier livre et de sa tournée en Suisse romande que nous avons co-organisée.

Bien loin des illusions qu’il promeut, en quoi le « plan de paix » pour Gaza en vingt points du président Trump constitue-t-il une nouvelle étape pour liquider la question palestinienne et les droits du peuple palestinien ? Quel devrait être selon toi, les bases fondamentales d’un véritable « plan de paix » pour assurer les droits du peuple palestinien ?
La première caractéristique de ce « plan de paix » est qu’il est le plus bâclé de l’histoire du conflit israélo-arabe, comme je l’ai décrit tout récemment dans Le Monde diplomatique (novembre 2025). C’est pourquoi il y a un grand scepticisme quant à sa réalisation, d’autant plus qu’il fait l’objet d’interprétations divergentes de la part des principaux protagonistes.
Ce qui est très clair, c’est que ce « plan Trump » fait fi du droit à l’autodétermination du peuple palestinien. Il envisage un maintien à long terme de l’occupation israélienne à Gaza – dans un « périmètre de sécurité » le long de la frontière de l’enclave, à tout le moins – et place le reste du territoire sous la tutelle quasi coloniale d’un conseil d’administration dit « Conseil de paix », présidé par Donald Trump lui-même.
Ce Conseil est censé compter parmi ses membres l’ex-premier ministre britannique Tony Blair, partenaire des États-Unis dans l’invasion de l’Irak en 2003 et dont le CV inclut les tutelles inspirées des mandats coloniaux de la Société des Nations (ancêtre de l’ONU), tant au Kosovo qu’en Irak.
De droit du peuple palestinien à l’autodétermination et d’État palestinien, il n’est question que sous la forme d’une hypothèse d’avenir qui ne sera envisagée que si l’Autorité palestinienne (AP) est « réformée » au goût d’Israël et des États-Unis. Quand on sait que l’AP actuelle est déjà honnie par la très grande majorité des Palestinien·nes parce qu’elle est perçue comme soumise à l’occupant, on peut imaginer à quoi ressemblerait une AP « réformée » dans ce sens.
Pour qu’un règlement pacifique des rapports israélo-palestiniens puisse voir le jour de manière convaincante et durable, il devrait prendre comme principe de base les droits du peuple palestinien : l’autodétermination, le retour et la compensation des réfugié·es, et l’égalité des droits. En somme, il faudrait mettre fin au sionisme en tant qu’entreprise coloniale fondée, comme toute entreprise de cette nature, sur un mépris raciste des indigènes et axée autour d’un État défini sur une base ethnico-religieuse en tant qu’État « juif ». Alors seulement sera-t-il possible pour la population judéo-israélienne de coexister pacifiquement et égalitairement avec la population palestinienne.
Dans cette perspective, il faudrait la libération de tou·tes les prisonnier·es palestinien·nes détenu·es par Israël ; le retrait total et inconditionnel de l’armée israélienne de tous les territoires occupés depuis 1967, c’est-à-dire la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et Gaza (ainsi, bien sûr, que les autres territoires arabes occupés, en Syrie et au Liban) ; l’évacuation des colons sionistes ; le démantèlement du mur de séparation ; ainsi qu’une véritable égalité en droits pour les palestinien·nes qui détiennent la citoyenneté israélienne – aujourd’hui citoyen·nes de deuxième classe dans l’État d’Israël.
Plus immédiatement, à Gaza, outre le retrait de l’occupant, il faudrait imposer à Israël et à son parrain étasunien des réparations massives, permettant de reconstruire et réhabiliter le territoire ravagé par la guerre génocidaire et très destructrice qu’y a menée l’armée israélienne.
Au lieu de cela, Donald Trump, ses fils et leur business familial, son gendre Jared Kushner, son ami Steve Witkoff et son propre fils, tous promoteurs immobiliers, envisagent de faire passer les monarchies pétrolières arabes à la caisse pour financer une reconstruction dont ils tireraient de gros bénéfices. C’est dire à quel point nous sommes loin d’un véritable « plan de paix ».
Tu parles dans ton livre d’un « génocide annoncé » en discutant de la tragédie que vivent les Palestinien·nes depuis le 7 octobre 2023, en insistant notamment sur la nature de colonie de peuplement du projet politique sioniste. Peux-tu nous en résumer les grandes lignes ?
La guerre génocidaire à Gaza s’inscrit en droite ligne dans une histoire qui commence avec la fondation du mouvement sioniste à Bâle à la fin du 19e siècle autour d’un projet conçu comme entreprise auxiliaire de l’expansion coloniale européenne, alors à son apogée. Plusieurs des colonialismes de peuplement qu’a connu l’histoire ont été fauteurs de génocide : il n’est qu’à penser à l’Amérique du Nord et à l’Australasie pour prendre deux exemples bien connus.
Le racisme inhérent à l’entreprise coloniale est ainsi toujours potentiellement génocidaire. Pour que ce potentiel se réalise, surtout à notre époque, il lui faut des conditions politiques particulières. Celles-ci se rapportent à un autre potentiel inhérent à l’entreprise coloniale, qui est sa tendance à dériver vers l’extrême droite.
Comme l’avaient prévu de nombreux intellectuel·les critiques du sionisme, cette tendance n’a pas tardé à se réaliser dans l’État d’Israël. Après une première période dans laquelle cet État était gouverné par l’aile social-démocrate du mouvement sioniste, l’aile néofasciste, le Likoud, est arrivée au pouvoir en 1977 et s’y est maintenu quasiment en continu depuis lors.
Le gouvernement actuel de Benyamin Netanyahou est une coalition entre le Likoud et des groupes encore plus droitiers, qu’un spécialiste israélien de la Shoah n’a pas hésité à qualifier de néo-nazis dans le quotidien Haaretz.
Dans ton livre, tu parles des perspectives de stratégie de libération pour le peuple palestinien, en insistant notamment sur deux points fondamentaux basés sur la lutte de masses et le cadre régional, peux-tu développer ?
Comme toute stratégie, celle visant la libération doit se fonder sur une considération du terrain et des rapports de force. Elle doit se fonder sur la spécificité des conditions. Or, la résistance palestinienne née en 1964 s’est longtemps inspirée de la lutte de libération algérienne, sans prêter attention aux grandes différences entre l’Algérie où les colons européens étaient minoritaires et la Palestine où la population judéo-israélienne est très majoritaire au sein des frontières officielles de l’État d’Israël et dans un rapport près de l’équivalence avec les Palestinien·nes sur l’ensemble du territoire compris entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée.
Quant à la disproportion des forces militaires, elle est extrême. C’est pourquoi une stratégie qui vise à vaincre le sionisme militairement est vouée à l’échec et ne peut aboutir qu’à l’aggravation du malheur palestinien – aujourd’hui à son comble avec le génocide qui a suivi l’opération du 7 octobre 2023, avec de surcroît la menace accrue d’une nouvelle épuration ethnique complétant la Nakba de 1948.
Au vu des conditions spécifiques de la lutte palestinienne, elle ne peut triompher qu’en parvenant à gagner à sa cause une majeure partie de la population judéo-israélienne, comme les Noir·es étasunien·nes ne sont parvenu·es à remporter des victoires qu’au moyen d’un mouvement de masse non-violent pour les droits civiques. C’est pourquoi je souligne que pour qu’une stratégie fasse sens pour la lutte palestinienne, elle doit viser à détacher du sionisme une partie croissante de la population judéo-israélienne. La stratégie du Hamas produit l’effet contraire.
Finalement, quelles sont les taches de la gauche au niveau international dans le soutien à la cause palestinienne ?
C’est là l’autre levier potentiel dont dispose la lutte palestinienne et qu’il lui faut développer. Il lui faut s’appuyer sur la solidarité internationale. Or, l’horreur de la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza a fini par susciter un grand mouvement de solidarité avec les Palestinien·nes dans les pays occidentaux eux-mêmes, soutiens traditionnels de l’État sioniste. Cela est d’autant plus important que cette solidarité se manifeste également dans le principal soutien d’Israël que sont les États-Unis – et surtout de la part des Juif·ves américain·nes, de la jeunesse judéo-américaine en particulier.
Mais pour cultiver cette solidarité, il faut également une stratégie qui sache s’appuyer sur les valeurs démocratiques et humanistes qui font la supériorité morale des opprimé·es sur leurs oppresseurs. La gauche internationale doit contribuer au renforcement d’une telle stratégie, en augmentant son engagement dans le mouvement pour le boycott, le désinvestissement et les sanctions (BDS) plus que jamais à l’ordre du jour face à un État génocidaire.
Il faut continuer d’exiger des États la rupture des relations diplomatiques et commerciales, et des relations militaires à plus forte raison, avec l’État d’Israël. Accentuer cette pression est un élément essentiel d’un véritable plan de paix.
Propos recueillis par Joseph Daher












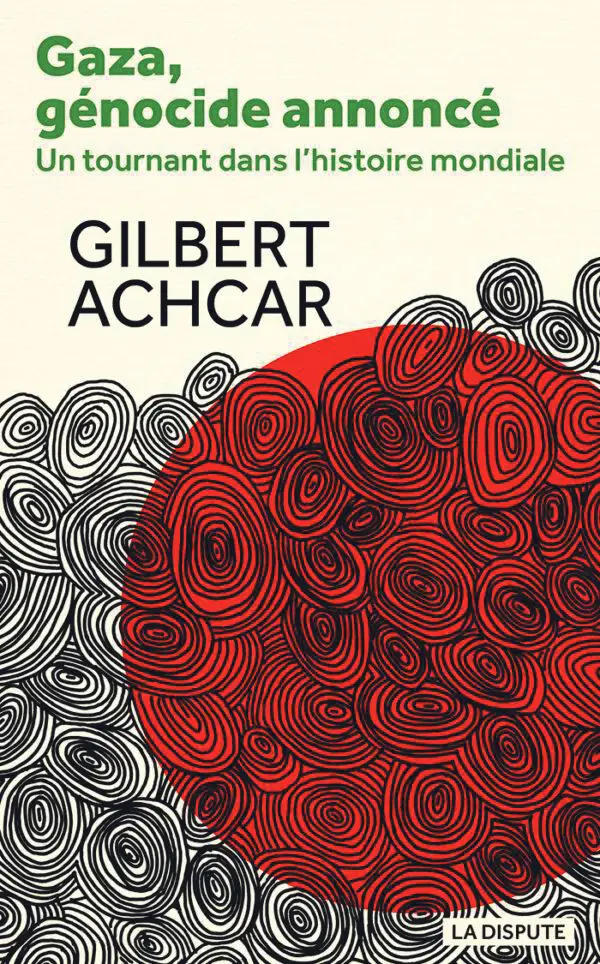 Gilbert Achcar, Gaza, génocide annoncé. Un tournant dans l’histoire mondiale, Paris, La Dispute, 2025
Gilbert Achcar, Gaza, génocide annoncé. Un tournant dans l’histoire mondiale, Paris, La Dispute, 2025