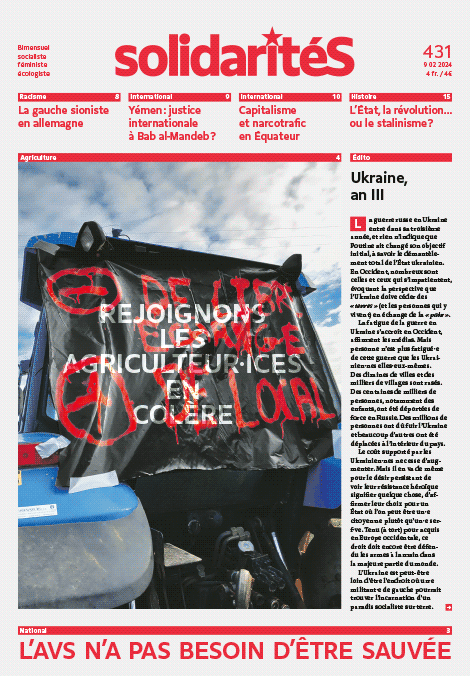De grève en grève
Fin janvier 2024, l’émission de France culture «La série documentaire» (LSD) a consacré quatre épisodes au féminisme espagnol. Elle interroge les éléments qui en font une avant-garde dans la lutte contre la domination et les violences à l’encontre des femmes et des minorités de genre.

Le podcast plonge les auditeuricexs dans l’histoire des féminismes espagnols, à travers la voix de militantes, chercheuses et juristes investies sur cette thématique.
Le premier volet s’ouvre sur un épisode qui, l’été dernier, a marqué les mémoires sportives et médiatiques nationales, et même internationales. Quelques semaines après avoir embrassé de force la joueuse de foot Jenni Hermoso sur la pelouse du Stadium Australia à Sydney, à la suite de la victoire de l’Espagne sur l’Angleterre en finale de la Coupe du monde féminine, Luis Rubiales, le patron du foot espagnol, annonce sa démission. Celle-ci intervient à la suite de mobilisations féministes d’ampleur dans tout le pays pour dénoncer cette agression sexuelle, qui ont rencontré un écho médiatique important. Il est par la suite démis par la FIFA de toutes ses fonctions au sein du foot national et international. Mais comment expliquer cette victoire contre la banalisation des violences sexistes et sexuelles et la culture du viol ?
Histoire d’un féminisme autonome
Des années 1970 à nos jours, les féministes espagnoles ont su construire des luttes autonomes et radicales que retrace le podcast et qui ont trouvé un nouveau souffle dans les grèves féministes qui, depuis celle du 8 mars 2018, secouent régulièrement le pays. Loin d’être le fruit d’un hasard historique, ce renouveau s’inscrit dans la continuité des mobilisations du mouvement 15-M, aussi connu sous le nom de mouvement des Indigné·es (indignados), né sur la Puerta del Sol à Madrid en mai 2011, et dans le cadre duquel des militantes se sont battues pour défendre une lecture féministe de la crise et de ses conséquences, et pour dénoncer les agressions sexistes qui avaient lieu sur le campement même.
Il puise aussi ses racines dans l’onde de choc qui a traversé le pays en 2016 après le viol collectif d’une jeune fille de 18 ans par un groupe d’hommes se surnommant « la manada » (la meute en castillan) – en marge des festivités de la Saint Firmin à Pampelune – et aux manifestations féministes qui s’en sont suivies. Des manifestations qui ont marqué le début d’une importante campagne pour une redéfinition des dispositions pénales sur le viol, qui a abouti en août 2022 à la loi Solo si es si, seul un oui est un oui. Si cette dernière présente des limites et fait l’objet de différentes critiques, elle est considérée comme une exception positive dans le paysage européen pour les militantes, sociologues et juristes interrogées dans le podcast.
Finalement, au-delà de l’histoire nationale, la grève de 2018 trouve son inspiration dans celle menée en 2016 par les féministes argentines, citée à plusieurs reprises comme un exemple par les militantes.
De l’Argentine à l’Espagne…et à la Suisse ?
Par effet rebond, en 2018 – 2019, la grève de l’État espagnol a, à son tour, joué un rôle important dans la construction de la mobilisation en Suisse. À solidaritéS, en juin 2018 déjà, nous avions invité une camarade féministe espagnole pour venir présenter ses modes d’organisation et ses revendications. Par la suite, le Manifeste en 19 points des collectifs s’est en partie organisé autour des axes dégagés par nos camarades espagnoles. Cinq ans plus tard, cette série documentaire permet d’identifier, une nouvelle fois, les ponts qui unissent ces mobilisations.
D’abord, elle nous rappelle que les féminismes ne viennent jamais de nulle part mais s’ancrent dans une histoire souvent oubliée et minorisée. Dans l’État espagnol, des femmes qui s’étaient organisées au sortir du franquisme ont rencontré dans la grève celles du mouvement 15-M, ainsi qu’une nouvelle génération. En Suisse, les plus jeunes d’entre nous ont découvert, ou redécouvert, l’existence de la grève de 1991 grâce au récit des plus âgées. La transmission de la mémoire et des savoir-faire est ainsi un outil essentiel à la construction des luttes.
En Espagne, comme en Argentine, la grève s’inscrit dans la continuité de mobilisations contre les violences sexistes et sexuelles ou pour dénoncer les conséquences genrées des crises néolibérales. En Suisse aussi, nous avons cherché avec cet outil à construire une praxis féministe globale et transversale. D’ailleurs, les références citées tout au long du podcast, dont l’ouvrage de Veronica Gago La puissance féministe, circulent également dans nos rangs.
Une série d’éléments qui indiquent qu’au-delà de l’existence d’une «avant-garde» espagnole, c’est bien une Internationale féministe qui se construit aujourd’hui autour de l’outil de la grève. Une Internationale qui a le potentiel de mener, dans de nombreux pays, des luttes d’ampleur historique.
Noémie Rentsch