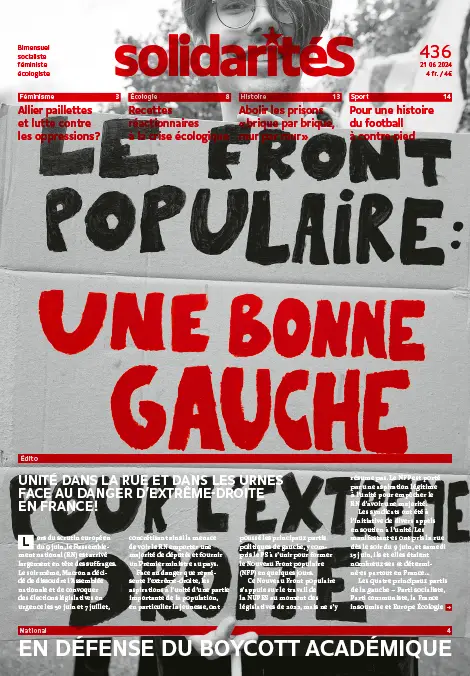Afrique du Sud
Une vie glorieuse pour… les cleptocrates
La défaite électorale du Congrès national africain (ANC) marque la fin d’une période, celle de l’espoir d’un changement économique et social en République sud-africaine après la fin de l’apartheid et l’arrivée au gouvernement de l’ANC en 1994.

Les successeur·es de Nelson Mandela ont épuisé le capital de confiance de la majorité du peuple sud-africain. La persistance voire l’accroissement des inégalités sociales durant leur gouvernance ont réduit progressivement leur majorité électorale.
Les élections du 29 mai viennent de mettre fin à sa toute-puissance institutionnelle et sanctionnent son impuissance à traduire dans les faits ses promesses de justice sociale.
Abstention et perte de majorité
La majorité des électeurs·trices ont manifesté leur dégoût de ce gouvernement, du chômage massif, de la déliquescence des infrastructures de base (eau potable, électricité, transports) par l’abstention, qui a grimpé à 42%, contre 34% en 2019.
Le recul du score de l’ANC est l’autre aspect majeur de cette sanction, 40,2% des suffrages, alors qu’en 2019 le parti l’emportait encore avec 57,5% des voix. Rappelons aussi que l’ANC récoltait 70% des votes en 2004.
Autre inquiétude, l’ancien dirigeant de l’ANC Jacob Zuma devient avec sa formation Umkhonto we Sizwe (MK), reprenant le nom de l’ancienne branche armée de l’ANC dissoute en 1991, la troisième force avec 14,5 %, score acquis en opposition frontale à l’ANC, et avec une orientation démagogique et identitaire. Les meilleurs scores du MK ont été acquis dans la province du Kwazulu-Natal, fief de la communauté Zoulou, le groupe ethnique le plus important du pays. Cette région avait été, durant la période de l’apartheid, le fief du mouvement Inkatha zoulou instrumentalisé par le pouvoir blanc pour combattre l’ANC.
La présidence de Zuma (2009–2018) fut marquée par de nombreux scandales financiers. Accusé de détournements de fonds publics et d’enrichissement personnel, il dut démissionner en 2018. Cette période a été marquée par le pillage généralisé des ressources de l’État, au profit d’un cercle proche de politicien·nes et de capitalistes. Désormais, il fait l’objet de multiples poursuites judiciaires.
Rejetant toutes ces accusations, il se présente en victime, un peu à l’image de Trump. Comme lui, il a immédiatement contesté les résultats, parlant de fraude massive et annonçant que sa formation avait récolté les deux tiers des voix, sans preuve aucune.
Du syndicalisme au capital
Le passé du président sortant Cyril Ramaphosa illustre bien les errements politiques des dirigeants de l’ANC. Ancien leader syndical sous l’apartheid, il était secrétaire de la fédération des mineurs sud-africains. Ce syndicat avait par sa force et ses mouvements de grève contribué grandement à la chute du régime raciste. Écarté de la course à la succession de Mandela, Ramaphosa s’était reconverti dans le secteur privé, devenant dirigeant du groupe minier Lonmin et devenant une des plus grandes fortunes du pays. Il réprima de manière sanglante une grève des mineurs dans un des sites de son groupe à Marikana en août 2012, démontrant parfaitement le cynisme de ces nouveaux·elles capitalistes noir·es défendant les intérêts des actionnaires.
Pendant cette période, la majorité de la population attendait des améliorations dans ses conditions de vie et de travail. Dans beaucoup de townships, l’accès à l’eau potable est encore un luxe. Le chômage reste massif, poussant une fraction déshéritée vers la délinquance et les trafics de toutes sortes.
Héritage du passé?
Ces échecs ne sont pas seulement le résultat de l’héritage du mal-développement de la période de l’apartheid. Le respect du cadre capitaliste en République sud-africaine ne pouvait pas permettre la mise en place de politiques de justice sociale. Ce nouveau cadre a bénéficié seulement à une minorité, en créant une bourgeoisie et une petite bourgeoisie noire, qui ont grandi dans le cynisme et l’enrichissement sans borne ni scrupules.
La contestation au sein de l’ANC de ces gouvernances libérales étaient étouffées et combattues, la priorité étant le carriérisme de la majorité de ses dirigeant·es. Une partie de cette opposition a créé un nouveau parti «Les combattants pour la liberté économique» sans pouvoir constituer encore une alternative.
Les pillages de la période Zuma ont aussi eu des conséquences globales, la croissance du PIB stagnant à 0,8% par en moyenne depuis 2012.
Dans un pays où le taux de chômage s’élève officiellement à 33%, plus de 18 millions de personnes bénéficient d’aides sociales mises en place par l’ANC, ce qui a limité la contestation populaire. Pour ces 30% de la population, c’est une économie de survie, avec peu d’espoir d’améliorations, malgré les multiples déclarations d’un redressement et d’un avenir meilleur.
Dernières promesses de Ramaphosa deux jours avant les élections, une loi assurant les soins gratuits dans n’importe quel établissement public ou privé et le versement d’un revenu de base universel. Tout comme les promesses de Zuma, ces déclarations apparaissaient démagogiques. D’ailleurs, pourquoi n’ont-t-elles pas été mises en œuvre sous les présidences antérieures ?
La promesse de Mandela d’une «vie glorieuse pour tout le monde» est encore lointaine. La sanction par les urnes sera-t-elle suivie par une sanction dans la rue?
José Sanchez