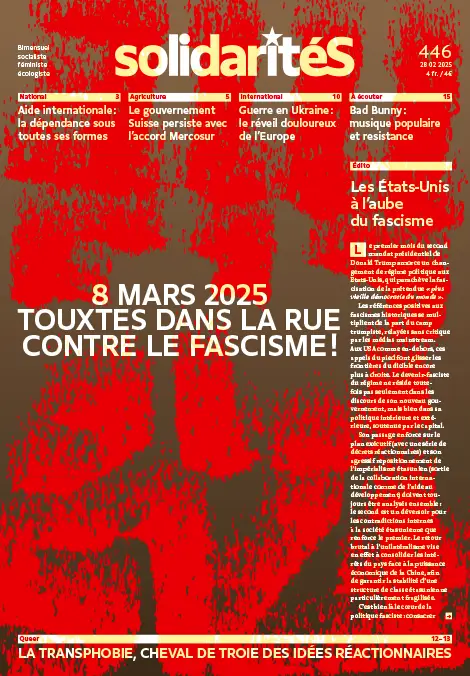Sourd aux critiques, Le gouvernement Suisse persiste avec l’accord Mercosur
Alors que les premières négociations de l’accord de libre-échange entre le Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay) et l’AELE (Suisse, Norvège, Islande, Liechtenstein) ont abouti en 2019, la Suisse souhaite accélérer le processus pour que l’accord final soit signé dans le courant de l’année 2025. Cela en dépit des protestations du monde paysan, qui réclame une agriculture locale, accessible à tous·tes et rémunératrice. Si l’accord est conclu, il entrera en vigueur après ratification par tous les États membres.

La Suisse a un profond intérêt économique dans cet accord. À terme, environ 95% de ses exportations vers les pays du Mercosur seraient exonérées de droits de douane, générant une économies annuelle estimée à 180 millions de francs. Mais cet accord ne se limite pas aux avantages tarifaires: il ouvre également un marché considérable à l’industrie suisse. En 2023, la Suisse a exporté pour plus de 3,6 milliards de francs de marchandises vers le Mercosur, qui compte près de 280 millions d’habitant·es, tandis que ses importations se sont élevées à 648 millions de francs. Mais à quel prix?
Une menace pour le monde agricole
L’ouverture des marchés fait la joie des milieux économiques, mais le cauchemar du monde agricole. Il prévoit notamment des concessions sur la viande, le vin rouge et certains fourrages en échange d’un accès préférentiel pour les exportations suisses de fromages, de boissons et de produits agroalimentaires. L’arrivée de produits agricoles à bas prix, rendus plus compétitifs par des normes de production moins contraignantes, créerait une concurrence déloyale qui pèserait lourd sur le dos des agriculteur·ices, déjà confronté·es à des conditions économiques et sociales très difficiles.
Un danger pour l’environnement et le climat
Cette course à la compétitivité dans un marché toujours plus concurrentiel et libéralisé, risque également d’encourager un affaiblissement des normes environnementales et sanitaires, notamment par la poursuite de l’utilisation de pesticides dangereux pour l’environnement et l’humain. Par ailleurs, les associations environnementales alertent sur les conséquences de l’accord: la hausse des exportations de fourrage et de viande, favorisée par l’octroi de tarifs préférentiels, aggraverait la déforestation dans les pays du Mercosur, en particulier en Amazonie. Alliance Sud, membre de la Coalition suisse sur le Mercosur a estimé que l’accord conduirait à une augmentation de 15% des émissions de gaz à effet de serre liées au commerce agricole.
Une opposition paysanne internationale
Les organisations paysannes européennes, notamment françaises, ont manifestés leur colère, dénonçant, à l’instar de la Confédération paysanne, ce qu’elle considère comme «un coup de poignard» porté aux paysan·nes de France, d’Europe et d’Amérique du Sud. Au-delà de l’Europe, l’accord suscite une forte opposition au sein même des pays du Mercosur.
En mars 2024, la Via Campesina Brésil a exprimé son «rejet total» de cet accord, le qualifiant de «véritable recul pour le Brésil et les pays du Mercosur en termes de développement socio-économique, ainsi qu’une attaque frontale contre la souveraineté de nos pays». L’organisation souligne également que cet accord présente des caractéristiques néocoloniales et menace les populations locales, l’agriculture paysanne et les ressources communes, au profit du capital international. Elle refuse ainsi de cantonner ces pays au rôle d’exportateurs de matières premières en échange de produits industrialisés.
L’urgence de s’opposer aux accords de libre-échange
La saga du Mercosur est loin d’être terminée, et il faudra rester vigilant·e quant à son évolution cette année. Par ailleurs, les États de l’AELE ne se limitent pas à cette négociation: ils poursuivent également des discussions en vue d’accords de libre-échange tout aussi problématiques avec l’Inde, la Malaisie et le Vietnam, tout en cherchant à moderniser leurs traités existants avec le Chili et l’Union douanière d’Afrique australe (SACU).
Il est au contraire nécessaire que les marchés agricoles soient régulés afin de sécuriser des prix rémunérateurs aux producteur·ices. Pour défendre la souveraineté alimentaire et une agriculture paysanne au service de la population plutôt que des industries, il est essentiel de s’opposer fermement à ces accords qui menacent la société dans son ensemble et le monde paysan, en particulier celles et ceux engagé·es dans des méthodes d’agriculture écologique.
Ella-Mona Chevalley