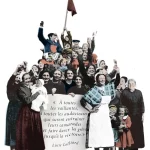Quelle justice pour les étranger·es?
Deux tables rondes ont été organisées à Genève et Lausanne dans le cadre du «Mois de mars antiraciste» lancé par le collectif Justice 4 Nzoy. Retour sur des soirées aussi passionnantes que révoltantes.

ÀLausanne, le 14 mars, les enjeux liés à la détention (pénale et administrative) des personnes étrangères en Suisse ont été abordés devant une centaine de participant·es, réuni·es à l’initiative de l’Observatoire romand du droit d’asile et des étranger·ères. Cet échange a résonné particulièrement dans le contexte vaudois, qui connait un surpeuplement carcéral depuis de nombreuses années (169% d’occupation à la prison du Bois-Mermet et 138% à celle de la Croisée en 2023). Sans surprise, les nouvelles places de détention (250 cette dernière décennie) n’y ont rien changé.
Quand le statut fait la peine
Chercheur à l’Université de Neuchâtel, Luca Gnaedinger a donné les raisons de la surreprésentation de la population étrangère dans les prisons, particularité qui existe seulement depuis quelques décennies, période qui voit la criminalité en général en Suisse diminuer. D’après Gnaedinger, cette situation s’explique par des pratiques policières et judiciaires discriminatoires: profilage racial, plus grande sévérité des juges, pas de possibilité de peines alternatives à la prison, etc. Elle provient également d’un accroissement de la criminalisation de la migration: le fait de passer une frontière est devenu un délit en soi. La prison s’est ainsi muée en outil de gestion de la migration.
La détention administrative comme outil de criminalisation
Maïna Aerni, doctorante en droit, et Jonathan Miaz, professeur à l’Université de Lausanne, ont ensuite abordé la notion de détention administrative: une mesure spécifique pour les personnes étrangères en vue de l’exécution de leur renvoi. Un enfermement qui n’est donc pas lié à une infraction. Miaz a souligné les divergences de pratiques cantonales, qui attestent de la marge de manœuvre des pouvoirs politiques et judiciaires dans la façon d’appliquer les lois.
Aerni a également présenté la situation des enfants, qui, dès l’âge de 15 ans, peuvent être détenu·es jusqu’à un an. Une pratique qui déchoie les enfants de leur statut, qui mériterait une protection particulière, pour les faire passer dans la catégorie de criminel·les. C’est l’une des conséquences la plus choquante de la politique raciste de la Suisse, qui vise à déshumaniser une partie de la population par des pratiques discriminatoires.
Sous un angle plus positif, Miaz a rappelé que les mobilisations peuvent changer les choses. La convention de non-arrestation avant et après un passage au Service de la population, gagnée par le Mouvement de soutien aux «523» sur le Canton de Vaud (2004), en est un bon exemple. Inversement, à Genève ou Fribourg, les personnes migrantes peuvent encore se faire arrêter lors de leur passage auprès des Services de la population, alors qu’elles viennent effectuer des démarches administratives obligatoires…
Quelle justice pour les personnes migrantes?
Le pouvoir des actions collectives a également été soulevé lors des échanges tenus à Genève, le 18 mars, à l’occasion d’une seconde table-ronde co-organisée par Solidarité Tattes et le collectif genevois de la Grève féministe. La discussion portait sur les impossibilités d’obtenir justice pour les personnes sans statut légal ou avec des statuts précaires.
Devant une cinquantaine de personnes, l’avocate Laïla Batou ainsi que deux représentantes des associations ont présenté des exemples où la justice est lente et… tellement injuste: dans le procès sur les violences survenues à Giffers (Centre fédéral d’asile dans le canton de Fribourg) en 2020, où les autorités essaient de classer l’affaire, dans le procès de l’incendie des Tattes où le verdict est tombé 10 ans après les faits, pour une femme sans papier qui n’a pas la possibilité de porter plainte contre un conjoint violent… mais se voit menacée d’expulsion…
Toutes les intervenantes ont souligné à quel point les personnes avec des statuts précaires sont seules, et particulièrement quand la police leur donne du fil à retordre. Une solitude tellement implacable qu’elle a conduit à plusieurs reprises de jeunes personnes à mettre fin à leur vie. L’avocate a également dénoncé le fait de devoir souvent assumer la position de la défense, alors qu’elle avait été appelée pour soutenir une victime.
Quelques pistes ont été esquissées, qui pourraient être portées collectivement: mettre sur pied un réseau d’entraide grâce à une coordination entre les associations; donner la possibilité de déposer plainte sans passer par la case police ou encore réviser le questionnaire que la police utilise dès qu’un·e prévenu·e est d’origine étrangère. Celui-ci part du principe qu’une personne étrangère est «renvoyable», peu importe son statut. Même des personnes bi-nationales se sont vues poser cette question!
Aude Martenot