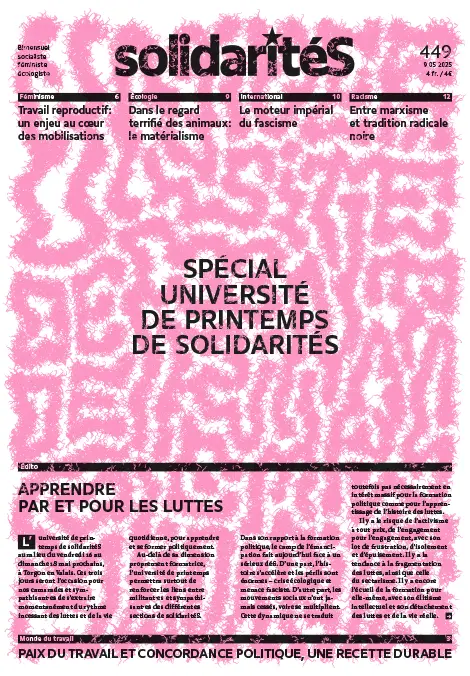Chine
États-Unis
Le capitalisme contre la mondialisation
Le développement économique et politique de la Chine initiée par les successeurs de Mao Tsé-toung n’a cessé de surprendre. Le nouvel horizon fixé par la direction de Xi Jinping de devenir la première puissance mondiale économique, technologique et militaire va-t-elle se réaliser? Quelles sont les contradictions que le régime chinois va affronter dans cette perspective? Entretien avec l’économiste Benjamin Bürbaumer, invité à notre université de printemps.

Quelles conséquences pourrait avoir le retour au pouvoir de Donald Trump sur les relations entre les États-Unis et la Chine?
Beaucoup d’analystes de la politique mondiale mettent en avant des raisonnements individualisants de type «Trump est plus nationaliste et agressif que son prédécesseur, et c’est pour cela que la situation mondiale se dégrade». Pourtant, Trump n’est pas simplement un fâcheux accident de l’histoire, un homme d’un autre temps tombé du ciel. En réalité, plus qu’une cause, il est avant tout un symptôme – le symptôme d’une rivalité inter-impérialiste croissante entre les États-Unis et la Chine.
Fondamentalement, Trump fait ce que les locataires de la Maison blanche font depuis 10 ans: chacun radicalise un peu plus l’hostilité envers une Chine, qui tente effectivement de remplacer la supervision étasunienne de la mondialisation par un marché mondial sous contrôle chinois. Voilà ce qu’indique une analyse de la situation du point de vue de l’économie politique internationale.
Si Trump n’est donc pas aussi exceptionnel qu’on pourrait le croire, il ne conserve pas moins des particularités. Son recours massif aux droits de douane le distingue d’une politique commerciale plus ciblée sous Joe Biden, tout comme ses tentatives d’extorsion envers les alliés des États-Unis le différencient des autres présidents étasuniens qui voyaient dans l’alliance un multiplicateur de puissance. Ainsi, Trump montre au monde entier à quel point la participation à la mondialisation dépend du bon vouloir des États-Unis. Le mythe du marché autorégulateur n’a plus la moindre crédibilité. Au contraire, le marché mondial est de plus en plus reconnu comme une source de vulnérabilité politique.
En conséquence, la Chine va chercher à accélérer ses tentatives de contourner les infrastructures physiques, numérique, monétaire, technique et militaire sous contrôle étasunien, sur lesquels reposent la mondialisation. Car c’est ce contrôle qui permet, à l’heure actuelle, aux États-Unis d’enregistrer des profits extraordinaires et d’exercer un pouvoir politique extraterritorial. En d’autres termes, Trump incite la Chine à renforcer la mise en cause de la supériorité politique et économique étasunienne, ce qui produira des réactions encore plus hostiles à Washington. Trump est donc l’amplificateur d’une conflictualité, dont les racines profondes dépassent chaque dirigeant politique individuel car elles se trouvent dans le fonctionnement même du capitalisme.
Comment définiriez-vous aujourd’hui la Chine sur les plans politique, économique et militaire?
La Chine est un pays capitaliste en situation de suraccumulation flagrante. Depuis son retour plein et entier au monde capitaliste à partir des années 1980, le parti-État a mené des politiques hautement favorables aux entreprises. La planification a fortement reculé au profit de logiques marchandes: libéralisation des prix, privatisations, autorisation des licenciements, démantèlement du service public, … En somme, l’économie a été radicalement réorganisée autour du principe du profit, y compris dans les entreprises qui restent formellement sous contrôle étatique.
Au passage, une série de mesures ont été prises afin d’attirer des capitaux étrangers, et ce avec l’objectif d’adapter l’économie chinoise à la concurrence: suppression du monopole public du commerce extérieur, mise en place de zones franches avec un droit du travail et une fiscalité dérogatoire, rapatriement des profits, ouverture des marchés financiers aux étrangers. La Chine, avec ses millions de travailleur·ses bon marché, et comparativement en bonne santé et bien formé·es, est donc une source de profit particulièrement attractive pour le capital des pays les plus riches, les pays européens et les États-Unis en tête.
Dans l’optique de favoriser le développement capitaliste, les autorités chinoises ont maintenu le niveau de rémunération des travailleur·ses à un niveau faible. L’une des conséquences macroéconomiques de cette configuration est une forte suraccumulation depuis plusieurs décennies, et qui s’est particulièrement accentuée depuis la crise de 2008–09. En conséquence, la Chine est contrainte d’exporter des marchandises et des capitaux. La Chine contemporaine est une illustration frappante du caractère inégal et combiné du développement capitaliste.
Régulièrement, on entend des commentateurs recourir à un argument d’inspiration keynésienne selon lequel il suffirait de basculer le régime d’accumulation chinois vers la consommation intérieure pour mettre fin aux déséquilibres économiques et aux problèmes sociaux qui en découlent. Or, cet argument ignore les ramifications politiques de l’accumulation du capital. La hausse de la rémunération des travailleurs indispensable à un tel basculement est susceptible d’exercer une pression sur une rentabilité du capital. On pourrait objecter qu’une telle hausse pourrait stimuler les profits par le biais d’une consommation accrue. Mais encore aurait-il fallu que les dirigeant·es d’entreprise en soient convaincu·es.
Or, face à cette éventualité, ils et elles ont la certitude que leurs coûts de production augmenteraient, tout en nageant en pleine incertitude quant à la répartition des profits potentiels. Mieux vaut éviter de se faire siphonner ces profits par les concurrents en s’opposant à une réorientation fondamentale de l’économie. Un basculement se heurterait aussi à la fraction du capital chinois (et étranger) qui tire ses bénéfices de sa fonction de fournisseur à bas coût dans les chaînes globales de valeur. Son opposition à l’amélioration du pouvoir de négociation des travailleurs est farouche.
Par ailleurs, la réorientation vers la consommation intérieure n’est pas sans risque pour le Parti communiste chinois (PCC). Afin d’en prendre la mesure, il convient de rappeler que la libéralisation fut synonyme de chômage massif en Chine. Dans son fameux texte sur les aspects politiques du plein-emploi, l’économiste Michał Kalecki indique que la disparition du chômage implique la disparition de son effet disciplinaire: «la position sociale du patron serait ébranlée et l’aplomb et la conscience de classe de la classe ouvrière augmenteraient. Les grèves pour les augmentations de salaires et l’amélioration des conditions de travail créeraient des tensions politiques. » Or le seul tabou absolu de quarante ans de réformes en Chine était celui du pouvoir du PCC. Hors de question d’alimenter des troubles politiques.
Par conséquent, plutôt que de renforcer la consommation populaire domestique, les autorités chinoises privilégient la conquête du marché mondial – au risque d’entrer de plus en plus frontalement en collision avec l’État dont la grande stratégie visait à promouvoir son capital transnational: les États-Unis.
La Chine bénéficie d’une image relativement positive dans les pays du Sud global, contrairement aux États-Unis et à l’Europe. Peut-on considérer que ce pays est un pays impérialiste?
Selon Rosa Luxemburg, l’impérialisme désigne les tensions entre grandes puissances résultant du processus d’accumulation du capital. La Chine contemporaine cherche précisément à soulager sa suraccumulation domestique par la conquête du marché mondial.
Cette démarche se heurte directement aux États-Unis, qui supervisent le marché mondial depuis des décennies. La Chine voudrait se débarrasser de cette source de vulnérabilité en tentant de remplacer la mondialisation – ce processus sous supervision américaine – par un marché mondial sino-centré. Cela signifie concrètement le remplacement des infrastructures physiques, numériques, monétaires, techniques et militaires américaines, sur lesquels reposent les transactions économiques mondiales à l’heure actuelle.
Tout comme les États-Unis, la Chine vise à masquer la nature impérialiste de sa démarche par le déploiement d’un projet hégémonique. En effet, la supervision de la mondialisation tout comme sa contestation ne peuvent être le fruit de l’action d’un unique pays. Le concept gramscien d’hégémonie permet de comprendre qu’une grande puissance ne l’est durablement qu’à la condition de créer une adhésion volontaire des pays soumis à son autorité. Pour les mêmes raisons, la contestation de l’hēgemon exige un projet de réorganisation suffisamment captivant pour produire un effet d’entraînement sur des pays tiers. La puissance contestataire doit être un pôle d’attraction.
Le projet hégémonique chinois a fait des progrès notables au cours des 15 dernières années. La Chine a fourni énormément de vaccins contre le covid à de nombreux pays périphériques à l’heure où les États-Unis étaient trop préoccupés à protéger les rentes de leurs compagnies pharmaceutiques. Elle pratique une diplomatie de l’éducation très performante alors que les universités étasuniennes exigent des frais d’inscription monumentaux et se ferment de plus en plus aux étudiant·es étranger·es. À travers les Nouvelles routes de la soie, la Chine n’allège pas seulement ses problèmes de suraccumulation, elle finance aussi la construction d’infrastructures physiques dans de nombreux pays pauvres où les routes, les réseaux électriques et les chemins de fer ont été délaissés justement en raison du Consensus de Washington.
La Chine bénéficie également du fait que la politique étrangère de Washington est largement perçue comme hypocrite. Ce reproche est devenu plus saillant face aux réactions contrastées concernant la situation à Gaza et en Ukraine. De multiples pays périphériques ont relevé avec amertume le traitement particulier réservé aux seules victimes ukrainiennes par rapport aux dizaines de milliers de victimes en Palestine. Ils ont également remarqué que les sommes toujours si difficiles à débloquer pour le développement ont été facilement mobilisées pour armer l’Ukraine ou Israël. Dans cette situation, la Chine se positionne comme nouvel intermédiaire pour la gestion des conflits internationaux – tout comme, face à Trump, elle se place en défenseure d’un ordre mondial multilatéral et ouvert. Cette démarche a fortement contribué à améliorer l’image de la Chine en Asie, en Afrique et en Amérique latine.
Bien que ce positionnement, tout comme sa diplomatie sanitaire, éducative et culturelle et ses financements puissent temporairement répondre à de véritables besoins des pays de la périphérie, la Chine ne le fait pas par charité. Elle le fait pour trouver une solution spatiale à sa suraccumulation.
Et même si elle reste loin de l’interventionnisme militaire étasunien, qui, ces 20 dernières années, a causé plus de 4,5 millions de mort·es en Afghanistan, au Pakistan, en Irak, en Syrie et au Yémen, elle augmente fortement ses dépenses militaires et adopte une démarche de plus en plus musclée en Mer de Chine méridionale, notamment contre les alliés les plus proches des États-Unis. Cela la place directement sur les rails de la confrontation avec Washington qui, en particulier depuis le pivot asiatique et grâce à ses innombrables bases militaires dans la région et à ses dépenses militaires exorbitantes, a de facto transformé les océans indien et pacifique en eaux étasuniennes.
La Chine est officiellement un pays communiste dirigé par un Parti communiste. Quel rôle cette idéologie joue-t-elle dans sa politique intérieure et extérieure?
Déjà en 1978, face aux débuts de la politique menée par Deng Xiaoping et ses alliés au sein du Parti communiste chinois, Charles Bettelheim a observé que lorsque le rôle dirigeant de la classe ouvrière disparaît, la doctrine selon laquelle « faire plus de profit c’est créer plus de richesse pour le socialisme » devient une formule creuse. Dans les faits, la compréhension du socialisme par le PCC se superpose largement à l’idée de modernisation capitaliste. Il y a un certain temps, Chen Yuan, dirigeant du PCC et fils d’un des leaders de la première génération du Parti, a résumé la situation ainsi: «Nous sommes le Parti communiste et nous déciderons de ce que le communisme signifie.» Dans cette optique, la marchandisation est pleinement compatible avec le communisme.
Avec la valorisation du marché vient aussi une révision de l’appréciation des différents groupes dans la société. À cet égard, la gymnastique idéologique du PCC apparaît tout à fait remarquable. Sous son secrétaire général Jiang Zemin (entre 1989 et 2002), l’analyse suivante fut proposée: «À l’époque de l’industrie manufacturière traditionnelle, lorsque Marx a écrit ses textes révolutionnaires, les travailleurs étaient en effet à la pointe de la productivité. Toutefois, à l’ère des technologies de l’information, les hommes d’affaires et les professionnels ont supplanté les travailleurs relativement moins éduqués, sans parler des agriculteurs, en tant qu’avant-garde de la société.» Certes, la référence au socialisme est maintenue, mais elle est vidée de sens.
Un affrontement militaire direct entre les États-Unis et la Chine est-il envisageable? Les États-Unis semblent vouloir rapprocher la Russie de leur camp dans une logique d’opposition à la Chine. Que signifierait un tel rapprochement pour la Chine, et comment pourrait-elle y réagir? Quels sont aujourd’hui les principaux alliés de la Chine?
Depuis plus d’une dizaine d’années la Chine est la priorité numéro 1 de la politique étrangère étasunienne. Cette préoccupation s’intensifie de président en président. Aujourd’hui, le monde connaît une course à l’armement sans précédent, qui est principalement tirée par les États-Unis et la Chine. Cette manne permet la multiplication des exercices militaires autour de la Chine, où cette dernière adopte une démarche de plus en plus musclée et où les États-Unis et leurs alliés régionaux, notamment les Philippines et l’Indonésie, procèdent régulièrement à des démonstrations de force. La boucle s’annonce sans fin. Ces exercices se déroulent sur fond de frictions et attaques régulières entre des bateaux chinois d’un côté et vietnamiens ou philippins de l’autre, qui peuvent déboucher un accident de type collision maritime, susceptible de dégénérer en une guerre désastreuse. À cela s’ajoute que les frictions se multiplient aussi au-delà de Taïwan, dans cette vaste zone nommée indopacifique. Toutefois, le risque de guerre ne vient pas seulement de la probabilité grandissante d’un incident non-intentionnel, Washington et Pékin préparent activement la guerre. Pour ne prendre qu’un exemple très récent : En mars Pete Hegseth, Secrétaire à la Défense des États-Unis, a indiqué à ses services de faire de la préparation d’une guerre avec la Chine une priorité opérationnelle.
Les tensions militaires sont donc dans le prolongement direct du processus d’accumulation du capital. Dans ce cadre, il est utile de garder à l’esprit les ordres de grandeur: les États-Unis disposent de plus de 800 bases militaires dans le monde, la Chine ne dépasse pas la trentaine, tout au plus; les dépenses militaires étasuniennes représentent près de trois fois celles de la Chine, et les dépenses militaires de l’OTAN – qui, depuis son sommet de Madrid en 2022, a acté l’élargissement de sa sphère d’intérêt de l’Atlantique nord à l’Asie pacifique – sont quatre fois supérieures à celles de la Chine. Les capacités destructrices étasuniennes et la logistique sous-jacente dépassent donc très largement la Chine. Par contraste, cette dernière ne dispose d’aucune alliance militaire comparable à l’OTAN.
La volte-face envers la Russie est certainement le domaine dans lequel Donald Trump est vraiment différent par rapport aux autres présidents étasuniens. Et il est cohérent: depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022, l’économie russe s’est beaucoup plus fortement tournée vers la Chine et a notamment donné un coup d’accélérateur important à l’internationalisation de la monnaie chinoise renminbi. Voilà une des conséquences inattendues des sanctions financières de Washington contre la Russie, qui affaiblit directement le contrôle étasunien de l’infrastructure monétaire mondiale. Dans la même veine, Trump pousse les pays européens à augmenter leur budget militaire de 50%, voire de 150%. C’est une gigantesque amplification de la militarisation du Vieux Continent, qui ne vise pas tant à contenir la Russie qu’à soutenir l’effort militaire de Washington contre Pékin. Car cette hausse des budgets européens permettra aux États-Unis de réorienter des ressources supplémentaires substantielles vers la Chine. Réarmer l’Europe c’est in fine alimenter l’escalade militaire en Extrême-Orient et perpétuer la supervision étasunienne de l’économie mondiale dont les peuples européens ne tirent aucun bénéfice.
Existe-t-il aujourd’hui une opposition démocratique au sein de la société chinoise ou la répression du mouvement de Tiananmen a-t-elle définitivement étouffé toute contestation démocratique?
Il est difficile d’identifier une opposition organisée, notamment en raison des politiques répressives de Pékin. Néanmoins, depuis sa transformation capitaliste, la Chine est régulièrement secouée par des mobilisations importantes. Malgré un rapport de forces peu favorable aux travailleur·ses, le nombre de conflits du travail a considérablement augmenté. En 1994, 78000 salarié·es étaient en conflit ouvert avancé avec leur employeur, en 2007 ce nombre atteignait 650000. Ces conflits concernent principalement les provinces exportatrices où l’exploitation est particulièrement féroce. De plus, les conflits du travail ne restent pas nécessairement inscrits dans le cadre étroit prévu par la loi. On observe au contraire ce que l’historien Eric Hobsbawm a appelé la «négociation collective par l’émeute». En effet, les chercheurs Eli Friedman et Ching Kwan Lee montrent que «l’accélération de la privatisation, de la restructuration et des licenciements dans le secteur d’État a déclenché des niveaux d’insurrection inconnus dans l’histoire de la République populaire». La panoplie des actions était large: sit-in, blocage, occupation, grève, émeute, jusqu’au suicide des travailleur·ses et au meurtre des employeur·ses. À titre d’exemple, en 2005, les chiffres officiels faisaient état de 87000 «incidents de masse» de ce type. Jusqu’aujourd’hui la contestation est très active mais éparpillée.
Enfin, il convient d’ajouter que la contestation est souvent à la fois démocratique et sociale. Loin de l’image d’un mouvement libéral porté exclusivement par des étudiant·es et intellectuel·les, les mobilisations de Tiananmen étaient déjà largement des contestations sociales et démocratiques, portées par les travailleur·ses, qui répondaient directement au processus violent de transformation capitaliste entrepris par la fraction libérale du PCC.
Est-il possible pour les peuples de sortir de cette logique de blocs opposés?
La période actuelle montre que l’affrontement interimpérialiste entre la Chine et les États-Unis conduit ces derniers à extorquer des concessions toujours plus importantes à leurs alliés et au reste du monde plus généralement. Autrement dit, en plus d’une économie mondiale aux effets redistributifs hautement inégaux, nombreux sont les pays exposés au racket de Trump, tandis que la Pékin entend mettre en place une réorganisation sino-centrée de l’économie mondiale. La racine de ce monde de plus en plus conflictuel se trouve dans l’accumulation du capital. L’apaisement définitif passe donc par le remplacement de l’impératif du profit vers la satisfaction des besoins. Dans l’immédiat, une série de pays pourraient décider d’un découplage sélectif par rapport au marché mondial – rétrécissement planifié des chaînes de valeur, conditionnalités environnementales, politiques redistributives. La mise en cause ouverte de certains principes du libre-échange par Trump peut donc constituer une fenêtre d’ouverture.
Propos recueillis par Juan Tortosa