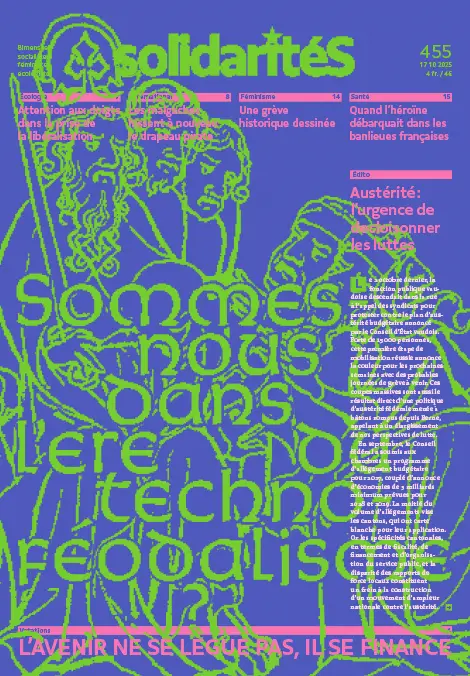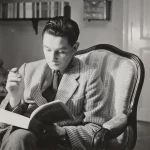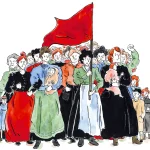France
Héroïne: La génération fauchée des banlieues françaises
40000. C’est le nombre, largement sous-estimé, de décès imputables à l’héroïne en France entre le début des années 1960 et 2004. Nombre de ces victimes étaient issues de l’immigration. Le podcast «Héroïne, le temps des seringues» de France Culture en esquisse l’histoire tragique.

Fin septembre 2025, l’émission «La Série Documentaire», retraçait l’histoire effacée de l’héroïne dans les quartiers populaires périphériques de Paris en quatre épisodes d’une heure. Cette méconnaissance reflète l’abandon plus général des banlieues par les autorités françaises. À l’injustice, cette émission réplique par la mémoire.
Arrivée et diffusion de l’héroïne
L’histoire narrée débute à la fin des années 1960, en pleine effervescence révolutionnaire de Mai 68. À cette époque, la consommation de drogues, surtout psychédéliques, constitue un marqueur d’une jeunesse en rupture avec la société et qui cherche à explorer d’autres possibles.
Jusqu’alors, l’héroïne était consommée par un public spécifique, la frange artistique et intellectuelle ou alors les anciens soldats de retour des colonies.
Marseille est à l’époque le centre principal du trafic de l’héroïne destinée aux USA. Par capillarité, la drogue se diffuse sur le territoire français. À Paris, la vente et la consommation se concentrent dans les quartiers précaires intramuros, se déplaçant au gré des vagues d’arrestations. La politique parisienne de démolition-gentrification déplace, durant les années 1980, le trafic dans les banlieues où il s’implante durablement.
Immigration, addiction et racisme
Pour la seconde génération de l’immigration magrébine, née en France ou y ayant grandi, le début de l’âge adulte coïncide avec la crise économique qui frappe la France, avec l’explosion du chômage et la fermeture des usines.
Les magrébin·es sont «les derniers arrivés et les premiers à partir». La guerre d’Algérie n’est pas lointaine: les jeunes grandissent dans des quartiers où des milices blanches, armées de battes et de chiens, font des rondes d’intimidation. C’est également l’époque où l’école devient un centre de tri et de reproduction sociale.
Exclu·es de l’école et sans perspectives professionnelles, les jeunes issu·es de l’immigration chassent l’ennui là où ils et elles peuvent. Seules deux boîtes de nuit, le Kiss Club & le Pacific, ne pratiquent pas la ségrégation et acceptent cette jeunesse. C’est là-bas que la rencontre avec l’héroïne se produit pour beaucoup d’entre elleux.
Le racisme structure ainsi le récit de la diffusion de l’héroïne. Il est l’élément qui permet à cette tragédie de prendre une telle ampleur puis de disparaitre dans l’amnésie collective actuelle.
Ignorance, abandon et déchirements
À la fin des années 1970, la consommation explose et touche largement les familles dont parfois l’ensemble des nombreux enfants deviennent dépendant·es. Cette déflagration est suivie de celle du VIH. L’interdiction de la vente de seringues en 1972, illusoire tentative de limiter la consommation, crée une pénurie de matériel d’injection. Le partage des seringues diffusera massivement le virus parmi les consommateur·ices au début des années 1980.
Les parents sont doublement démunis. Leurs connaissances sont lacunaires, tant en matière de drogue qu’en matière de SIDA. Les autorités ne font rien pour y remédier. Les familles sont abandonnées à elles-mêmes. Pour éviter le stigmate, les parent «cachent» leurs enfants addicts, puis malades, à domicile. Ce sont les pères et les mères qui accompagnent la fin de vie de leurs enfants.
Quand les enfants ne sont pas malades, le manque les pousse au vol, à la délinquance, même au sein de l’environnement familial. Les autres membres de la fratrie qui ne consomment pas les rejettent, parfois avec violence. Cette double peine déchire les familles. Certains pères abandonnent leurs proches et retournent en Algérie recommencer leur vie. Les seuls moments de réunions communautaires durant cette crise silencieuse sont les enterrements, qui s’enchaînent toutes les semaines. Des carrés musulmans ouvrent dans les cimetières de banlieue. Dans certaines familles, 6 enfants sur 8 mourront.
Témoignages riches et variés
En trame de fond des histoires individuelles poignantes, les multiples facteurs structurels sont mis à nu: la législation française et ses évolutions, les débuts de la Réduction des Risques, les traitements et l’oubli répété des banlieues pour ces derniers, la persistance et la continuité du «business» avec le cannabis et ses conséquences politiques réactionnaires, autant de thématiques impossibles à développer dans un article aussi court, mais richement traduites dans le podcast.
Hajer Ben Boubaker, l’autrice du documentaire, mélange les témoignages et parvient à créer une émission aussi précise que difficile à écouter. On y entend tour à tour d’ancien·nes consommateur·ices, des acteur·ices associatif·ves et éducateur·ices et des universitaires spécialistes du sujet. Malgré la douleur qui transparait de ces vies brisées, l’émission n’en est pas moins intéressante et essentielle. Face au silence et à l’oubli, il faut l’analyse.
Clément Bindschaedler