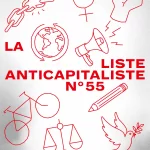Quelles alternatives pour un monde agricole à bout de souffle?
La politique agricole suisse vise à garantir la sécurité de l’approvisionnement, préserver les ressources naturelles, entretenir le paysage rural et assurer une occupation décentralisée du territoire. Karel Ziehli et Berthe Darras de l’organisation paysanne indépendante engagée pour la souveraineté alimentaire Uniterre analysent les défaillances du système actuel et développent leurs propositions pour un changement en profondeur.

Est-ce que selon Uniterre, la politique agricole permet de répondre aux buts fixés dans la Constitution?
B Les buts, fixés dans les articles 104 et 104a, sont justes et intéressants, mais la politique agricole actuelle permet principalement d’entretenir le paysage rural. Les objectifs de la sécurité de l’approvisionnement, de la conservation des ressources naturelles et de l’occupation décentralisée du territoire ne sont pas remplis. Il est déjà compliqué de parler de sécurité d’approvisionnement de la population quand on a un taux d’autosuffisance alimentaire net (sans fourrage importé) de 46%.
K Le Conseil fédéral a essayé de répondre à l’enjeu de sécurité de l’approvisionnement en augmentant le nombre d’accords de libre-échange. Alors que pour répondre à ce défi, il faut au contraire soutenir une forme d’agriculture productrice de denrées alimentaires au niveau local.
B La politique agricole actuelle ne permet pas non plus une occupation décentralisée du territoire. De nombreuses fermes de montagne cessent leurs activités à cause des difficultés économiques et sont abandonnées. Il y a une concentration des outils de transformation dans le marché laitier, la production fromagère et les moulins. Et étant donné qu’une partie des paiements directs sont calculés par hectare, plus la propriété est grande, plus ces paiements sont élevés. Cette formule incite à l’agrandissement des exploitations et complique considérablement la transmission intergénérationnelle, avec des coûts qui explosent. Concernant les ressources naturelles, on assiste à un effondrement de la biodiversité. Des efforts sont faits sur la préservation des ressources mais ils ne suffisent pas.
La politique agricole actuelle, introduite dans les années 1990, visait pourtant à répondre aux enjeux environnementaux, notamment avec l’introduction des paiements directs et des prestations écologiques requises? Est-ce que ce système fonctionne?
K Après la deuxième guerre mondiale, le but était d’inciter à la production et de faire en sorte d’avoir le taux d’approvisionnement le plus élevé possible pour éviter les dépendances avec d’autres pays. Le soutien direct de l’État permettait une politique des prix garantis, en rachetant la production si elle n’était pas vendue sur le marché.
Cet encouragement à la production a eu un fort impact sur l’environnement, causant la surproduction de lait et de céréales, qui ont provoqué sa remise en question. Au même moment, il y a eu des pressions internationales pour que la Suisse adhère aux accords du GATT (ancêtre de l’OMC) qui interdisaient le soutien direct à la production. En réponse à cette interdiction, la Suisse a instauré les paiements directs en 1993 qui ont permis d’aller dans une direction souhaitable en termes de protection de l’environnement, notamment en diminuant fortement la pollution liée au phosphore et à l’azote.
Une politique de soutien des paysan·nes dans la mise en place de mesures écologiques était une idée intéressante, mais le problème est que les paysan·nes ne sont pas rétribué·es au juste prix de leur production. Ce sont les détaillants qui tirent profit de cette situation en appliquant des marges élevées, justifiant le maintien de bas prix d’achat par l’existence des paiements directs qui compensent.
Si les paysan·nes arrivent à survivre, c’est grâce à des services rendus à l’État qui sont très techniques et qui demandent beaucoup de travail administratif. Il y a une grande frustration et une perte de sens du métier chez certain·es.
B Les paiements directs sont fournis par catégorie de contributions. La part la plus importante est versée par hectare et non par rapport à la main d’œuvre ce qui favorise l’industrialisation. La majorité des petites fermes maraîchères embauchent beaucoup de gens mais ne reçoivent quasiment pas de paiements directs. Pour pouvoir en recevoir, il faut également remplir les prestations écologiques requises (PER) comme attribuer 7% du territoire aux surfaces de promotion de la biodiversité, respecter un bilan de fumure ou des mesures concernant le bien-être animal. Il y a aussi une partie de contributions liée à la qualité du paysage par l’entretien du paysage rural.
Les paiements varient aussi en fonction du territoire: les zones de montagne sont davantage soutenues étant donné les difficultés. Malgré tout cela, le salaire d’un ouvrier agricole, c’est 3600 francs en moyenne par mois pour 50 heures par semaine et le salaire d’un paysan·ne 4880 francs pour 60 à 70 heures par semaine!
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) élabore actuellement la nouvelle politique agricole à l’horizon 2030 (PA30+), visant à intégrer une approche globale des systèmes alimentaires. Pensez-vous que l’OFAG va dans le bon sens et sera en mesure de répondre aux enjeux? Comment se déroule le processus?
K Considérer les systèmes agroalimentaires dans leur globalité est une idée que l’on défend depuis longtemps! Par exemple, la transparence des prix nécessite de prendre en compte toute la chaîne agroalimentaire pour répartir les gains équitablement.
B Il est important de souligner qu’Uniterre n’a pas été invité à participer au groupe d’accompagnement du développement de la PA30+. Bien que nous soyons une petite organisation, nous sommes reconnus médiatiquement et politiquement. On a certes pu avoir un échange privé de 2h30 avec l’OFAG mais nous restons exclu·es du groupe de travail.
K On sent bien que la raison sous-jacente, c’est qu’on a des positions un petit peu trop radicales. Ils ne nous prennent pas suffisamment au sérieux, mais ils se sont rendus compte qu’on avait des propositions concrètes à poser sur la table. Ils sont aussi mis sous pression parce qu’ils savent très bien que si la prochaine politique agricole ne répond pas aux attentes, les agriculteur·ices ne vont pas l’accepter. On sera les premier·ères au front d’ailleurs.
Avec Uniterre, vous avez fait une proposition concrète de politique agricole. Quels en sont les éléments principaux?
B Nous avons une première partie qui répond à quatre points: la sécurité alimentaire, la diminution de l’empreinte écologique, la simplification administrative et l’amélioration des perspectives économiques des paysan·nes. Parmi les propositions phares, il y a notamment le renforcement de la protection douanière et toute une partie sur l’amélioration des perspectives économiques pour que les prix couvrent les coûts de production et assurent un salaire minimum correct de 40 francs de l’heure brut pour les agriculteur·ices et de 30 francs de l’heure brut pour un·e ouvrier·ère agricole.
Nous proposons que la durée des politiques agricoles soit de dix ans plutôt que de quatre pour laisser le temps de mettre les choses en place. Dans la deuxième partie, nous proposons une refonte complète du système des paiements directs pour la diviser en trois piliers: l’aide à la production, l’aide à la transformation artisanale et les contributions à la consommation.
Concernant l’aide à la production, nous proposons que les paiements directs soient basés sur le diagnostic Agriculture paysanne. C’est une grille d’analyse des fermes selon six thèmes transversaux: l’autonomie, la répartition des volumes et des moyens de production, le travail avec la nature, la qualité des produits, le développement local et la dynamique territoriale et finalement la transmissibilité. Les paiements directs sont ainsi versés par rapport à la main d’œuvre, par équivalent temps plein (ETP), plutôt que par hectare. Le diagnostic Agriculture paysanne est un outil utilisé, testé et approuvé en France depuis une vingtaine d’années. Il est également en phase pilote à Genève et la direction de l’agriculture du canton de Vaud va effectuer dix diagnostics dans le canton.
L’aide à la transformation artisanale se fait grâce à un fonds pour la création d’unités de transformation locales et de stockage et pour la promotion de la vente par exemple à travers des épiceries participatives ou des groupements d’achat. Les contributions à la consommation sont développées selon le modèle de l’assurance sociale de l’alimentation (ASA). Finalement, on propose d’inscrire le droit à l’alimentation dans la Constitution au niveau fédéral, comme ça a été fait à Genève.
À moyen terme, cette nouvelle proposition aurait comme conséquence que toute ferme recevrait moins de paiements directs mais aurait davantage de revenu via la vente de la production.
Une année après les révoltes paysannes, que reste-t-il de cette colère et est-ce qu’elle a influencé la construction de la nouvelle politique agricole?
K Ce que je peux observer au Parlement, c’est qu’il y a énormément d’interventions sur la charge administrative et une certaine parole des révoltes a été relayée. Une des réponses qui est assez systématique quand ces objets sont acceptés, c’est qu’ils seront traités dans le cadre de la prochaine politique agricole. Reste à voir comment cela sera appliqué et dans quelle direction ça ira.
B J’ai l’impression que le monde paysan n’est pas près d’attendre la PA30+. Je peux comprendre que le processus de changement soit en cours et d’un autre côté je comprends les paysan·nes qui ne veulent pas attendre encore cinq ans dans ces conditions.
Un mot de la fin?
K Ce qu’on essaie de faire chez Uniterre, c’est de lutter contre la précarité du monde rural. Il y a des paysan·nes qui profitent du système des paiements directs mais il y en a aussi énormément qui ne s’en sortent pas au quotidien. Le taux de suicide chez les paysan·nes est 37% plus élevé que dans le reste de la population suisse!
K C’est aussi important de dire que quand on demande des prix rémunérateurs pour les paysan·nes, ça ne veut pas nécessairement dire une augmentation des prix au magasin puisque nous revendiquons une diminution des marges de la grande distribution.
Propos recueillis par Ella-Mona Chevalley